|
(Dessin réalisé au primaire) Contactez-moi : cejean@charleries.net |
Les charleries Bienvenue sur mon blogue, Ce blogue contient des souvenirs, des anecdotes, des opinions, de la fiction, des bribes d’histoire, des récréations et des documents d’archives. Charles-É. Jean
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saint-Mathieu-de-Rioux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6610
15 novembre 2022
Fêtes du
centenaire
En
1966, Saint-Mathieu-de-Rioux fête le 100e anniversaire de
l’arrivée du premier curé résident et de l’ouverture des registres
paroissiaux. Comme d’autres journaux, dans son édition du 5 juillet
1966, L’Action catholique fait un compte-rendu de ces fêtes.
« Les citoyens de Saint-Mathieu, dans le comté de Rimouski,
s’apprêtent à célébrer avec beaucoup d’éclat le centième
anniversaire de fondation de leur municipalité. Un comité général
est déjà à l'œuvre. La présidence a été confiée à M. Adrien Ouellet,
gérant de la Caisse Populaire, et le secrétariat à M. Roland
Ouellet.
Un
album historique sera publié à cette occasion. Il relatera les
principaux faits d'un siècle d’histoire tout en mettant l’accent sur
les personnalités qui ont aidé à façonner I’histoire de St-Mathieu.
Une croix serait érigée sur un promontoire surplombant le village au
nord-ouest de l'église grâce aux souscriptions des paroissiens.
Un
banquet réunira les principaux invités. Une messe concélébrée
marquera l’ouverture des fêtes le 2 juillet, qui se termineraient le
4 juillet. (…)
Rappelons que St-Mathieu fut érigée canoniquement en paroisse en
18S8 et en municipalité en 1865. On comptait alors 800 âmes. Quinze
ans plus tard, la population avait grimpé ... et atteignait 1133
âmes. C’est l’abbé Julien Rioux, natif de Trois-Pistoles,
descendants du seigneur-colon Nicolas Rioux, qui a célébré la
première messe à St-Mathieu, il y a plus d’un siècle.
Le
dimanche, 3 juillet, les invités, les paroissiens, les visiteurs
pourront voir un pageant historique sur la paroisse même de
St-Mathieu. Intitulé Jeu du centenaire, le spectacle a été
fait et réalisé par Sœur Marie Thérèse de France, des Sœurs du
St-Rosaire. La pièce relate des faits historiques et donne un aperçu
fidèle de la paroisse au fil des années.
Une équipe de jeunes acteurs est à pied d’œuvre depuis des mois pour faire un succès du spectacle historique. Le rôle de meneur a été confié à Viateur Viel. Trois chœurs ont été formés. Le premier se compose de Louisette Vaillancourt, Diane Morin. Lucie Vaillancourt, Ghislaine Théberge, Cécile Théberge. Le deuxième chœur : Françoise Ouellet, Diane Rioux, Denise Bérubé. Berthe Ouellet, Sylvain Théberge. Le troisième chœur : Carol Dionne, Yvon Ouellet, Serge Bérubé, Paul-Émile Vignola, Jean-Claude Gaudreau et Réginald Ouellet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6600 9 novembre 2022
Trois décès en
1966 En 1966, des nouvelles provenant de Saint-Mathieu-de-Rioux ont été publiées dans Le Progrès du Golfe et le journal l’Action de Québec.
Décès de Mme Désiré Théberge
Le
15 janvier, décédait Madame Veuve Désiré Théberge (Rosalie Parent).
Elle était âgée de 73 ans.
Ses funérailles eurent lieu en la chapelle de la Maison de la
Charité à Notre-Dame du Sacré-Cœur, puis un Libéra fut célébré en
l’église de Saint-Mathieu, par M. le curé Gérard Cayouette avant
l’inhumation dans le cimetière paroissial. La croix était portée par
M. Léo Théberge et le cercueil par MM. Antonio Théberge, Georges
Théberge, Paul- Émile Bérubé, Rodolphe Ouellet, Étienne Ouellet et
Charles Vaillancourt (rang 5).
Madame Théberge laisse son fils Armand, de Rouyn, ses filles Sœur
Jeanne-Odile Théberge, Franciscaine de Marie à Baie-Saint-Paul, Sœur
Thérèse Théberge, des Sœurs de la Charité de Montréal, Simone et
Bernadette, de Montréal. Elle était la sœur de MM. Antonio et
Alphonse Parent, Mmes Maria et Anne-Marie Parent du Bic. Lui survit
aussi sa bru Mme Armand Théberge.
Décès de Laura Théberge
Sont allés à Québec, le 22
janvier pour assister aux funérailles de Mme Eugène Vaillancourt
(Laura Théberge), décédée à l'âge de 76 ans : M. Onésime Dionne, M.
et Mme Réal Dionne, M. et Mme Léo Théberge, M. et Mme Antonio
Théberge, Mme Édouard Ouellet, M. et Mme Roland Dionne, Mme Edmond
Jean, Mme Maurice Théberge, Mme Georges Théberge, Mme Paul-Émile
Bérubé, Mlle Candide Théberge.
La dépouille mortelle de Mme
Vaillancourt, native de Saint-Mathieu, fut inhumée dans le cimetière
Belmont, à Québec. (Progrès du Golfe, 4 février 1966)
Complément.
Laura Théberge est décédée le 19 janvier 1966 à
Québec. Elle est la fille d’Alfred Théberge et de Rose Rousseau.
Elle est la belle-sœur de Rosalie Parent (Désiré Théberge).
Décès d’Ernest Vaillancourt
À l’hôpital Laval de Québec,
le 28 avril 1966, à l’âge de 73 ans et 7 mois, est décédé M. Ernest
Vaillancourt de Saint-Mathieu de Rimouski. Les funérailles ont eu
lieu lundi le 2 mai.
M.
Ernest Vaillancourt, célibataire rentier, était le fils de M. Léon
Vaillancourt et de Félicité Dionne, décédés. Il a toujours demeuré à
Saint-Mathieu et laisse un souvenir d’un parfait gentilhomme à tous
ceux qui l’ont connu. Il avait été marguillier de sa paroisse.
C'est M. le curé Gérard Cayouette qui a officié au service funèbre,
assisté de diacre et de sous-diacre. Des ambulanciers Saint-Jean de
la paroisse portaient le cercueil soit MM. Gilbert Jean, Normand et
Lionel Lagacé, Julien Dionne, Camille Saindon, Gervais Dionne,
Gérard-Omer Ouellet, Léonard Gagnon. (L’Action, 30 avril
1966)
Complément. Ernest Vaillancourt est le beau-frère de Laura Théberge. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6590
3 novembre 2022
Nouvelles de 1965
En 1965, le Progrès du Golfe a publié quelques nouvelles
concernant Saint-Mathieu-de-Rioux. Les voici :
Salle de quilles
M. l’abbé Gérard Cayouette bénissait, dimanche dernier le 9 mai, une
salle de quilles à Saint-Mathieu, et coupa le ruban symbolique qui
fermait l’accès. Il était entouré de M. Réal Dionne, maire, MM.
Roland Ouellet et Amédée Beaulieu.
Les responsables du Comité des loisirs furent invités par M. Ouellet
à lancer les premières balles, soit MM. Réal et Julien Dionne,
Amédée Beaulieu et Lucien Ouellet.
Sise au sous-sol du Centre paroissial, la salle de quilles, confiée
à la direction de M. Louis-Jacques Beaulieu, est née d'une
collaboration étroite entre le Comité de Loisirs et toute la
population. (Progrès du Golfe, 14 mai 1965)
Chez les Dames de la Sainte-Famille
Le dimanche 25 juillet, à l’occasion de la fête de Sainte-Anne, il y
eut cérémonie d’initiation dans les rangs de la congrégation des
dames de la Sainte-Famille. Furent reçues Mme Paul Lafontaine et Mme
Pierre-Paul Jean. Le conseil d’administration est formé de Mme Raoul
Vignola, présidente, Mme Léonard Fournier, secrétaire, et Mme
Maurice Théberge, trésorière. (Progrès du Golfe, 13 août
1965)
Naissances
M. et Madame Antonio Théberge annoncent la naissance d’une fille
sous le prénom de Julie. Parrain et marraine, M. et Mme Réginald
Létourneau (Rachel Théberge), beau-frère et sœur de l’enfant. Mlle
Nicole Théberge portait sa sœur sur les fonts baptismaux. (Progrès
du Golfe, 14 mai 1965)
M. et Mme Adrien Ouellet (Marie Ouellet) annoncent la naissance de
leur fils Guy. Parrain et marraine, M. et Mme Jean-Marc Ouellet
(Lise Boucher), oncle et tante. Mlle Berthe portait son frère sur
les fonts baptismaux. (Progrès du Golfe, 13 août 1965)
Johanne, enfant de M. et Mme Gervais Ouellet (Jeannine Berger),
annonce la naissance de son frère Marius. Parrain et marraine, M. et
Mme Édouard Ouellet (Lucienne Théberge), grands-parents. Mlle
Marie-Marthe Ouellet portait son neveu au baptême conféré par M. le
curé Gérard Cayouette en l'église paroissiale. (Progrès du Golfe,
26 novembre 1965)
Mariages
En l’église de Saint-Mathieu, a été béni le mariage de Francine
Dionne, fille de M. et Mme Réal Dionne (Ida D’Auteuil) à Beaudoin
Rousseau, fils de feu Omer Rousseau et de Mme Annette Roy, de
Saint-Fabien. La bénédiction nuptiale leur fut donnée par M. l’abbé
Gérard Cayouette, curé de Saint-Mathieu. (Progrès du Golfe,
17 septembre 1965)
A été béni le mariage de Fernande Ouellet, fille de M. et Mme
Romuald Ouellet (Rose Ouellet) et Roland Lévesque, fille de M. et
Mme Adrien Lévesque (Eliza Lavoie) de Rimouski. (Progrès du Golfe,
17 septembre 1965)
A été béni le mariage de Mariette Gagnon, fille de M. et Mme Gérard Gagnon (Albina Rioux), de Saint-Mathieu à Mario D’Amours, fils de M. et Mme Omer D’Amours (Julienne Marquis) de Trois-Pistoles. La bénédiction leur fut donnée par M. l’abbé Gérard Cayouette, curé de Saint-Mathieu. La réception eut lieu à l’Hôtel Bienvenue de Rivière-Trois-Pistoles. (Progrès du Golfe, 17 septembre 1965) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6580
27 octobre 2022
Manifestations en
1965
Au
cours de 1965, le Progrès du Golfe a fait le compte-rendu de
manifestations populaires à Saint-Mathieu-de-Rioux dans trois
éditions, le 9 avril, le 28 mai et le 26 novembre.
Course au lac St-Mathieu
Dimanche le 28 mars avait lieu au lac St-Mathieu une grande course
de traînes mobiles. Près de 600 personnes assistaient à cette
manifestation haute en couleur. Cinq courses étaient au programme.
Quelque vingt-cinq conducteurs de traînes mobiles, tous de grande
classe, se rendirent sur les lieux afin de participer à cette
compétition.
Cette manifestation prit de l'importance lorsqu’on enregistra un
record de vitesse. M. David Langis à bord de sa traîne mobile
Bombardier fila à une allure de 60 milles à l’heure sur la piste
glacée. C'est la première fois que l’on enregistre dans notre région
une telle vitesse en traîne mobile.
MM. Roger Desjardins et Charles Gagné se signalèrent également pour
leur magnifique performance. Pour terminer en beauté cet événement
sportif, des trophées furent décernés aux vainqueurs des différentes
catégories. Les gagnants sont MM. David Langis, Roger Desjardins,
Charles Gagné, Égide Jean, Damien Michaud, Normand Dionne et Lucien
Desjardins, qui reçurent leurs prix des mains des notables de
l’endroit et des commanditaires.
Tous les organisateurs de cette compétition remercient le maire et
ses assistants pour leur entière collaboration à la réussite de
cette manifestation sportive. L’année prochaine, on projette une
autre manifestation de ce genre à St-Mathieu. Le site est magnifique
et se prête très bien à une telle compétition.
Au
Cercle Lacordaire
Mlle Nicole Théberge animait avec tact et brio la soirée d’amateurs
donnée au Centre paroissial, le 28 février, sous les auspices des
cercles Lacordaire et Ste-Jeanne d'Arc. M. Rénald Thibault présidait
la soirée qui révéla à la nombreuse assistance des talents locaux
fort prometteurs et un travail efficace qui s’effectue dans l’ombre
au domaine des arts populaires.
Nommons le groupe de jeunes filles, les cinq, les KATHLEEN, Mlles
Monette Boucher, Louisette Vaillancourt, M. Lauréat Ouellet, Mlles
France Boucher, Andrée Côté, i. d., Ghislaine Théberge, Michèle
Caron (Trois-Pistoles), Nicole Théberge, Monette Boucher, MM. Rénald
Thibault, Roland Gaudreau. (Progrès du Golfe, 9 avril 1965)
Confirmation à Saint-Mathieu
Son Exc. Mgr Louis Lévesque,
archevêque-coadjuteur de Rimouski, présidait, le 13 mai, en l'église
de Saint-Mathieu, une cérémonie religieuse au cours de laquelle il a
conféré le sacrement de confirmation à 85 enfants de la paroisse. M.
David Dubé, marguillier, et son épouse, agissaient comme parrain et
marraine de confirmation.
Mgr Lévesque était accompagné,
pour cette visite pastorale, de M. le chanoine Omer D’Amours, de
Trois-Pistoles, M. l’abbé Élie Beaulieu, de la même localité, M.
l’abbé Aubin Fougère, curé de Rivière Trois-Pistoles, M. l’abbé
Rosaire Dionne, directeur au Séminaire de Rimouski, M. l’abbé Ernest
Lepage, curé de Saint- Simon.
M.
l’abbé Gérard Cayouette avait accueilli Mgr Lévesque à son
presbytère pour la durée de la visite pastorale à Saint-Mathieu. (Progrès
du Golfe, 28 mai 1965)
Les 20 ans du cercle Lacordaire
Les abstinents de St-Mathieu ont bellement souligné les vingt ans
d’existence de leurs cercles Lacordaire et Jeanne d'Arc, le 14
novembre.
Après la messe
d'action de grâces, célébrée par l'aumônier diocésain, l’abbé
Pierre-Noël Hallé, des agapes réunissaient plus de 200 convives.
À
la table d’honneur, nommons M. Arthur Raymond, ex-président, M.
Georges-H. Gagnon, M. D., président diocésain, M. l'abbé Hallé, M.
le curé Gérard Cayouette, M. Charles Vaillancourt, vice-président
diocésain. Une soirée éducative et récréative couronna cette
journée-anniversaire. M. Raynald Thibault président du cercle local,
invita les jeunes à joindre les rangs du mouvement, dont le but
premier est d'aider les autres. Les élèves du couvent donnèrent un
tour de chant et un sketch humoristique.
Une trentaine de personnes furent décorées pour leurs 20 années de
fidélité à la doctrine Lacordaire et une quinzaine, pour 10 ans.
De brèves allocutions furent prononcées par les abbés Hallé et Cayouette. (Progrès du Golfe, 26 novembre 1965) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6565
18 octobre 2022
Deux décès en 1965
En
1965, le Progrès du Golfe a fait mention, dans ses pages, de
deux décès l’un dans l’édition du 30 juillet et l’autre dans celle
du 15 octobre.
Décès de Mme Cyrice Bélanger
C’est en l'église de Saint-Mathieu, le 15 juillet, que M. l'abbé
Laurent Lavoie, curé de Saint-Léon-le-Grand, officiait au service
funèbre de Mme Cyrice Bélanger (Marie-Laure Lagacé), décédé à
I’hôpital de Rimouski à l'âge de 63 ans.
Agissaient comme diacre et sous-diacre les abbés Gérard Cayouette,
curé de Saint-Mathieu, et Charles Morin, professeur au Séminaire.
La croix était portée par M. Florian Bérubé et le cercueil par MM.
Léon Bérubé, Maurice Bérubé, Charles et Léopold Beaulieu. Fernand
Bélanger, Marcel Devost.
Avaient pris place au chœur, les abbés Hermel Pelletier, Clovis
Théberge, fils de la paroisse élevé à la prêtrise le 4 juillet,
Pierre Moreault, directeur du Grand Séminaire de Rimouski.
Madame Bélanger laisse, outre son mari, ses fils Lionel, Augustin et
Alexandre de St-Mathieu, sa fille Mme Léonard Roussel (Lucille) de
St-Valérien ; son frère M. Camille Lagacé, de Québec ; ses sœurs Mme
Émile Bérubé (Alice), Mme Jos.-Luc Beaulieu (Yvonne), Mme
Louis-Jacques Beaulieu (Azilda), de St- Mathieu, Mme Georges
Beaulieu (Georgianne), de Québec, son gendre M. Léonard Roussel.
Ses beaux-frères et belles-sœurs M et Mme Charles Bélanger, de St-
Simon, M. l'abbé Émile Bélanger, de St-Eusèbe, la R.S. St-Jean
l'Évangéliste, la R.S. St-Augustin, la R.S Marie-Andrée, de
l’Institut des Sœurs Ste-Marthe de St- Hyacinthe, la R.S. St-Léon,
Ursuline, de Rimouski, toutes quatre belles-sœurs de la défunte, M.
Joseph Bélanger, M. et Mme Gérard Bélanger, de St-Damase, M. et Mme
Damase Fournier d’Amqui, M. et Mme Hermel Devost (Marie-Anne
Bélanger), de Trois- Pistoles, MM. Jos.-Luc, Louis- Jacques,
Georges Beaulieu et Émile Bérubé. (Progrès du Golfe, 30 juillet 1965)
Décès d’Arthur Fournier
En l'église de Saint-Mathieu,
le 16 septembre, M. l'abbé Gérard Cayouette, curé, officiait aux
funérailles de M. Arthur Fournier, décédé à l'Hôpital Saint-Joseph
de Rimouski, à l'âge de 79 ans. Agissaient comme diacre et
sous-diacre, les abbés Rosaire Dionne et Clovis Théberge, deux fils
de la paroisse.
La croix était portée par M.
Onésime Dionne et le cercueil par MM. Réal Dionne, Victor Parent,
Antonio Théberge, Joseph Jean, Philippe Ouellet et Armand Rioux.
Le défunt laisse son épouse (Lydia Bérubé) ainsi que ses fils et filles M. et Mme André Fournier, de Saint-Mathieu, M. et Mme Joseph Lagacé (Isabelle) de Saint-Cyprien, Mme Edmond Jean (Alexina) de Saint-Mathieu, Mme Benoit Boucher (Germaine), de Saint-Mathieu, M et Mme Léopold Jolicoeur et M. Gérard Fournier de Québec. Il était le frère de M. Eugène Fournier, de Trois-Rivières, M. Isidore Fournier de Saint-Fabien. Lui survivent également ses beaux-frères et belles-sœurs Mme Achille Fournier, Mme Joseph Fournier de Saint-Fabien, M. et Mme Joseph Bérubé, Mme Émile Bérubé, M. et Mme Charles-Eugène Bérubé, de Saint-Mathieu, Mme Jules Bélanger de Trois-Pistoles, M. et Mme Paul Jean de Rimouski. (Progrès du Golfe, 15 octobre 1965) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6555
12 octobre 2022
Nouvelles de 1930
Le
journal l’Action catholique du 18 octobre 1930 a publié des
nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux. Les voici :
Mariages
Le
10 septembre, en notre église paroissiale, fut béni le mariage de M.
Raoul Lévesque, banquier en assurances de Montmagny, fils de feu
Elzéar Lévesque, et de Mlle Rose-Aimée Dionne, fille de M. et Mme
Ernest Dionne.
Le
même jour, fut béni le mariage de M. Omer Dionne, industriel de
cette paroisse, fils de M. et Mme Ernest Dionne, et de Mlle Cécile
Ouellet, fille de M. et Mme Joseph Ouellet, également de cette
paroisse.
Les mariés partirent ensuite pour un voyage à Montréal.
Va-et-vient
- Vers la mi-septembre, M. Paul-Hubert, inspecteur du district,
visitait les écoles de notre paroisse.
- M. le curé et un certain nombre de la paroisse se sont rendus à
St-Simon le 18 septembre pour assister aux funérailles de feu M.
Théophile Thibault.
- M. et Mme Xavier Dionne d’Amqui chez leurs parents M. J. Dionne.
- MM. et Mmes Noël Fournier, Philias Fortin, Joseph Bélanger, de
St-Fabien visitaient des parents dernièrement.
- Mlle Marie-Laure Théberge a passé quelques jours à Québec.
- M. Antoine Dionne de passage à Rimouski.
- Mlle Marie-Laure Lagacé est de retour d’une huitaine à
Rivière-du-Loup chez des parents.
- M. le notaire C. D’Anjou de Rimouski était de passage ici le 20
septembre par affaire.
- M. et Mme Albert Dionne sont partis pour demeurer à Montréal.
Funérailles
Le 22 septembre en l’église paroissiale fut célébré le service de
feu Aglaé Boucher, épouse de M. Pascal Gaudreault.
Les récoltes Les récoltes sont en partie terminées. Les cultivateurs en sont très optimistes car elles sont abondantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6550
9 octobre 2022
Nouvelles de 1964
Au cours des mois d’avril, de
juin et de juillet 1964, le Progrès du Golfe a publié des
nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux.
Fiançailles
On
annonce les fiançailles de M. André Ouellet, fils de M. et Mme
Édouard Ouellet (Lucienne Théberge), et Mlle Yvette Vaillancourt,
fille de M. et Mme Charles Vaillancourt (Ernestine Ouellet), de
St-Mathieu, survenues le 15 mars.
À
Rimouski, le 29 mars, eurent lieu les fiançailles de Mlle Micheline
Doucet, fille de M. et Mme Georges Doucet, de Rimouski, et M. Rémi
Ouellet, fils de M. et Mme Édouard Ouellet (Lucienne Théberge), de
St-Mathieu.
À
l’Esprit-Saint, à Pâques, les fiançailles de Mlle Lise Boucher,
fille de M. et Mme Élias Boucher (Amanda Michaud), de
l’Esprit-Saint, et M. Jean-Marc Ouellet, fils de M. et Mme Étienne
Ouellet (Alice Vaillancourt), de St-Mathieu.
Le
29 mars, à St-Mathieu, les fiançailles de Mlle Laurence Ouellet,
fille de M. et Mme Rodolphe Ouellet (Adrienne Vaillancourt), et M.
Pierre-Paul Jean, fils de M. et Mme Edmond Jean (Marie-Laure
Théberge), tous de St-Mathieu. (Progrès du Golfe, 3 avril
1964)
Baptêmes
Marie-Johanne, enfant de M. et Mme Gervais Ouellet (Jeannine
Berger). Parrain et marraine, M. et Mme Arthur Berger, de Saint-
Eugène de Ladrière, grands-parents.
Marie-Nancy, enfant de M. et Mme Gaston Doucet (Gemma Ouellet) de
Rimouski. Parrain et marraine, M. et Mme Édouard Ouellet (Lucienne
Théberge) de Saint-Mathieu, grands-parents.
Première messe
La
paroisse de Saint-Mathieu était en liesse le dimanche 21 juin, alors
que le R. P. Arthur Beaulieu célébrait sa première messe en l’église
paroissiale, à 11 heures. Il est le fils de M. et Mme Joseph-Luc
Beaulieu, de Saint-Mathieu. (Progrès du Golfe, 26 juin 1964)
Décès de Mme Désiré Rousseau
Au Sanatorium de Mont-Joli, le
29 juin, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Désiré Rousseau (Clara
Berger). Outre son époux, lui survivent ses fils Omer et Hervé et
leur famille. M. l’abbé Cayouette, curé, officiait au service
funèbre en l’église paroissiale, le 2 juillet.
Mariage et jubilé
Le samedi 11 juillet, fut béni
le mariage de Mlle Laurence Ouellet, fille aînée de M. et Mme
Rodolphe Ouellet, et M. Pierre-Paul Jean, fils de M. et Mme Edmond
Jean. Il y eut réception à l’Hôtel Laval de Bic. À la même
réception, les parents de la mariée, M. et Mme Rodolphe Ouellet,
reçurent cadeaux et vœux à l’occasion de leur 25e
anniversaire de mariage.
Souper champêtre
Dimanche soir, le 12 juillet, une fête fut organisée à Saint-Mathieu par le cercle Lacordaire et Jeanne d'Arc. Il y eut diverses attractions après le repas au centre paroissial. (Progrès du Golfe, 24 juillet 1964) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6535
30 septembre 2022
Deux décès en 1964
En
1964, le Progrès du Golfe a fait mention, dans ses pages, de
deux décès : l’un dans l’édition du 25 septembre 1964 et l’autre
dans celle du 1er janvier 1965.
Décès de Cyprien Desjardins
Le 11 décembre, décédait, au
Sanatorium de Mont-Joli, à l’âge de 35 ans, M. Cyprien Desjardins,
fils de M. et Mme Ernest Desjardins (Délima Gaudreau). Il a succombé
à une longue maladie.
Outre ses parents, lui
survivent, ses frères et sœurs Philias, de Saint-Mathieu, Roger, de
Notre-Dame du Sacré-Cœur, Jean-Louis, étudiant à Rimouski et Gilles
; Mme Joseph Nadeau (Laurette), de Rimouski, Mme Jean-Guy Morin
(Yolande), de Manic 5, Mme Gilles Charron (Anita), de Rimouski, Mme
Hector Bouchard (Lina), de Manic 2, Mme Guilmont Tremblay
(Georgette), de Baie-Comeau, Armande, de Saint-Mathieu, ses
belles-sœurs Mmes Philias, Roger Desjardins ; ses beaux-frères MM.
Nadeau, Morin, Charron, Bouchard et Tremblay.
C’est M. le curé Gérard Cayouette qui officiait au service funèbre.
La croix et le cercueil furent portés par MM. Roland Gaudreau, Omer
Jean, Gérard Boulanger, Conrad Plourde, Richard Jean, Onil Rousseau
et Charles-Eugène Desjardins.
M.
l’abbé Rosaire Dionne, directeur du Séminaire de Rimouski, fils de
la paroisse, avait pris place dans le chœur. Le deuil était conduit
par les parents ci-dessus auxquels s’étaient joints Mme Joseph
Desjardins, de Montréal, M. et Mme Louis Mercier, de Mont-Joli, Mme
Ernest Jean, de Trois-Pistoles, M. et Mme Alphonse Desjardins, M. et
Mme Désiré Dionne, de Rimouski. (Progrès du Golfe, 25
décembre 1964)
Décès de Mme Charles Ouellet
Le
22 décembre, décédait, subitement, à son domicile de St-Mathieu, à
l'âge de 75 ans, Mme Charles Ouellet (Rose-Délima Côté).
Lui survivent ses fils Alfred, d’Edmundston, Oliva, de Québec, Léo
et Marcel, de Rimouski, Arsène, de St-Mathieu, Donat, de
Lac-des-Aigles, Nazaire, de Sept-Îles ; ses filles Jeannette,
Louisonne et Lisa, de Montréal, Mme Gérard Ouellet ; ses brus Mmes
Léo, Marcel, Arsène, Donat Ouellet.
Lui survivent aussi ses frères Adélard, d’Amos, Hermel, de Notre-Dame du Lac, Armand, de Berlin, N. H., Ludger et Trefflé, de St-Mathieu ; ses sœurs Mme Amédée Rioux (Rosalie), de St-Zénon du Lac-Humqui, Mme Jos. Desjardins (Anna), Mme Onil Moreault (Rose-Alma), de Notre-Dame du Lac, Mme Phydime Migneault (Alice), de St-Mathieu, Mme Georges Ouellet. (Progrès du Golfe, 1er janvier 1965) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6520
21 septembre 2022
Nouvelles de mars
1964
Au cours du mois de mars de
1964, le Progrès du Golfe a publié des nouvelles sur
Saint-Mathieu-de-Rioux. Les voici :
1.
Progrès du Golfe, 6 mars 1964
La Fabrique
David Dubé a été élu marguillier en
remplacement de M. Magloire D’Anjou, sortant de charge. Le banc se
compose maintenant de MM. Charles Vaillancourt, Joseph Bérubé et
David Dubé.
Statistiques
Il y eut en 1965, 30 baptêmes, 6 décès et
5 mariages. La population de 1117 âmes est répartie en 166
familles.
Mariage
Le 8 février, en l’église de
Sainte-Philomène de Montréal, fut béni le mariage de M. Michel
Parent, fils de M. et Mme Raoul Parent, de Saint-Jacques de
Montréal, et Mlle Rolande Fournier, fille de M. et Mme Hermel
Fournier (Bernadette Jean), de Saint-Mathieu.
La commission scolaire
M. Georges Dionne a été choisi président
de la Commission scolaire à la suite de la disqualification de M.
Philippe Gagnon.
Le festival
Mlle Francine Plourde sera couronnée Reine du Festival
de Saint-Mathieu, le dimanche 16 février, au cours d'une brillante
manifestation populaire, en soirée, sur la patinoire locale. Il y
aura danse, démonstrations de patinage de fantaisie, courses et
jeux divers. Sa Majesté Francine 1ère sera accompagnée
de M. Mario Rioux, prince consort. La cour d'honneur sera formée des
duchesses Pauline Beaulieu et Francine Jean et de leurs chevaliers
MM. Nelson Gagné et Fernand Vaillancourt. Cette soirée mettra fin
aux festivités de l'Œuvre des Terrains de Jeux qui se tiennent à
Saint-Mathieu depuis le 14 janvier.
Chez les abstinents
Les membres des cercles Lacordaire et Ste-Jeanne d’Arc se sont
réunis, mercredi, le 26 février, pour élaborer le programme des
activités de la saison et discuter de problèmes particuliers à
l’Association. L’assemblée était sous la présidence de M. le curé
Gérard Cayouette.
Tout l’exécutif des deux cercles était présent, soit M. Raynald
Thibault, président, M. Magloire D’Anjou, secrétaire, M. Antonio
Théberge, vice-président régional, MM. Amédée Beaulieu, Rodolphe
Ouellet, Raynald Vaillancourt, Gilbert Jean, Lauréat Ouellet, Jos.
Rioux, directeurs, Lucien Ouellet, trésorier.
Les Jeanne d’Arc comptaient toutes leurs officières : Mlle Éliane
Ouellet, présidente, Mme Joseph Rioux, vice-présidente, Mlle Monique
Belzile, secrétaire, Mmes Georges Théberge, Rodolphe Ouellet,
Gervais Ouellet, Antonio Théberge, Patrice Lafrance et Mlle Estelle
Ouellet, directrices.
2.
Progrès du Golfe, 20 mars 1964
Réunion des coopérateurs
M.
Georges Théberge présidait, au Centre paroissial de Saint-Mathieu,
récemment, l’assemblée générale de la Société Coopérative de
Saint-Mathieu.
MM. Adrien Ouellet, secrétaire, et Gabriel Belzile, vérificateur,
firent connaître le bilan 1963. Le chiffre d’affaires réalisé par la
Société, durant l’année fiscale 1963-64, atteint les 262 002,69 $.
M.
Paul Plourde, de Saint-Mathieu, agronome officiel du comté de
Rimouski, parla de la loi ARDA et de l’élevage du mouton qu’il faut
promouvoir dans la région agricole de Saint-Mathieu.
Il
y eut élection du président et des directeurs pour l’année 1964.
Quatre prix furent attribués dans l’assistance. Les bénéficiaires
sont MM. Gérard Ouellet, Antonio Fournier, Antonio Théberge et
Charles-Eugène Bérubé.
Avec l’exécutif, qui avait pris place au premier rang, on remarquait
aussi MM. Antonio Théberge, Roland Ouellet et Mlle Éliane Ouellet,
du magasin coopératif, MM. Raynald Thibault et André Ouellet,
préposés à la meunerie coopérative.
L’actif s’élève à 125 991,95 $ et le capital payé par les sociétaires à 25 118,98 $, avec une réserve générale de 36 630,68 $, prouvant la vitalité de l’entreprise. L’assemblée vota une ristourne de 4,4 % aux sociétaires sur leurs achats de l’année. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6510
15 septembre 2022
Signatures à Saint-Mathieu-de-Rioux
Depuis quelques mois, les Archives nationales du
Québec ont numérisé les fichiers d’avant 1900 concernant les
registres de l’état civil de Saint-Mathieu-de-Rioux. On y trouve
désormais les actes de baptême, de mariage et de sépulture depuis
l’ouverture des registres paroissiaux de cette paroisse en 1866
jusqu’à décembre 1918.
J’ai fait une étude rapide et sans prétention
de l’évolution de la signature des parrains, des marraines et
des pères lors des baptêmes. Dans les années d’unité 7, j’ai relevé
le nombre de signatures lors des 10 premiers baptêmes de l’année.
Quand une personne ne signe pas, il est clairement indiqué dans le
registre qu’elle ne sait pas signer.
Note 1. Vingt-huit marraines sur 60 ont signé, soit
47 %.
Note 2. Dix-neuf parrains sur 60 ont signé, soit 32
%.
Note 3. Dans les 60 baptêmes, le père a été présent
30 fois, soit 50 % du temps.
Note 4. Quinze pères sur 30 ont signé, soit 50 % des
pères présents.
Voici un tableau qui montre la répartition des
signatures de 1867 à 1917 :
À Saint-Mathieu-de-Rioux, le premier
défricheur s’est installé en 1830. Les premières écoles sont
apparues dans les années 1860. Dans ce tableau, peu de personnes
savent signer en 1867 et 1877. Par la suite, on remarque une légère
augmentation.
Note
particulière. Je ne connais pas les raisons pourquoi
autant de pères étaient absents lors des baptêmes.
Note générale. Dans la période étudiée, à mesure que le temps avance, les signatures sont de plus grande qualité. C’est de moins en moins un dessin hésitant.
P. S. Ceci est mon 300e article sur Saint-Mathieu-de-Rioux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6495
6 septembre 2022
Nouvelles de 1963
Dans le Progrès du Golfe du 1er février 1963, on
peut lire des nouvelles concernant Saint-Mathieu-de-Rioux.
Statistiques
Les 164 familles de la paroisse totalisent 1125 personnes, dont 910
communiants. Trois-cent-huit élèves fréquentent nos écoles, dont 136
garçons. Dix-neuf étudiants vont au Séminaire de Rimouski. En 1962,
il y eut 25 baptêmes, 13 mariages et 1 sépulture d'adulte.
Marguillier
M.
Joseph Bérubé a été élu marguillier en remplacement de M. Paul-Émile
Beaulieu. Il siégera avec MM. Magloire D'Anjou et Charles
Vaillancourt (rang 5).
Baptêmes
Marie-Suzanne, enfant de M. et Mme Henri Rousseau (Aline Caron).
Parrain et marraine, Mathieu Rousseau et Lucie Rioux, oncle et
tante.
Hélène, enfant de M. et Mme Gérard Ouellet (Germaine Parent).
Parrain et marraine, Rodrigue et Françoise Ouellet, cousin et sœur
de l’enfant.
Décès
Le
14 janvier, Berthilde, enfant de feu Benoit Boucher et de Mme
Boucher (Germaine Fournier), à l’âge de 7 ans. Les funérailles
eurent lieu à Saint-Mathieu, et l'inhumation à Saint-Simon dans le
lot familial.
Chez les dames rurales À la récente assemblée des dames de l’UCFR, M. le curé Gérard Cayouette parla de la mission de l’Église dans le temporel. Elle agit dans le temporel à la façon d’un ferment par l'annonce de l’Évangile, par les laïques qui sont appelés à exercer leurs activités de façon chrétienne. Il remercia le cercle du don d'un uniforme d’ambulancier Saint-Jean. La soirée, des plus intéressantes, se termina par un tirage qui favorisa Mme Maurice Théberge. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6480
21 juin 2022
Baptêmes en 1962
Le
Progrès du Golfe publie la liste de 13 enfants qui ont reçu
le baptême à l’église Saint-Mathieu au cours de l’année 1962.
-
Marie-Lucie-Diane, enfant de M. et Mme Raymond Girouard (Jeannine
Caron). Parrain et marraine, M. Léonard Caron et Mlle Lucie Rioux.
-
Marie-Sonia, enfant de M. et Mme Antoine Ouellet (Jacqueline
Lepage). Parrain et marraine, M. Oliva Ouellet et Mlle Marie-Anne
Vaillancourt.
-
Marie-Maude, enfant du M. et Mme Paul Plourde (Lucienne Rousseau).
Parrain et marraine, M. et Mme Charles Plourde (Rose Gagné),
grands-parents de l'enfant. (Progrès du Golfe, 11 mai 1962)
-
Gilbert, enfant de M. et Mme Raynald Vaillancourt (Laurianne
Berger). Parrain et marraine, Émile Berger et Bernadette D'Astous,
oncle et tante.
-
Cécile-Pierrette, enfant de M. et Mme Mathieu Rousseau (Lucie
Rioux). Parrain et marraine, Louis Lavoie et Cécile Rousseau, oncle
et tante.
-
Suzie, enfant de M. et Mme Roger Jean (Armande Roy). Parrain et
marraine, Hector Roy et Blanche Bélanger, grands-parents.
-
Marlène-Josée, enfant de M. et Mme Léonard Ouellet (Olivette
Sirois). Parrain et marraine, Robert Simard et Véronique Ouellet,
oncle et tante.
-
Yvan, enfant de M. et Mme Maurice Ouellet (Bernadette Beaulieu).
Parrain et marraine, Philippe Ouellet et Marianna Parent,
grands-parents.
-
René, enfant de M. et Mme Paul-Émile Bérubé (Gabrielle Théberge).
Parrain et marraine, Antonio Théberge et Gertrude Thériault, oncle
et tante.
-
Pierrette, enfant de M. et Mme Patrice Bérubé (Suzanne Jean).
Parrain et marraine, Edmond Jean et Marie-Laure Théberge,
grands-parents.
-
Véronique, enfant de M. et Mme Charles Beaulieu (Thérèse Fournier).
Parrain et marraine, Valmont Coulombe et Simone Fournier, oncle et
tante.
-
Urbain-Guy, enfant de M. et Mme Amédée Beaulieu (Gaétane Denis).
Parrain et marraine, Normand Lagacé et Gilberte Beaulieu, oncle et
tante.
Le
10e enfant M. et Mme Camille Saindon (Simone Lévesque) comptaient, le 15 août, un dixième enfant, José-Line, qui fut baptisée en l’église de Saint-Mathieu le 18 août. Elle eut pour parrain et marraine, M. et Mme Jean-Eudes Dionne, de la paroisse. Mlle Louisette Saindon portait sa sœur sur les fonts baptismaux. C’est la troisième naissance de la famille Saindon enregistrée un 15 août. Raynald, 16 ans, Denis, 4 ans, et José-Line, la benjamine née le 15 août dernier. (Progrès du Golfe, 21 septembre 1962) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6475
18 juin 2022
Réunion de la Coop
Dans son édition du 30 mars 1962, le Progrès du Golfe fait un
compte-rendu d’une assemblée générale où étaient présents les
membres de la Coopérative Agricole de Saint-Mathieu.
« Le jeudi 14 mars dernier, les membres de la Coopérative Agricole
de Saint-Mathieu, sous la présidence de M. Georges Théberge, se
réunissaient pour la tenue de leur assemblée générale annuelle.
Le
rapport financier fut présenté aux membres par M. Gabriel Belzile,
agronome vérificateur des comptes de cette société. D'après ce
rapport, la coopérative a réalisé un chiffre d'affaires de 229 251
$, dont 107 687 $ au magasin et 121 564 $ â la meunerie. La part des
membres dans ce chiffre d'affaires fut de 178 523 $ ou 78 % du
total.
Le
bilan de la Société indique un actif de 125 124 $ avec un passif de
70 000 $. Le capital payé par les membres est de 22 807 $. Les
réserves et excédents s'élèvent à 32 252 $.
Les directeurs élus pour l’année 1962 sont MM. Georges Théberge,
Gérard Ouellet, Adrien Ouellet, Maurice Plourde et Antoine Beaulieu.
Allocutions
L’agronome du comté, appelé à prendre la parole, félicita les
administrateurs et les membres. Il leur parla de la nécessité de
produire le plus possible pour nourrir leurs animaux. La mauvaise
récolte des provinces de l’Ouest est la cause de la hausse du prix
des grains et moulées. Les cultivateurs seraient bien avisés
d'augmenter leurs ensemencements de céréales afin de compter un peu
moins sur les importations de l’Ouest.
Par ailleurs, les animaux d’engraissement, comme les porcs et les
volailles, gardées pour la ponte ou la production de la chair,
devraient être choisis avec soin dans les lignées les plus
économiques. En effet, l’enregistrement supérieur ou R. O. P. permet
de choisir les lignées les plus avantageuses.
M.
Paul Plourde, agronome représentant les abattoirs Legrade Ltée,
exposa le plan d’intégration du porc. Il expliqua les avantages de
bénéficier de cette aide offerte par la Coopérative Fédérée, qui
permet de régulariser la production et qui diminue les risques.
M. l'abbé Cayouette, curé de la paroisse, encouragea les cultivateurs à travailler ensemble pour mieux réussir dans leurs entreprises. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6470
15 juin 2022
Baptêmes de
1960
Le
Progrès du Golfe publie la liste de 17 enfants qui ont reçu
le baptême à l’église de Saint-Mathieu au cours de l’année 1960.
-
Marie-Sylvie, fille de M. et Mme Lucien Ouellet (Albina D'Auteuil).
Parrain et marraine, Vincent Ouellet et Lisette Ouellet, frère et
sœur de l'enfant.
-
Francis, enfant de M. et Mme Louis Bérubé (Marianne Paradis).
Parrain et marraine, Léon Bérubé et Isabelle Pelletier, oncle et
tante. (Progrès du Golfe 4 mars 1960)
- Marie-Line, enfant de M. et
Mme Clément Jean (Simone Paradis). Parrain et marraine, M. et Mme
Joseph Jean, grands-parents.
- Pierre, enfant de M. et Mme
Charles Vaillancourt (Hélène Plourde). Parrain et marraine,
Rodolphe Ouellet et Adrienne Vaillancourt, oncle et tante.
- Marie-Louise, enfant de M.
et Mme Lorenzo Dionne (Yvette Gaudreau). Parrain et marraine. M. et
Mme Arthur Gaudreau, grands-parents.
- Marie-Chantal, enfant de M.
et Mme Gilbert Jean (Martine Ouellet). Parrain et marraine, M. et
Mme Étienne Ouellet, grands-parents.
- Marie-Claudine, enfant de M.
et Mme Adrien Ouellet (Marie Ouellet). Parrain et marraine, M. et
Mme Gilbert Jean, oncle et tante.
- Paul-André, enfant de M. et
Mme Gérard Gagnon (Albina Rioux). Parrain et marraine, Jean-Paul et
Thérèse Gagnon, frère et sœur de l'enfant.
- Denis, enfant de M. et Mme
Clément Rioux (Claudette D'Astous). Parrain et marraine. M. et Mme
Armand Rioux, grands-parents.
- Christine, enfant de M. et
Mme Emmanuel Bérubé (Germaine Jean). Parrain et marraine, M. et Mme
Arsène Dubé, oncle et tante.
-
Marie-Line-Danielle, enfant de M. et Mme Léopold Jean (Marie-Paule
Saindon). Parrain et marraine, M. et Mme Ernest Simon, de
Saint-Eugène de Ladrière, oncle et tante. (Progrès du Golfe,
23 septembre 1960)
-
Marie-Guylaine, fille de M. et Mme Raymond Lagacé (Bernadette
Ouellet). Parrain et marraine, Donat Lagacé et Thérèse Beaulieu,
oncle et tante.
-
Marie-Linda, enfant de M. et Mme Jean-Paul Rioux (Yolande Parent).
Parrain et marraine, Léonard et Antoinette Parent, de
Trois-Pistoles, oncle et tante.
-
Marie-Normande-Doris, enfant de M. et Mme Normand Lagacé (Gilberte
Beaulieu). Parrain et marraine, Louis-Jacques Beaulieu et Ézilda
Lagacé, grands-parents.
-
Joseph-Michel, fils de M. et Mme Antonio Fournier (Cécile Bernier).
Parrain et marraine, Ghislain et Jocelyne Fournier, frère et sœur de
l’enfant.
-
Joseph-Daniel-Mario, enfant de M. et Mme Romuald Plourde (Marie-Rose
Lavoie). Parrain et marraine, Fernando Gagnon et Maria Plourde.
- Marie-Roselle-Linda, fille de M. et Mme Simon Plourde (Anne-Marie Beaulieu). Parrain et marraine, Mathieu Beaulieu et Aline Belzile, oncle et tante. (Progrès du Golfe, 4 novembre 1960) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6455
6 juin 2022
Nouvelles de 1961
En
1961, le Progrès du Golfe a publié trois articles sur
Saint-Mathieu : 10 mars, 28 avril et 18 août.
Réussite du carnaval
Le carnaval d’hiver de
St-Mathieu a remporté un éclatant succès. Les diverses
manifestations furent présidées par la Reine du Carnaval, Sa Majesté
Bernadette 1ère, dont l’escorte royale était formée du
prince consort, M. Maurice Ouellet, des duchesses Gaétane Dionne et
Madeleine Ouellet, accompagnées de MM. Odilon Ouellet et Norbert
Rousseau.
Le défilé parcourut les rues
du village précédé du bonhomme carnaval (M. Jean-Eudes Dionne) et du
maire Son Honneur M. Réal Dionne. La foule se rassembla ensuite à la
patinoire locale pour diverses compétitions sportives. Il y eut
partie de ballon-balai, joute de hockey entre jeunes et aînés,
course en patins, sauts en hauteur, défilé des majorettes,
souque-à-la-corde.
Après quoi, l’assistance se
rendit à la salle paroissiale pour une soirée récréative où les
vainqueurs des divers tournois reçurent trophées et prix. C’est là
que la reine du Festival de 1960, Mlle Yvonne Ouellet remit à Mlle
Bernadette Beaulieu les emblèmes de la royauté. Il y eut ensuite
goûter agrémenté de musique.
Le président de l’OTJ exprima
ses remerciements à tous ceux qui avaient participé de près ou de
loin au succès de ce carnaval. Un cadeau fut ensuite offert à la
reine, Mlle Beaulieu, et à ses duchesses. (Progrès du Golfe,
10 mars 1961)
Décès de Lucien Rousseau
Le 15 avril, décédait, à l’âge
de 29 ans, M. Lucien Rousseau, fils de M. et Mme Omer Rousseau
(Alice Bélanger). Outre ses parents, lui survivent ses frères André,
Julien, Norbert, Martin, de Saint-Mathieu ; ses sœurs Mme Étienne
Plourde (Madeleine), de Saint-Robert-Bellarmin, Mme Paul Plourde
(Lucienne), de Saint-Mathieu, Mme Amédée Beaulieu (Marie-Marthe), de
Rivière-du-Loup, Mlle Juliette Rousseau, i. l., de
Thetford-les-Mines.
Ses funérailles eurent lieu,
le 18 avril, en l'église paroissiale, en présence de nombreux
parents et amis. M. l’abbé Gérard Cayouette officiait au service
funèbre. Il était assisté de MM. les abbés Hermel Pelletier, de
Saint-Simon, et Jean-François Drapeau, de Saint-Fabien. La croix
était portée par M. Emmanuel Rousseau et le cercueil par MM. Odilon
Ouellet, Conrad Plourde, Rose-Albert Rousseau, Oneil Rousseau,
Adéodat Vaillancourt et Guy Plourde.
Le deuil était conduit par la
plupart des parents ci-dessus nommés ainsi que par M. et Mme Hervé
Rousseau, de Québec, M. Thomas Bélanger, de Saint-Jean de Dieu, M.
David Parent, Mlle Alice et M. Roland Parent, de Sainte-Françoise,
M. et Mme Roger Desjardins, de Notre-Dame du Sacré-Cœur, Mme Eugène
Drapeau, de Saint-Jean de Dieu. (Progrès du Golfe, 28 avril
1961)
Complément.
Lucien Rousseau est né le 5 mai 1931. Son père Omer
Rousseau est né le 2 janvier 1905. Il a épousé Alice Bélanger le 8
février 1928 à Saint-Jean-de-Dieu. Les parents d’Omer sont Désiré
Rousseau et Caroline Drapeau.
Noces d’argent de Victor
Parent
Le 23 juillet, M. et Mme
Victor Parent (Anne-Marie Fournier), qui comptaient 25 ans de
mariage, furent l’objet d’un repas familial pour souligner ce jubilé
d’argent, à la résidence de leur fille Mme Réal Rioux (Nicole).
Son Excellence Mgr C.-E. Parent, archevêque de Rimouski, M. l’abbé Léonard Parent, frères du jubilaire, étaient présents ainsi que M. et Mme Donat Bérubé, Mme Patrice Fournier. M. et Mme Louis-Jacques Roy, M. et Mme Amédée Jean, M. et Mme Joseph Bérubé, M. et Mme Louis Parent, M. et Mme Gérard Ouellet, Me Louis Fournier, Mme Gérard Parent ainsi que les enfants des jubilaires. Il y eut hommages et vœux ainsi que présentation de cadeaux durant la soirée qui suivit. (Progrès du Golfe, 18 août 1961) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6450
3 juin 2022
Baptêmes de 1959
Le
Progrès du Golfe publie la liste de 17 enfants qui ont reçu
le baptême en l’église Saint-Mathieu au cours de l’année 1959.
-
Carol, enfant de M. et Mme Omer Beaulieu (Marie-Ange Plourde).
Parrain et marraine, Antoine Beaulieu et Cécile Jean, oncle et tante
de l’enfant.
-
Marcel, enfant de M. et Mme Léonard Fournier (Brigitte Jean).
Parrain et marraine, Conrad Beauchêne et Magella Jean, de St-
Fabien, oncle et tante.
-
Linda, enfant de M. et Mme Clément Bérubé (Cécile Beaulieu). Parrain
et marraine, Léon Bérubé et Isabelle Pelletier, oncle et tante.
-
Mario, enfant de M. et Mme Charles Beaulieu (Thérèse Fournier).
Parrain et marraine, Bertrand et Marie-Marthe Beaulieu, oncle et
tante. (Progrès du Golfe 13 mars 1959)
–
Marie-Chantal, enfant de M. et Mme Maurice Plourde (Jeanne Ouellet).
Parrain et marraine, Étienne Plourde et Madeleine Rousseau, oncle et
tante. Porteuse, Mlle Gilberte Plourde.
-
Marie-Arianne, enfant de M. et Mme Paul Plourde (Lucienne Rousseau).
Parrain et marraine, Omer Rousseau et Alice Bélanger,
grands-parents.
-
Marie-Nicole, enfant de M. et Mme Romuald Plourde (Marie-Rose
Lavoie). Parrain et marraine, Désiré Lavoie et Joséphine Bélanger. (Progrès
du Golfe 8 mai 1959)
- Joseph-René, enfant de M. et
Mme Lionel Lagacé (Béatrice Rioux). Parrain et marraine, Laurent
Rioux et Gabrielle Rioux, de Trois-Pistoles, oncle et tante.
- Jean-Guy, enfant de M. et
Mme Mathieu Rousseau (Lucie Rioux). Parrain et marraine, Omer
Thibault et Agnès Rousseau, oncle et tante.
- Gérald, enfant de M. et Mme
Roger Ouellet (Gemma Thibault). Parrain et marraine, Raynald
Thibault et Rita Saindon, oncle et tante. Porteuse, Mme Auguste
Thibault, grand-maman.
- Marie-Renée Donate, enfant
de M. et Mme André Fournier (Rosanne Bélanger). Parrain et
marraine. Antonio Fortin et Germaine Bélanger, de Saint-Fabien,
oncle et tante. Porteuse, Jeanne D’Arc Fortin. (Progrès du Golfe
12 juin 1959)
-
Pauline, fille de M. et Mme Rosario Fournier (Germaine Gagnon).
Parrain et marraine. Charles et Jeanne Gagnon.
-
Jean-Claude, enfant de M. et Mme Jean-Eudes Dionne (Cécile
Gaudreau). Parrain et marraine. Lionel Jean et Valérie Dionne, oncle
et tante.
- Marie-Andrée, enfant de M.
et Mme Louis Ouellet (Huguette Bouchard) de Labrieville. Parrain et
marraine. Maurice Plourde et Jeanne Ouellet, oncle et tante de
l’enfant.
- Yves-Marie, enfant de M. et
Mme Marcel Jean (Thérèse Bélanger). Parrain et marraine. Robert
Belzile et Éliane Bélanger.
- Jean-Roch, enfant de M. et
Mme Antoine Beaulieu (Cécile Jean). Parrain et marraine. Oscar
Bélanger et Éliane Jean, oncle et tante.
- Joseph-Langis, enfant de M. et Mme Léopold Gaudreau (Denise Dionne). Parrain et marraine. Arthur Gaudreau et Marie-Ange Ouellet, grands-parents. (Progrès du Golfe, 9 octobre 1959) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6445
30 mai 2022
Le cercle
Lacordaire
Au cours de l’année 1961, le Progrès du Golfe
s’est intéressé au cercle Lacordaire de Saint-Mathieu-de-Rioux. Il a
publié un article le 17 mars et un autre le 29 septembre 1961.
Auprès de l’exécutif diocésain
« M. Charles Vaillancourt, M. E. L. de Saint-Mathieu vient d’être
nommé vice-président des Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc
auprès de l’exécutif diocésain de Rimouski.
Lacordaire depuis mars 1946, M. Vaillancourt a été élu directeur du
cercle de Saint-Mathieu en 1947 ; il exerça ce poste jusqu’en 1951.
Son apostolat Lacordaire se manifesta surtout par des contacts
individuels. Il travailla toujours dans l’esprit du mouvement et
savait défendre ses convictions.
En
janvier 1960, il accepta la présidence du cercle de sa paroisse ;
par la suite, il se vit attribuer en février dernier le titre de
vice-président diocésain pour remplacer M. Julien Boisclair de
Mont-Joli qui accéda au Conseil central. » (Progrès
du Golfe, 17 mars 1961)
Quinzième anniversaire
« Le 15e
anniversaire des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc à
Saint-Mathieu fut rehaussé par la présence du chef spirituel du
diocèse, Son Excellence Mgr C.-E. Parent, archevêque de Rimouski,
fils de la paroisse.
Quarante-deux abstinents,
fidèles à la doctrine Lacordaire, furent honorés par le Centre
Diocésain, lors de ces manifestations en recevant un diplôme
d’honneur de longue observance. Nommons le maire de Saint-Mathieu,
M. Réal Dionne, le président régional, M. Adrien Ouellet et Mme
Ouellet, le président fondateur M. Antonio Théberge, le
vice-président M. Charles Vaillancourt, et son épouse, Mlle Éliane
Ouellet, vice-présidente, Mme Maurice Théberge, Mme Raoul Vignola,
directrices.
La soirée de clôture mettait
fin à la semaine antialcoolique dans la région de Trois-Pistoles.
Deux messes avaient été célébrées, le matin. M. l’abbé Pierre
Bélanger, aumônier diocésain, fit le sermon. Les Jeunes Abstinents
furent convoqués, dans l’après-midi, à un ralliement général.
Après la bénédiction du
cimetière et du calvaire par Mgr l’Archevêque, il y eut heure
d’adoration prêchée par l’aumônier diocésain avant la soirée
récréative du 15e anniversaire. La chorale mixte de la
paroisse exécuta plusieurs chants de circonstance pour les noces de
cristal du cercle paroissial Lacordaire.
M. Antonio Théberge fit
l’historique comme président-fondateur du cercle qui compte
maintenant 123 Jeanne D’Arc et 116 Lacordaire. Un succulent buffet
froid fut servi à tous au couvent paroissial. » (Progrès
du Golfe, 29 septembre 1961)
Note 1. Le président du cercle
Lacordaire était M. Raynald Thibault et la vice-présidente, Mme
Magloire D’Anjou.
Note 2. On compte 239 adultes dans les deux cercles : Lacordaire et Ste-Jeanne d’Arc. La population de Saint-Mathieu-de-Rioux était alors de 1113 habitants. C’est presque toute la population adulte de la paroisse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6430
21 mai 2022
Nouvelles de 1960
À cinq occasions en 1960, le Progrès du Golfe a publié des
nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux.
Chez les Lacordaire
Lors de l'assemblée générale des cercles d'abstinents de la
paroisse, on a fait le choix des officiers pour 1960-61. M. Charles
Vaillancourt jr a été choisi président, M. Antonio Théberge,
vice-président, Rénald Thibault, Antonio Fournier, Patrice Roy,
Raoul Vignola, directeurs. Mme Magloire D'Anjou dirigera les
destinées du Cercle Sainte-Jeanne d’Arc comme présidente. Elle a
pour adjointes Mlle Éliane Ouellet, vice-présidente, Mlle Rachel
Théberge, Mme Georges Théberge, Mme Joseph Rioux, Mme Maurice
Théberge, directrices.
La causerie fut donnée par Mlle Monique Belzile, institutrice, qui
insista sur la nécessité de la sobriété en toute circonstance. M.
Jérôme Bouffard traita de l'alcoolisme, de ses méfaits, ajoutant que
le mouvement Lacordaire, qui s’appuie sur les vertus de courage et
de charité, est tout désigné pour aider les victimes à acquérir des
habitudes de sobriété, encourager les sobres à persévérer et
propager partout les avantages de la tempérance en tout et partout.
(Progrès du Golfe, 4 mars 1960)
Carnaval d’hiver
Pour la première fois, dans les annales de St-Mathieu, un festival
d’hiver a été organisé. Il a remporté un succès qui dépasse toutes
les prévisions. M. le curé Gérard Cayouette en était l’animateur en
coopération avec plusieurs de ses ouailles.
Malgré une température inclémente, le 28 février, une foule
nombreuse se rendit à la patinoire de la paroisse pour assister aux
diverses compétitions sportives entre jeunes et moins jeunes de la
localité. Le couronnement de Sa Majesté Rachel 1ère se
fit ensuite à la salle paroissiale avant le repas canadien offert à
la nombreuse assistance.
Un orchestre formé d'artistes de Rimouski était au programme
récréatif. Les emblèmes de la royauté furent présentés à Sa Majesté
Rachel 1ère par l’une de ses duchesses Gabrielle
Gaudreau. Il y eut ensuite distribution des prix aux vainqueurs des
jeux sur glace : patinage de vitesse, course en traîneaux, sauts en
hauteur, mascarade, course à pieds. Mlle Yvonne Ouellet faisait
partie aussi du cortège royal avec le prince consort Réginald
Létourneau et les intendants Oneil Rousseau et Mathieu Ouellet. (Progrès
du Golfe,
11 mars 1960)
L’ouverture de la semaine antialcoolique fut soulignée dans la
paroisse, le 25 septembre, par une soirée qui réunissaient des
abstinents et sympathisants de Sainte-Françoise, Saint-Simon,
Trois-Pistoles et Saint-Mathieu. La salle paroissiale était remplie
à sa capacité. Après la causerie de M. Bélanger, il y eut chants,
allocution de M. le curé Gérard Cayouette et adhésion de nouveaux
membres. (Progrès du Golfe, 7 octobre 1960)
Consécration de l’église
Une impressionnante cérémonie liturgique s’est déroulée à
Saint-Mathieu le 21 septembre, jour de la fête du patron de la
paroisse.
Son Exc. Mgr C.-E. Parent, archevêque de Rimouski, présida dans
l’après-midi en présence de nombreux fidèles, la cérémonie de
consécration de l’église paroissiale. Plusieurs membres du clergé
diocésain l’accompagnaient dont le pasteur de Saint-Mathieu M.
l’abbé Gérard Cayouette. Son Excellence était assistée, pour
accomplir les rites d’usage, de M. le chanoine Louis-David-Rioux,
curé de Trois-Pistoles et de M. le chanoine Félix Jean, aussi de
Trois-Pistoles. Agissaient comme diacre et sous-diacre d’honneur M.
le chanoine Raoul Thibault, du Séminaire diocésain, et M. l’abbé
Rosaire Dionne, un fils de la paroisse. (Progrès du Golfe, 7
octobre 1960)
Quarante-Heures Les fidèles ont suivi avec piété les exercices des Quarante-Heures prêchés par le R. P. G. Hébert, s. j., de Rimouski. (Progrès du Golfe, 4 novembre 1960) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6425
18 mai 2022
Deux décès en 1960
En
1960, le Progrès du Golfe a fait mention dans ses pages de
deux décès, l’un dans l’édition du 23 septembre et l’autre dans
celle du 23 décembre.
Décès de Félix Rioux
Un
citoyen avantageusement connu, M. Félix Rioux, est décédé à
Saint-Mathieu le 14 septembre, à l'âge de 74 ans. Il laisse, dans le
deuil, outre son épouse (Alice Lagacé), trois fils et neuf filles :
M. l'abbé Roland Rioux, curé de Saint-François-Viger, MM. Armand et
Marcel Rioux, Mme Amédée Dionne (Yvonne), Mme François Côté
(Blanche), de Saint-Mathieu, Mme Amédée Rioux (Marie), de Rimouski,
Mme Roland Verrier (Cécile), de Drummondville, Mlle Modeste Rioux,
de Drummondville, Mme Léonard Lagacé (Odile), de
Saint-Robert-Bellarmin, Mme Romuald Rioux (Florence), de Hauterive
, Mlle Marielle Rioux, de Drummondville.
Lui survivent aussi ses frères
Omer, de Saint-Guy, Joseph, de Saint-Mathieu, Charles, de Winnipeg,
Paul et Alphonse, de Trois-Pistoles ; ses sœurs Mme Charles-Hermel
Jean de Saint-Mathieu, Mme Philéas Bélanger, de Trois-Pistoles.
Ses funérailles, qui furent
imposantes, eurent lieu samedi, le 17 septembre. M. l'abbé Rioux
officiait au service funèbre de son père. Il était assisté des abbés
Robert Lebel et Sylvio Lévesque, comme diacre et sous-diacre.
M. l'abbé Gérard Cayouette
présida la levée du corps. La croix fut portée par M. Roland Côté et
le cercueil par MM. Alain Dionne, Gervais et Julien Dionne, Clément
et Yvon Rioux, Florian Bérubé.
Outre Mgr Eudore Desbiens et le chanoine Émile Guimont de
l’Isle-Verte, 21 prêtres avaient pris place au chœur. (Progrès du
Golfe, 23 septembre 1960)
Complément.
Félix Rioux est né le 20 novembre 1885. Il a épousé Alice Lagacé le
22 novembre 1910. Il est le fils de Narcisse Rioux et d’Arthémise
Jean. Narcisse est né le 18 février 1858 et est décédé le 10 février
1835. Arthémise est née le 13 janvier 1867 et est décédée le 10
novembre 1953.
Décès de dame Alfred Vaillancourt
Le
9 décembre, en l’église de Saint-Mathieu, en présence de nombreux
parents et fidèles, eurent lieu les obsèques de Mme Alfred
Vaillancourt (Philomène Morin) décédée à sa résidence à l’âge de 87
ans.
M.
le curé Gérard Cayouette officiait au service funèbre. Il était
assisté des abbés Oscar Thibault, curé de Saint-Eugène-de-Ladrière,
et l’abbé Jean-François Drapeau, vicaire à Saint-Fabien. La croix
était portée par M. Adrien Ouellet et le cercueil par MM. Clément,
Roland, Fernand et Ovila Vaillancourt, Rénald et Gilles Ouellet,
tous petits-fils de la défunte.
La
bannière était portée par MM. Philippe et Albert Ouellet et les
rubans par Mmes Armand Rioux, Albert Ouellet, Alfred Bérubé et Félix
Rioux. M. l’abbé Hermel Pelletier, curé de Saint-Simon, avait pris
place dans le chœur.
La
défunte laisse ses fils et filles, Joseph, Hermel, Félix, Charles et
Roger Vaillancourt de Saint-Mathieu, Lisa, Emma, Éva, Alice, Jeanne
et Émilienne. (Progrès du Golfe, 23 décembre 1960)
Complément. Philomène Morin est née le 2 septembre 1873. Elle épouse Alfred Vaillancourt le 9 février 1891 à Saint-Mathieu. Elle est la fille de Michel Morin et d’Éliza Pelletier qui se sont mariés le 13 juillet 1863 à Saint-Arsène. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6420
15 mai 2022
Nouvelles de 1959
À quatre occasions en 1959, le
Progrès du Golfe a publié des nouvelles sur
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Décès d’Alfred Bérubé
Le
6 janvier, est décédé à Saint-Mathieu, M. Alfred Bérubé, époux
de Dame Aimée Ouellet. Il était âgé de 67 ans. Ses funérailles
ont eu lieu en l’église paroissiale en présence de nombreux
parents et fidèles.
Le défunt, qui était
avantageusement connu, laisse, outre son épouse, deux fils MM.
Émile Bérubé, de Saint-Mathieu, Réal Bérubé, de Rimouski ; ses
belles-filles, Mme Émile Bérubé (Gabrielle Théberge) et Mme Réal
Bérubé (Jeanne Lagacé). Il était le frère de MM. Ofter Bérubé,
de Saint-Mathieu, Fabien Bérubé, de Saint-Fabien, Auguste
Bérubé, de Saint-Mathieu, Mme Arthur Lagacé (Emma), mairesse de
Saint-Narcisse, Mme Sirois (Mérilda) de Saint-Médard. (Progrès
du Golfe, 16 janvier 1959)
De
retour
M.
et Mme Onésime Dionne et leur fille Claudine sont revenus d’un
séjour de quelques semaines en Floride. (Progrès du Golfe,
13 mars 1959)
Coopérative agricole
La
Coopérative Agricole de Saint-Mathieu a réalisé, au cours du
dernier exercice, un chiffre d'affaires de 213 202 $, soit une
augmentation de 31 000 $ sur l'année précédente. L’actif de
l’entreprise s’établit à 97 434 $. La répartition des ventes
dans les trois départements s'établit ainsi : 96 852 $ au
magasin de consommation, 73 306 $ à la meunerie et 43 044 $ aux
consignations d’animaux vivants. Les opérations ont laissé un
surplus net de 8991 $, ce qui a permis de distribuer des
ristournes aux membres coopérateurs, une centaine.
Visite
M.
l’abbé André Caron, de Saint-Alexis, était en visite au
presbytère, récemment.
Assemblée Lacordaire
M.
Maurice Martin était le conférencier invité à la dernière
assemblée Lacordaire. Il y eut changement de décorations de 10
et 5 ans et initiation de nouveaux membres. La partie récréative
combla de joie le nombreux auditoire, notamment la pièce
organisée par Mme la présidente, l’exécution de mélodies sur
accordéon par la jeune Ginette Létourneau. (Progrès du Golfe
8 mai 1959)
Bénédiction de l’orgue
Son Excellence Mgr C.-E. Parent, archevêque de Rimouski, a
béni, dimanche au soir de la fête du Sacré-Cœur, les nouvelles
orgues de Saint-Mathieu, sa paroisse natale. Plusieurs membres
du clergé avaient pris place au chœur dont deux fils de la
paroisse les abbés Léonard Parent et Rosaire Dionne. Un récital
d’orgue fut donné à cette occasion par une personnalité du monde
musical canadien, M. Auguste Guillemette. Son Excellence, après
avoir félicité la population pour sa générosité à son église,
parla de son récent voyage ad limina à Rome. (Progrès du
Golfe, 12 juin 1959)
Mariages
A
été béni le mariage de M. Gilbert Jean, fils de M. et Mme Edmond
Jean et Mlle Martine Ouellet, fille de M. et Mme Étienne
Ouellet.
Sera béni le mariage de M. Benoît Charron, de l’Isle-Verte, fils
de M. et Mme Omer Charron et Mlle Gisèle Lagacé, fille de M. et
Mme Charles Lagacé, de Saint-Mathieu.
Départ du pasteur
Les paroissiens ont exprimé
leur gratitude et leurs vœux à leur pasteur depuis 10 ans, M.
l’abbé Alfred Bérubé qui les quittait pour assumer la cure de
Saint-Anaclet. La soirée d’hommages, le 27 septembre, rallia des
représentants de toutes les familles de la paroisse, même des
familles entières. M. l’abbé Rosaire Dionne, un fils de la
paroisse, lut l’adresse de circonstance. M. le curé Bérubé reçut
ensuite, comme don tangible de ses ouailles, une bourse de 1000
$.
Il y eut présentation d’un
Livre d’or de Saint-Mathieu. La première signature apposée au
bas de la miniature fut celle de l’abbé Bérubé, puis celle du
maire et des personnalités présentes à la soirée. M. Onésime
Dionne donna l’historique de la paroisse de Saint-Mathieu.
Des chants furent interprétés
par les étudiants et la chorale paroissiale. Tous furent ensuite
conviés à la résidence du maire Réal Dionne pour un buffet
froid.
Mardi, le 29 septembre, après la reddition des comptes de la
Fabrique, eut lieu la cérémonie d’installation du nouveau
pasteur, l’abbé Gérard Cayouette. (Progrès du Golfe, 9
octobre 1959)
Mariage double
M. et Madame Normand Lagacé (Gilberte Beaulieu), dont le mariage a
été béni, samedi, en l'église de Saint-Mathieu. À l’issue d’une
réception à l'Hôtel Canada de Trois-Pistoles, les nouveaux époux
partirent en voyage en Gaspésie. Au retour, ils ont élu domicile
à Saint-Mathieu. Le marié est le fils de M. et Mme Joseph
Lagacé, et la mariée, la fille de M. et Mme Louis-Jacques
Beaulieu.
En l'église de Saint-Mathieu, M. Gérard Beaupré, fils de Mme Joseph Beaupré, a épousé Mlle Bernadette Lagacé, fille de M. et Mme Joseph Lagacé, tous de Saint-Mathieu. Les nouveaux époux partirent en voyage dans la Gaspésie après une réception à l’Hôtel Canada de Trois-Pistoles. Ils résideront à Saint-Mathieu. (Progrès du Golfe, 16 octobre 1959) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6405
6 mai 2022
Nouvelles de 1958
Le
Progrès du Golfe du 14 février 1958 et du 28 février 1958
publie des nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux. Les voici :
Une assemblée Lacordaire
L’assemblée générale des cercles d'abstinents de St-Mathieu s’est
tenue dimanche, le 9 février, à la salle paroissiale,
M.
Roland Ouellet souhaita la bienvenue à l’assistance qui a applaudi
ensuite des artistes locaux dans l’interprétation de quelques
chants : MM. Adrien Ouellet, Maurice Théberge, Rénald Thibault.
On
procéda ensuite aux élections. M. Antonio Théberge fut élu président
pour succéder à M. Roland Ouellet, qui a assumé la vice-présidence à
la demande générale. Les directeurs élus sont MM. Magloire D’Anjou,
Lucien Ouellet, Joseph Rioux, Amédée Beaulieu, Antoine Fournier, ce
dernier représentant les Jeunes Abstinents.
La
présidence du Cercle des Jeanne d’Arc a été confiée à Mme Lucien
Ouellet qui remplacera Mlle Gisèle Théberge, sortant de charge, la
vice-présidence à Mlle Éliane Ouellet. Les conseillères élues furent
Mlle Martine Ouellet, Mmes Georges Théberge, Émilienne Parent, Raoul
Vignola, Rénald Thibault.
Avant la présentation de quatre films de court métrage, il y eut
changement de décoration de 1, 3, 5 et 10 ans plus adhésion de
plusieurs nouveaux membres. (Progrès du Golfe, 14 février
1958)
Décès de Félix Vaillancourt
À
St-Fabien est décédé, à l'âge de 83 ans et 2 mois, M. Félix
Vaillancourt, époux de feu Claudia Coubron. Ses imposantes
funérailles eurent lieu en l’église de St-Fabien, le 11 février, au
milieu d'une foule considérable de parents et d'amis. Le service fut
chanté par M. l'abbé Bernier, curé de la paroisse, assisté comme
diacre et sous-diacre par MM. les abbés Gauvin et D’Astous. Au
chœur, on remarquait : M. l'abbé Pelletier, curé de St-Simon.
La
croix était portée par M. Alphonse Michaud et le cercueil par MM.
Philippe Théberge, Alphonse Morais, Jean Philippe Cloutier,
Paul-Léon Belzile, Edgar Bellavance et Omer Rousseau. Le drapeau du
Sacré-Cœur était porté par M. Deslauriers Voyer et la quête fut
faite par MM. Alphonse Gagnon et Voyer.
M.
Vaillancourt laisse, pour pleurer sa perte, ses enfants : Mmes
Camille Bélanger (Marie- Ange), Cacouna, Wilfrid Desjardins
(Rose-Alma), Cacouna, Léo Plourde (Emilienne), de St-Mathieu,
Louis-Philippe Dionne (Bertha), de Trois-Pistoles, Roger Gaudreau
(Simone), de Trois-Pistoles. MM. Omer, de Rivière-du- Loup, Félix,
de Québec, Léo, de Cacouna, Henri, de St-Fabien : ses gendres, MM.
Camille Bélanger, Wilfrid Desjardins. Léo Plourde, Ls-Ph. Dionne,
Roger Gaudreau ; ses belles-filles, Mmes Omer, Félix, Léo et Henri
Vaillancourt ; son frère, M. Ernest Vaillancourt, de St-Mathieu.
Il laisse aussi beaucoup de neveux et nièces, petits-enfants, cousins et cousines. La sépulture eut lieu au cimetière de St-Mathieu où les dernières prières furent récitées par M. l’abbé Bérubé. La direction des funérailles avait été confiée à M. Hilaire Ouellet, de St-Fabien. (Progrès du Golfe, 28 février 1958) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6400
3 mai 2022
Nouvelles de 1957
Le Progrès du Golfe du 20 septembre 1957 publie des nouvelles
sur Saint-Mathieu-de-Rioux.
Baptême
Est baptisé Jeannot Ouellet, enfant de M. et Mme Albert Ouellet
(Jeannine D’Amours). Parrain, Trefflé Ouellet ; marraine, Éva
Vaillancourt, grands-parents. Porteuse, Mme Raymond Vaillancourt,
tante.
Mariage Létourneau-Dionne
Samedi, le 3 août, en l’église paroissiale, M. l'abbé Roland Rioux a
béni le mariage de son neveu M. Gervais Dionne, fils de M. et Mme
Amédée Dionne, et Mlle Fernande Létourneau, fille de M. et Mme
Héliodore Létourneau. Les nouveaux époux sont partis en voyage de
noces au Lac Saint-Jean, Chicoutimi et Québec après une réception à
l'Hôtel Canada, à Trois-Pistoles. Au départ, madame Dionne portait
un costume bleu paon, un chapeau de plumes même ton, accessoires
bruns et parure de vison brun. Au retour, ils résideront à
Saint-Mathieu.
Mariage Boucher-Fortin
Le 3 septembre a été béni le mariage de M. Noël Boucher, fils de M.
et Mme Ernest Boucher, de Saint-Fabien, avec Mlle Rose-Aline Fortin,
fille de M. et Mme Eugène Fortin, de Saint-Mathieu. Le nouveau
couple résidera à Rimouski.
Mariage Ross-Ouellet
Le 4 septembre, a été béni le mariage de M. Ulfranc Ross, fils de M.
et Mme Jean-Baptiste Ross, de Rimouski, avec Mlle Cécile Ouellet,
fille de M. et Mme Albert Ouellet, de Saint-Mathieu. Les nouveaux
époux demeureront à Rimouski.
Ours capturé
Un ours de 200 livres a été pris au piège sur le terrain de M.
Edmond Dionne.
Adieux du préfet de comté En ouvrant la séance (du Conseil de Comté de Rimouski), M. Onésime Dionne fit ses adieux et signa le procès-verbal de la dernière assemblée de juin. M. Chénard (le nouveau préfet) fut alors invité à prendre place sur la tribune d’honneur et à diriger les délibérations. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6395
30 avril 2022
Deux
décès en 1956
Deux décès sont communiqués par les journaux en 1956 concernant
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Voici les textes :
Jean-Baptiste Paradis
L’Action catholique
du 20 février 1956 annonce le décès de Jean-Baptiste Paradis, fils
de Joseph Paradis et de Lucrèce Michaud, de Saint-Mathieu.
« Le 19 janvier dernier, la
paroisse de Saint-Mathieu perdait l’un de ses doyens et plus estimés
citoyens en la personne de M. J.-B. Paradis, décédé à son domicile à
l'âge de 93 ans et 6 mois. Originaire de Saint-Mathieu où il demeura
toute sa vie, il prit une part active dans l’administration publique
en remplissant tour à tour les charges de conseiller municipal,
marguillier et commissaire d’écoles.
Il était l'époux de feue Mme
Géraldine Ouellet. Il laisse plusieurs enfants : MM. Charles,
Joseph, Arthur, Thomas Paradis, d’Hartford, Connecticut ; Mme Arthur
Boucher (Émilie), du même endroit ; MM. Ernest, de l’Ontario ;
Antoine, de Sainte-Françoise ; Alphonse, de Montréal, et Émile
Paradis, de Saint-Mathieu ; ses gendre et belles-filles : M. Arthur
Boucher et Mmes Thomas, Joseph, Arthur et Antoine Paradis, ainsi que
de nombreux petits-enfants. Un frère lui survit également, M. Jean
Paradis, de Saint-Narcisse, comté de Rimouski.
Ses funérailles eurent lieu le
23 janvier, à 9 heures, en l’église de Saint-Mathieu. La levée du
corps fut faite par M. l’abbé Alfred Bérubé, curé de la paroisse.
Officiait au service, M. l’abbé Élie Beaulieu, aumônier de la maison
N.-D. des-Anges, des Trois-Pistoles. Agissaient comme diacre et
sous-diacre, MM. les abbés Alfred Bérubé et Hermel Pelletier, curé
de Saint-Simon.
La croix était portée par M.
Joseph Paradis, de Sainte-Françoise, et le cercueil, par MM. Omer,
Philias, Lucien, Emmanuel Paradis et Louis Bérubé. La collecte, au
cours du service, fut faite par MM. Émile Théberge et Émile Ouellet.
Une foule de parents, d’amis et de concitoyens assistèrent aux
funérailles. L’inhumation eut lieu au cimetière paroissial. »
Eugène Vaillancourt
Le Soleil du 3 octobre 1956 annonce le décès d’Eugène
Vaillancourt, fils de Léon Vaillancourt et de Félécité Dionne.
« Nous apprenons la mort
soudaine d’un citoyen estimé de Québec dans la personne de M. Eugène
Vaillancourt, époux de dame Laura Théberge. Il habitait à 604,
Joffre depuis au-delà de 30 ans. M. Vaillancourt, chef d’une famille
distinguée, est le père de 20 enfants dont 14 lui survivent.
Natif de Saint-Mathieu,
Rimouski, il vint s’établir à Québec il y a plus de 33 ans. En 1931,
il entra au Ministère des Terres et Forêts, service de la
Protection, et devenait il y a quelques années surintendant du
garage du Service situé dans la rue Vallière.
M. Vaillancourt est décédé dans l’exercice de ses fonctions au cours d’un voyage d’inspection sur la côte-Nord. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6375
18 avril 2022
Nouvelles de 1953
En
1953, le Progrès du Golfe publie des nouvelles sur
Saint-Mathieu-de-Rioux. Les voici :
Baptême
A
été baptisé Joseph-Michel enfant de M. et Mme Lucien Vaillancourt
(Cécile Bérubé). Parrain et marraine M. et Mme Cyrice Bérubé, oncle
et tante de l'enfant. Porteuse Mme Eugène Moreau. (Progrès du
Golfe, 20 février 1953)
Partie de cartes
Dimanche le 15, à la salle paroissiale eut lieu une partie de cartes
organisée par le cercle Lacordaire au profit de la salle
paroissiale. Plusieurs prix ont été décernés, entre autres, trois
prix de présence, à M. Edmond Dionne un panier de provisions, à M.
Léopold Gaudreau et à M. Laurent Ouellet. (Progrès du Golfe,
20 février 1953)
Les jeunes éleveurs
Le
Cercle des Jeunes éleveurs de Saint-Mathieu vient de se réorganiser
avec seize membres actifs lors de l'assemblée au cours de laquelle
la somme de 134 $ fut distribuée en primes à ceux qui remportèrent
des prix lors de l’exposition locale.
L'exécutif du Cercle se compose de MM. Roland Dionne, président,
Laurent Ouellet, vice-président, Mlle Denise Dionne, secrétaire. Les
animateurs seront MM. Edmond Dionne, Gérard Gagnon et Philippe
Rioux.
M.
l'abbé Alfred Bérubé, curé, demeure l'aumônier du mouvement. (Progrès
du Golfe, 13 mars 1953)
Confirmation
Son Exc. Mgr Charles-Eugène
Parent a célébré, dimanche dernier, à Saint-Mathieu, sa paroisse, le
9e anniversaire de son élévation à la plénitude du
Sacerdoce, le 24 mai 1944, jour où il fut sacré évêque de Diana et
auxiliaire de Rimouski.
De nombreux membres du clergé
ont assisté à la manifestation de dimanche qui a coïncidé avec la
visite pastorale à Saint-Mathieu de Son Exc. Mgr C.-E. Parent,
maintenant archevêque de Rimouski. Mgr l’Archevêque avait confirmé
environ 200 enfants au cours de l'après-midi. Le soir, il y a eu
séance présentée en l’honneur de Son Excellence, par les élèves du
couvent paroissial.
Au premier rang de
l’assistance on remarquait Mme Louis Parent, mère de Son Exc. Mgr
l’Archevêque, et MM. les chanoines J. Gauvin, curé de Bic, Léo
Lebel, chancelier de l’Archevêché, René Roy, procureur, MM. les
abbés Élie Beaulieu, économe, Marius Côté, aumônier du secrétariat
de l’Enfance, Ls-Philippe Saintonge, aumônier de l’ Action
Catholique, Marcel Rioux, cérémoniaire, Lucien Rioux, professeur à
l’École d'Agriculture, Ls-David Rioux, curé de Trois-Pistoles,
Hermel Pelletier, curé de Saint-Simon, Benoit Lantagne, vicaire à
Trois-Pistoles, et Ulric Ouellet, vicaire à Bic.
Étaient également présents, le maire de la paroisse, M. Onésime Dionne, préfet du comté de Rimouski, plusieurs autres dignitaires et une assistance remplissant entièrement la salle. Mgr l’Archevêque a adressé la parole à ses anciens coparoissiens qu’il a assurés d'une place de prédilection dans son cœur paternel. (Le Soleil, 30 mai 1953) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6370
15 avril 2022
Nouvelles de 1952
En 1952, le Progrès du
Golfe a publié des nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux. Les
voici avec la date de parution :
Baptêmes
M. et Mme Édouard Bérubé
annoncent la naissance d’une fille sous les prénoms de Marie-Nicole.
Parrain et marraine, M. et Mme Hervé Bérubé de Saint-Simon, oncle et
tante de l’enfant. Porteuse, Mlle Thérèse Bérubé. (Progrès du
Golfe, 3 octobre 1952)
A été baptisé Marc-André, fils
de M. et Mme Omer Ouellet. Parrain et marraine, M. J.-Paul Ouellet
et Mlle Clarisse Ouellet, frère et sœur de l’enfant. Porteuse, Mme
Gérard Parent. (Progrès du Golfe, 3 octobre 1952)
Visite paroissiale
Dernièrement, M. le curé a fait sa visite paroissiale.
Voici le recensement de la paroisse : 1102 âmes réparties en 170
familles. (Progrès du Golfe, 3 octobre 1952)
Rues éclairées
Depuis jeudi soir dernier, le
village de Saint-Mathieu possède son système d’éclairage dans les
rues. (Progrès du Golfe, 3 octobre 1952)
Promenade
Mlle Jeannine Plourde qui
était en service à Rimouski est venue passer une semaine dans sa
famille. Actuellement, elle travaille à Saint-Simon. (Progrès du
Golfe, 19 septembre 1952)
Deux accidents
Samedi le 13 septembre 1952, à
Saint-Simon, une camionnette est allée frapper une autre camionnette
stationnée au bord de la route. Le conducteur M. Marcel Rioux ainsi
que Mlle Pierrette Plourde et Mme Léo Plourde, tous de
Saint-Mathieu, souffrent de légères blessures. (Progrès du Golfe,
19 septembre 1952)
M. Émile Paradis a capoté avec
son auto dans le chemin conduisant à Sainte-Françoise. Heureusement
il s'en est tiré indemne ainsi que son père M. J.-Baptiste qui
l'accompagnait. (Progrès du Golfe, 19 septembre 1952)
Service funèbre
Les funérailles de
Jean-Magloire D’Anjou ont eu lieu en l’église de Saint-Simon le 21
juin 1952. Il est décédé le 11 juin à l’âge de 75 ans. Conduisaient
notamment le deuil son fils, Magloire D’Anjou, son épouse Valentine
Dionne, de Saint-Mathieu, son petit-fils André D’Anjou. Parmi les
personnes qui assistaient aux funérailles, venant de Saint-Mathieu,
on remarquait le maire Onésime Dionne et Mme Dionne (Gratia
Ouellet), M. et Mme Désiré Dionne (Alice Caron), M. et Mme Roland
Dionne (Thérèse Théberge), M. et Mme Réal Dionne (Ida D’Auteuil), M.
et Mme Lucien Ouellet (Albina D’Auteuil), M. et Mme Maurice Théberge
(Lucille Lavoie), M. Adrien Ouellet, M. François Fournier, M. Émile
Lagacé, Mme Elzéar Ouellet (Rose Ouellet). (Progrès du Golfe,
27 juin 1952)
Réunions du conseil municipal
1. Lundi le 2 septembre, le
conseil municipal a tenu sa séance régulière. Le secrétaire, après
la lecture du procès-verbal, a présenté quelques comptes se
rapportant à la municipalité et à l’aqueduc, qui furent acceptés à
l’unanimité.
2. Lecture du référendum pour
la lumière dans les rues lequel fut accepté et on autorisa le
secrétaire à communiquer avec la Cie de Pouvoir pour conclure Ies
arrangements pour cette installation.
3. Autorisation fut aussi
donnée au secrétaire de communiquer avec le ministère de la Voirie
de Mont-Joli pour l’installation d’un câble métallique servant de
garde dans le chemin appelé route du moulin à farine.
4. Plainte a été faite à cette
occasion contre les personnes qui conduisent les animaux dans le
village et règlement a été passé que si les animaux salissent le
trottoir que le propriétaire devra le nettoyer le plus tôt possible.
(Progrès du Golfe, 19 septembre 1952)
Le 12 septembre, le conseil de Saint-Mathieu se réunit à nouveau en séance spéciale à 8 h 30 du soir pour donner avis de motion de passer un règlement d'emprunt pour la réparation du système d'aqueduc qui ne peut plus suffire à la dépense d’eau actuelle du village. (Progrès du Golfe, 19 septembre 1952) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6355
6 avril 2022
Nouvelles de 1949
Dans son édition du 29 juillet
1949, le Progrès du Golfe publie des nouvelles sur
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Mariage
Le 2 juillet, fut béni en
l'église de Saint-Mathieu le mariage de M. Antoine Beaulieu, fils de
M. Paul-Émile Beaulieu, et Mlle Cécile Jean, fille de M. Ch.-Hermel
Jean. Les chants de la cérémonie furent exécutés par les Enfants de
Marie.
Décès
Le 30 juin, est décédée à
Saint-Mathieu Mme Veuve François Ouellet (Odila Vaillancourt).
L’inhumation eut lieu au cimetière de l’endroit. Au service funèbre,
on remarquait au chœur plusieurs prêtres et, parmi l’assistance, un
grand nombre de parents et d’amis. (voir complément ci-dessous)
Soirée Lacordaire
Le 17 juillet, à la salle
paroissiale, les membres des Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne
d’Arc ont tenu une grande assemblée sous la présidence de M. Onésime
Dionne. Au cours de cette assemblée, il y eut initiation de nouveaux
membres et changement de décoration premier et deuxième degré.
La partie récréative fut
exécutée par la famille de M. Chalifour, agronome résidant à
l’Isle-Verte. Cette famille est réellement bien douée pour le chant
et le piano et les membres de nos Cercles souhaitent les revoir
encore.
Complément.
Odila Vaillancourt naît le 25 juin 1868. Elle est la fille d’Olivier
Vaillancourt et d’Hélène Émond. Elle décède à Saint-Mathieu-de-Rioux
le 29 juin 1949. Elle épouse François Ouellet, qui a 7 enfants, le
19 février 1895 à Saint-Mathieu-de-Rioux.
Le
couple a eu 11 enfants :
-
Rose-Alma, née le 6 décembre 1895, mariée à François-Xavier Bérubé.
-
Adélia, née le 15 janvier 1897, mariée à Eugène Jean.
-
Aurore, née le 27 avril 1898, mariée à Louis-Gonzague Boulanger.
-
Aimée, née le 13 décembre 1899, mariée à Ovide Beaulieu.
-
Alice, née le 10 mai 1901, mariée à Auguste Turcotte.
-
Louise, née le 17 février 1903, mariée à Albert Ouellet.
-
Marie-Anne, née le 12 juin 1904, religieuse de la Miséricorde.
-
Philippe, né le 29 janvier 1906, mariée à Anna Parent.
-
Yvonne, née le 24 octobre 1907, mariée à Wilfrid Omer Parent.
-
Arthémise Cécile, né le 24 mars 1910. - Jeanne Malvina, née le 13 novembre 1911, mariée à Charles Jos Lévesque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6345
30 mars 2022
Initiatives
intéressantes
Dans un article paru dans Le Devoir du 31 août 1945 et
traitant de l’industrie du bois, le journaliste Émile Benoist loue
les initiatives d’hommes d’affaires de Saint-Mathieu-de-Rioux qui
utilisent les bois francs à des fins industriels.
« Les seules initiatives
nouvelles pour l’utilisation des bois rimouskois, et notamment les
bois francs, paraissent être le fait de quelques petits industriels,
par exemple, dans la paroisse de Saint-Mathieu, (…), où le bois de
bouleau sert à fabriquer les boîtes circulaires à fromage, d'autres
bois, les boîtes à beurre et les boîtes à pommes.
Dans cette même paroisse de
Saint-Mathieu sise en plein dans la forêt de la seigneurie
Nicolas-Rioux, MM. Onésime et Amédée Dionne ont organisé l’industrie
fort intéressante des coffrets d’écoliers ou plumiers, articles
constamment en demande pour Iesquels il existe un marché immédiat et
qui se fabriquent avec le bois de hêtre et d'érable.
La fabrique Dionne emploie une
douzaine de personnes à l’année longue et il lui sera loisible
d’augmenter sa production dès qu’il y aura de la main-d’œuvre
disponible et qu’il sera possible d'obtenir de l’outillage.
Quant à la matière première,
elle ne manque pas. La forêt voisine contient des bois francs qui
n’ont pas eu jusqu’à présent d’autre utilisation que le chauffage.
Il est temps plus que jamais qu’on les fasse servir à l’industrie
manufacturière. Sur de vastes étendues, particulièrement dans le
bassin du lac Témiscouata, le merisier et le bouleau paraissent
frappés d'une maladie mortelle et que la vétusté générale des sujets
n’est pas de nature à atténuer.
Des industries comme celles de Saint-Mathieu ne contribuent pas à la ruine du pays, comme le font les scieries trop grandes et trop voraces, mais à son enrichissement. Les pouvoirs publics finiront peut-être par s'en rendre compte et sans doute voudront-ils alors mettre fin à la dilapidation de la forêt par ceux à qui on en a concédé la jouissance. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6325
18 mars 2022
Décès d’Aurélie Chassé
Dans son édition du 9 novembre 1944, le journal Le Soleil
annonce le décès d’Aurélie Chassé.
« M. Georges Rousseau,
directeur à l’école Saint-Dominique, rue Wolfe, à Bienville, vient
d’être plongé dans le deuil par la mort de sa mère, dame Aurélie
Chassé, épouse de M. Édouard Rousseau, survenue hier matin, à sa
résidence, à Saint-Mathieu de Rimouski, à l’âge de 74 ans et 9 mois.
M. Georges Rousseau qui est parti hier pour Saint-Mathieu de
Rimouski a reçu de la part du personnel enseignant et des élèves de
l’école Saint-Dominique un beau témoignage avant son départ de
l’école.
Les officiers et membres de la
chorale de Bienville, au cours d’une assemblée spéciale tenue hier
soir, ont adopté à l’unanimité une résolution de sympathies à M.
Georges Rousseau, membre de la chorale, à l’occasion de la mort de
sa mère et ont chargé le secrétaire de transmettre copie de cette
résolution à M. Rousseau. » (Fin du texte cité)
Édouard Rousseau est né en 1866. Il est le fils de Guillaume
Rousseau, né le 1er octobre 1817 à Trois-Pistoles, et
Clémentine Côté, née le 13 mars 1835 à l’Isle-Verte. Édouard
Rousseau épouse Aurélie Chassé le 7 février 1888 à l’Isle-Verte.
Aurélie Chassé est née en 1870 à l’Isle-Verte. Elle est la fille
d’Onésime Chassé, né le 24 mars 1817, et de Sara Vaillancourt, née
en 1824.
Le couple a eu 12 enfants : Régina (né en 1888), Victor (1890),
Georges (1892), Caroline (1893), Claire (1895), Éva (1897),
Rose-Ilda (1898), Albert (1900), Anne (1903), Jean-Luc (1904),
Georges (1906), Edgar (1909).
Édouard Rousseau est décédé le 9 février 1950 à l’âge de 84 ans. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6320
15 mars 2022
Nouvelles de 1940
En
cette année 1940, les journaux ont publié certaines nouvelles
concernant Saint-Mathieu-de-Rioux.
Baptêmes
Les premiers baptisés de
l’année sont deux jumeaux de Mme et M. Désiré Dionne.
(Le Soleil, 19 janvier 1940)
A
été baptisé Pierre-Émile, enfant de M. et Mme Napoléon Saindon.
Parrain et marraine. M. et Mme Amédée Dionne, cousins de l’enfant. (L’Action
Catholique, 11 mars 1940)
A
été baptisé Alcide, enfant de M. et Mme Albert Devost (Marie-Laure
Lagacé). Parrain et marraine M. et Mme Jos. Lagacé des
Trois-Pistoles, grands-parents. (L’Action Catholique, 11 mars
1940)
A
été baptisée Marie-Georgette, enfant de M. et Madame Albert Jean.
Parrain et marraine M. et Mme Joseph Rioux, de Saint-Fabien. (Progrès
du Golfe, 19 avril 1940)
A
été baptisé Joseph-Bertrand, enfant de M. et Mme Arthur Gaudreau.
Parrain et marraine M. et Mme Elzéar Ouellet. (Progrès du Golfe,
19 avril 1940)
Marguillier
M. Émile Plourde a été élu
marguillier en remplacement de M. Charles Ouellet, sortant de
charge. Un nouveau marguillier sera élu pour remplacer M. Narcisse
Jean. (Le Soleil, 19
janvier 1940)
Retraite fermée
Un
contingent de retraitants se rendit à la maison de retraites fermées
de Mont-Joli, le 7 février pour en revenir le 10. Parmi ces
retraitants, on remarquait : MM. Arthur, Joseph, Hormidas et Mathieu
Devost, Joseph-Luc et Louis-Jacques Beaulieu, Léon Bérubé, J.-Bte,
Jérémie, Adélard Jean et Fortunat Jean, Léonard Dionne, Louis
Parent, Donat Thibault, Gérard Fournier, Charles Plourde, Léo et
Georges Théberge, Jos. Vaillancourt, Gérard Belzile, Paul Parent,
Edmond Bélanger, Philippe Boulanger, David Dubé, Georges Rousseau,
Cyprien et Alphonse Desjardins, Alfred Bernier, Gérard, Mathieu,
Oliva Ouellet, Cyprien et Émile Plourde, Joseph Côté. (L’Action
Catholique, 11 mars 1940)
Décès
■ Les registres de l’année 1940
s’ouvrent par l’enregistrement d'un décès, celui de M. Narcisse
Jean, marguillier en charge pour la présente année, qui est décédé
le matin de l’Épiphanie, et qui a été inhumé le 8 janvier.
(Le Soleil, 19 janvier 1940)
■
Le 15 février eurent lieu les funérailles de Mme Alphonse Lagacé
(Marie Devost) décédée à l’âge de 72 ans.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils et
belles-filles : MM. et Mmes Joseph Lagacé de Trois-Pistoles, Charles
et Amédée Lagacé de Saint-Mathieu ; ses filles et gendres : MM. et
Mmes Félix Rioux (Alice), François Gagnon (Joséphine) de
Trois-Pistoles, Charles-Eugène Bérubé (Éva), Joseph Dionne (Yvonne),
Joseph Lévesque (Mathilda). Elle laisse aussi plusieurs
petits-enfants.
Portaient le cercueil, ses neveux MM. Charles Boulanger, Paul
Parent, Xavier Devost et Eugène Devost. Portait la croix, Amédée
Dionne. Conduisait le convoi funèbre M. Armand Rioux. La quête fut
faite par M. Roland Rioux, sacristain. (L’Action Catholique,
11 mars 1940)
■
Le 15 avril ont eu lieu les funérailles de M. Jean Bérubé, époux de
feu Antoinette Gauvin, décédé le 13, à l’âge de 85 ans et 6 mois. (Progrès
du Golfe, 19 avril 1940)
Le
même jour, avaient lieu également les funérailles de Mme Amédée Jean
(née Marie-Jeanne Parent), décédée le 12 avril à l’hôpital de
Rimouski. Elle était âgée de 26 ans et 11 mois.
Tous les paroissiens de Saint-Mathieu assistaient à ces funérailles.
De nombreux étrangers, parents et amis des défunts étaient venus se
joindre à la population de Saint-Mathieu pour témoigner leur
sympathie aux familles éprouvées et leur attachement à ces deux
citoyens de bien que le bon Dieu vient de rappeler à lui.
M. l’abbé Joseph Gauvin, curé de Saint-Jean de Dieu, ancien curé de la paroisse, chanta le service de M. Bérubé et M. l’abbé Charles-Eugène Parent, frère de Mme Jean, chanta le service de celle-ci. Au chœur, on remarquait, outre M. le curé de la paroisse, M. l’abbé Charles Pelletier, Mgr Lionel Roy, Supérieur du Séminaire, le chanoine S. Édouard Chénard ainsi que MM. les abbés Joseph Gauvin et Léon Beaulieu. (Progrès du Golfe, 19 avril 1940) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6300
3 mars 2022
Décès de Ludger
Ouellet
Dans son édition 1er décembre 1939, le Progrès du
Golfe fait, entre autres, un court compte-rendu des funérailles
de Ludger Ouellet.
Le 17 novembre eurent lieu les
funérailles de M. Ludger Ouellet, décédé subitement à l’âge de 78
ans.
Le défunt laisse son épouse,
née Philomène Lévesque, et une fille, Mme Adélard Ouellet (Emma) ;
son gendre, M. Adélard Ouellet ; trois petits-enfants, Omer, Réal et
Mathieu ; un fils adoptif, M. Edmond Jean.
M. l’abbé Charles Pelletier
fit la levée du corps et chanta le service. La quête fut faite par
M. Roland Rioux, sacristain. Portaient le cercueil : MM. Edmond
Jean, Jean Ouellet, Émile Plourde et Eusèbe Côté. Portait la croix,
M. Majorique Lagacé, et le drapeau du Sacré-Cœur, M. Désiré
Rousseau.
Complément.
Ludger Ouellet est né le 30 juin 1862 à Saint-Mathieu-de-Rioux. Il
est le fils de Narcisse Ouellet et d’Hortense Lagacé qui se sont
marié le 24 novembre 1851 en l’église de Saint-Simon. Il a épousé
Philomène Lévesque le 23 janvier 1883 à Saint-Mathieu. Philomène est
née le 21 septembre 1866, environ deux semaines avant l’ouverture
des registres paroissiaux de Saint-Mathieu. Elle est la fille de
Joseph Lévesque et de Sophie Paradis.
Ludger Ouellet a été élu
marguillier en janvier 1908. En 1911, il est allé chercher fortune
aux États-Unis. Il était accompagné de son épouse et d’un fils
adoptif, Edmond Jean. Ils sont revenus à Saint-Mathieu en 1913, en
même temps qu’Emma, la fille du couple, et son mari Adélard Ouellet.
Baptêmes
Berchmans, enfant de M. et Mme
Georges Beaulieu (Georgiane Lagacé). Parrain et marraine. M. et Mme
Philippe Beaulieu, oncle et tante de l'enfant.
Gaétan, enfant de M. et Mme
Georges Beaulieu (G. Lagacé). Parrain et marraine, M. et Mme
Joseph-Luc Beaulieu, oncle et tante de l’enfant.
Statistiques De plus, on peut lire dans le Soleil du 19 janvier 1940 les statistiques suivantes : « Il y eut, au cours de 1939, à Saint-Mathieu, 51 baptêmes, 11 mariages et 16 sépultures, dont 9 d’enfants ; 47 110 communions ont été distribuées. La paroisse compte actuellement 1006 âmes et 767 communiants ; 244 enfants fréquentent les écoles. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6295
27 février 2022
Censitaires de Saint-Mathieu-de-Rioux
La
seigneurie Nicolas-Rioux a appartenu à Joseph Drapeau à partir
du 15 décembre 1803. À son décès, elle a été léguée à ses
filles. En 1858, dans le Cadastre abrégé de la seigneurie de
Nicolas Rioux, appartenant alors aux dames Drapeau, Siméon
Lelièvre, écuyer et commissaire, établit une liste de tous les
censitaires de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux à cette
date. Je vous transmets tous ces noms.
Dans cette liste, j’ai utilisé les abréviations suivantes :
•
(2) : 2 arpents de front, 30 arpents de profondeur
•
(2, 24) : 2 arpents de front, 24 arpents de profondeur
•
(6 p.) : 6 perches de front, 30 arpents de profondeur
Les fractions de pieds ou de perches ont été arrondies selon les
règles habituelles. Notons les équivalences suivantes :
•
1 arpent : 11,6261 perches
•
1 perche : 16,5 pieds
Cette liste contient les noms de 245 censitaires. Elle ne permet
pas de connaître les chefs de famille qui cultivent une terre.
Toutefois, on peut faire ces remarques :
1.
Dans chaque rang, les noms des censitaires se suivent de l’ouest
à l’est.
2.
Quelques terres ont été fractionnées probablement entre les
membres d’une même famille.
3.
Certaines personnes possédaient une terre uniquement pour la
coupe du bois. C’est sans doute le cas de William Price, le
propriétaire du moulin à scie.
4.
Certaines personnes possédaient plus d’une terre ou encore des
noms étaient identiques.
Troisième rang (137 lots
Quatrième rang (70 lots)
Cinquième rang
(38
lots)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6280
18 février 2022
Nouvelles de février 1939
Dans son édition du 17 février 1939, le Progrès du Golfe
publie des nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux.
Décès de dame Délima Chouinard
« Le 5 février s’éteignait
pieusement, après une longue maladie soufferte avec une grande
résignation à la volonté de Dieu, dame Délima Chouinard, épouse de
feu Napoléon Fournier, à l’âge de 79 ans 9 mois.
Elle est partie pour l'au-delà
recevoir sa récompense. Sa carrière fut remplie de bonnes œuvres.
Elle fut une épouse modèle et une mère chrétienne. Ce fut munie des
derniers sacrements de notre sainte religion qu'elle se présenta
confiante devant son souverain juge. Elle vivra dans le monument
impérissable de ses œuvres et dans la trace lumineuse de sa vie
exemplaire.
La défunte laisse cinq fils
MM. Hermel, Charles-Eusèbe, François, Alexis et Édouard Fournier, et
trois filles Mme Loyola Buteau (Alphéda), Mlles Rose-Anne et Emma
Fournier.
Pour la circonstance, l'église
avait revêtu ses plus beaux ornements de deuil. Au chœur, de l'orgue
un magnifique programme de chant fut exécuté. La levée du corps fut
faite par M. l’abbé Charles Pelletier, curé de la paroisse. M.
l'abbé Joseph Gauvin, curé de Saint-Jean de Dieu, chanta le service,
assisté de MM. les abbés Charles Pelletier et Eugène Brière, curé de
Saint-Simon, comme diacre et sous-diacre.
En tête du cortège venait
Charles Boulanger portant la croix, M. Émile Théberge conduisait le
corbillard. Les porteurs du cercueil étaient : MM. Onésime Dionne,
Désiré Dionne, Édouard Belanger et Paul Parent.
Le deuil était conduit par ses
enfants : M. François Fournier, Mlles Rose-Anne et Emma Fournier de
St-Mathieu, Édouard Fournier de Berlin, M. et Mme Hermel Fournier,
de St-Mathieu, M. Charles-Eusèbe Fournier, de Saint-Léon le Grand,
Mme Loyola Buteau (Alphéda) de Québec, M. et Mme Alexis Fournier de
Bic.
Ses petits-enfants : MM. Hermel, Rosario,
Léonard, Mathieu, Donat et Fabien Fournier de St-Mathieu, M. Rosaire
Fournier, Mlles Germaine et Irène Fournier, de St-Mathieu, Mlle
Gemma Fournier de Bic.
Son beau-frère, M. Édouard Ouellet, sa
belle-sœur Mme Honoré Chouinard de St-Mathieu. Ses neveux et nièces
M. et Mme Adélard Ouellet, M. et Mme Charles Ouellet, M. et Mme
Ludger Ouellet, M. et Mme Trefflé Ouellet de St-Mathieu, Mme Édouard
Ouellet de Ste-Françoise. Autres parents : M. et Mme David Parent,
M. et Mme Donat Lavoie, de Ste-Françoise, M. et Mme Désiré Rousseau,
de St-Mathieu, M. et Mme Napoléon Fournier, M. et Mme Ludger
Fournier, de St-Fabien.
On remarquait dans l’assistance : M. et
Mme Joseph Bélanger, M. Théodore Bélanger, M. et Mme Hyacinthe
Plourde, M. et Mme Vézina Jean, de St-Simon et un nombre
considérable d’autres personnes.
Trois autres
décès
- Le 30 janvier, ont eu lieu
les funérailles de M. François Ouellet, époux d’Odila Vaillancourt.
Il était âgé de 81 ans et 6 mois.
- Le 31 janvier, ont eu lieu
les funérailles de Thérèse Bélanger, fille de M. Édouard Bélanger et
de dame Maria Hammond. Elle était âgée de 9 ans et 10 mois.
- Le 14 février, ont eu lieu
les funérailles de Marie-Olivette Thibault, fille de Donat Thibault
et d’Yvette Rioux. Elle était âgée de 2 jours.
Baptêmes
Joseph-Arsène Beaulieu, fils
de Paul-Émile Beaulieu et de Marie-Anne Rioux. Parrain et marraine
Mathieu Beaulieu et Marie-Rose Beaulieu, frère et sœur du
nouveau-né.
Joseph-Clovis, enfant de Léo
Théberge et Lucie D’Auteuil. Parrain et marraine M. et Mme Antonio
Théberge.
Marie-Agathe Jean, enfant de
Fortunat Jean et Annette Rioux. Parrain et marraine, M. et Mme
Edmond Dionne.
Marie-Audette Jean, enfant de
Philippe Jean et de M-Noëlla Devost. Parrain et marraine, M. et Mme
Albert Jean.
Marie-Olivette Thibault, enfant de Donat Thibault et d’Yvette Rioux. Parrain et marraine, M. et Mme Ernest Cayouette. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6270
12 février 2022
Deux décès en 1938
Dans son édition du 7 novembre
1938, le journal Le Soleil, quotidien de Québec, fait le
compte-rendu de deux décès survenus à Saint-Mathieu-de-Rioux.
Dame Édouard Ouellet
« Le 21 octobre, avaient lieu
en l’église de Saint-Mathieu les funérailles de dame Édouard
Ouellet, née Rosalie Chouinard, décédée le 19 à l’âge de 75 ans et 8
mois.
Femme de bien, chrétienne
accomplie, le divin Juge l’a trouvée prête à répondre à son suprême
appel. Elle laisse beaucoup de regrets car partout où elle a passé,
elle a su gagner l’affection de tous par la douceur de son caractère
et sa gaieté habituelle.
Elle laisse dans le deuil,
outre son époux, sept fils MM. Adélard, Ludger, Trefflé de
Saint-Mathieu, Hermel de Notre-Dame du Lac, Alphonse, Georges et
Armand, de Berlin N. H. tous mariés, six filles : Mme Louis Vadnais,
Rosalie, Lac Humqui, Mme Gonzague Lévesque, née Alice,
Rivière-du-Loup, Mme Charles Ouellet, née Délima de Saint-Mathieu,
Mme Joe Desjardins, née Anna, Mme Thomas Albert, née Aurore, Cabano,
Mme Onil Morault, née Alma, Notre-Dame du Lac et plusieurs
petits-enfants.
La dépouille mortelle était
portée par MM. Paul Létourneau, Jean Ouellet, Pierre Thibault,
Narcisse Jean, Émile Ouellet et Émile Théberge. M. Ovide Beaulieu, à
la tête du cortège, portait la croix. Le corbillard était conduit
par M. Ovide Lagacé. »
Alexandre Voisine
« Dieu visite notre paroisse
et les deuils se multiplient. Le même jour, 19 octobre, décédait M.
Alexandre Voisine, époux d'Héloïse Lebel, à l'âge de 69 ans et 3
mois. Son service et sa sépulture eurent lieu le 21 octobre.
II laisse pour le pleurer,
outre son épouse, cinq fils MM Philippe, Alfred Voisine, Berlin N.
H., Émile, Adélard et Alphonse Voisine de Saint-Mathieu, quatre
filles Mme Antonio Arsenault née Jeanne, Sainte-Félicité, Matane,
Mme Denis Rousseau née Marie-Blanche, Mlles Marie-Anne et Alberta
Voisine, de Saint- Mathieu.
M. J. Moyen portait la croix.
MM. François Marquis, Alphonse Lagacé, Ernest Dionne et Majorique
Lagacé portaient le cercueil. Le corbillard était conduit par M.
Émile Théberge.
Il est parti pour l’au-delà recevoir sa récompense. II fut un époux modèle et un père chrétien. Trois semaines de maladie seulement ont précédé sa mort. Il fut muni des derniers sacrements de notre sainte religion, qu’il se présenta confiant devant son souverain juge. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6255
3 février 2022
Nouvelles de 1937
En cette fin d’année 1937, le Progrès du Golfe, un
hebdomadaire de Rimouski, publie des nouvelles provenant de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
26 novembre 1937
- La Compagnie Dionne & Dionne vient d'être réorganisée. M. Ernest
Dionne, le père, se retire complètement des affaires et cède ses
intérêts à ses fils MM. Louis et Réal Dionne, qui deviennent les
coassociés de M. Félix Dionne. M. Félix Dionne devient président et
gérant de la compagnie. La Compagnie Dionne, en plus d'exploiter une
scierie, se spécialise dans la confection et la vente des boites
pour le beurre et le fromage. La Compagnie Dionne commencera ses
chantiers immédiatement. L’usine pour la confection des boites est
fermée pour jusqu'à la fin de mars.
- Mlle Rose-Anna Fournier, institutrice, vient de recevoir une prime
pour succès dans l’enseignement.
- Mlle Marie-Claire Paradis, institutrice à l'école de l'église,
vient d'obtenir également une prime pour succès.
- Le dernier recensement de la paroisse de Saint-Mathieu a été comme
suit : population : 952, communiants : 704, familles : 135.
- M. Charles Vaillancourt, époux de Marianne Albert, de
Saint-Mathieu, est décédé subitement à l’hôpital Saint-Sacrement de
Québec le 22 novembre.
10 décembre 1937
- Mlle Jeanne Ouellet, fille de Madame Joseph Ouellet, est entrée à
l’hôpital de Rimouski, hier pour y subir une opération pour
l'appendicite.
- Mlle Candide Théberge, fille de M. et Madame Émile Théberge, a dû
être transportée d'urgence dans la nuit du 6 décembre à l'hôpital de
Rivière-du-Loup, où elle a subi une opération pour l’appendicite.
- Mlles Thérèse Boulanger et Clairina Bélanger sont allées à Rimouski pour y suivre les exercices d’une retraite fermée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6245
27 janvier 2022
Décès d’Adélard
D’Auteuil
Dans son édition du 3 juillet 1935, le Soleil fait un
compte-rendu des funérailles d’Adélard D’Auteuil, un paroissien de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
« Le 6 juin, s’éteignait pieusement dans le Seigneur, après une
longue maladie soufferte avec résignation, M. Adélard D’Auteuil,
époux d’Elmire Gaudreau, à l’âge de 52 ans. C’était un époux
exemplaire, un père chrétien, charitable et dévoué. Aussi sa
disparition est-elle unanimement regrettée.
Ses funérailles eurent lieu lundi, le 10, à 8 heures. De nombreux
parents et amis de l’extérieur et de la paroisse avaient tenu à
témoigner à la famille leurs sincères sympathies en y assistant.
M. l’abbé Louis-David D’Auteuil, cousin du défunt, fit la levée du
corps. Le service a été chanté par M. l’abbé Joseph Gauvin, curé de
la paroisse, assisté du révérend Père R. Nicole et de M. l’abbé A.
Couillard, comme diacre et sous-diacre. Au chœur, on remarquait M.
l’abbé Louis-David D’Auteuil, curé du Sacré-Cœur.
Lorsque le cortège funèbre laissa la maison mortuaire, le deuil
était conduit par
• ses enfants et gendres, son fils M. Maurice D’Auteuil, M. et Mme
Léo Théberge (Lucie), M. et Mme Henri Vaillancourt (Germaine), Mlles
Rose D’Auteuil, Albina, Ida et Ernestine D’Auteuil, son frère M.
Auguste D’Auteuil, de New-Bedford, son beau-frère et sa belle-sœur,
M. et Mme Philéas Gaudreau de Saint-Mathieu, Mme Wilfrid Gaudreau de
Val Saint-Michel.
• ses neveux et nièces, M. et Mme Eugène D’Auteuil, MM. Jean et
Romain D’Auteuil, M. et Mme Ambroise Girouard, M. et Mme Octave
Girouard de Saint-Mathieu, Mlle Béatrice Samson, Mme Joseph Fournier
(Rose-Anna Samson) de Saint-Grégoire Montmorency, Mlle Odile Jean,
M. Omer Jean, Donat, Gérard, Paul Jean, de Saint-Mathieu, M et Mme
Louis Mercier, de Saint-Siméon.
• ses cousins et cousines, M. et Mme Eugène Vaillancourt, de
Québec, M. et Mme Noël Théberge, M. et Mme Louis-Philippe Théberge,
M. et Mme Joseph Gaudreau, M. Michel Jean, de Saint-Fabien, M. et
Mme Alphonse Gagnon, de Saint-Valérien, M. Marcellin Théberge, M. et
Mme Jean Théberge, M. et Mme Arthur Lavoie, de Saint-Simon, M. et
Mme Adélard D’Auteuil, M. et Mme Édouard Ouellet, M. Télesphore
D’Auteuil, de Sainte-Françoise, Mlle Laurette Vaillancourt, de
Québec.
Une foule considérable assistait aux obsèques. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6230
18 janvier 2022
Funérailles de Pierre D’Auteuil
Dans son édition du 16
décembre 1932, le journal La Presse livre un compte-rendu des
funérailles de Pierre D’Auteuil de Saint-Mathieu-de-Rioux :
« Ces jours derniers ont eu
lieu les funérailles de M. Pierre D’Auteuil, décédé à l’âge de 22
ans. La levée du corps fut faite par le curé Joseph Gauvin et le
service chanté par l’abbé D’Auteuil, cousin du défunt, assisté des
abbés Saindon et J. Gauvin, comme diacre et sous-diacre.
Les chorales de Saint-Mathieu
et Saint-Simon exécutèrent la messe grégorienne. Mlle Alberta Dionne
touchait l’orgue. Les porteurs étaient les beaux-frères du défunt M.
Léo Théberge et Henri Vaillancourt, son cousin, M. J. Marie
D’Auteuil et MM. Albert Vaillancourt, Louis et Roland Dionne. Son
frère Maurice portait la croix. MM. Félix Ouellet et Réal Dionne
portaient les couronnes de fleurs.
Conduisaient le deuil : le
père du défunt, M. Adélard D’Auteuil, ses sœurs Mmes Léo Théberge,
Henri Vaillancourt, Rose, Albina, Ida et Ernestine, M. Noël
Girouard, M. et Mme Philias Gaudreau, Mme Vve Jean-T. Lagacé. M. et
Mme Émile Théberge. M. Ernest Jean, MM et Mmes Ambroise Girouard,
Octave Girouard, Edmond Jean, R.-Anna, Ange et Romain D’Auteuil,
Mlles Germaine, Elmire et Odile Jean, Lucienne, Ange, Candide et
Gabrielle Théberge, MM Georges et Maurice Théberge, les familles
Jérémie Jean, Jean Jean, de Saint-Mathieu, M. Noël Théberge, Mlle
Clémentine Théberge, MM. et Mmes Louis Mercier, Jean Théberge,
Joseph Théberge, MM. Adélard et Noël Théberge de Saint-Simon, Mme
Cyrille Saint-Laurent, de Sault-Montmorency.
Dans le cortège on remarquait MM. X. Poitras de Rimouski, Cyrille et Thomas Thibault, Ignace Gagné, Jos. Nicole, Magloire D’Anjou, Albert et Armand Thibault, Michel Bérubé et J. Gagné, de Saint-Simon, Émile Ouellet, Antoine Dionne, J. Gauvin, Ernest Dionne, M. et Mme Belzile, MM. Félix Vaillancourt, Félix, Omer et Désiré Dionne, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6215
9 janvier 2022
La famille Auguste
D’Anjou
Auguste D’Anjou est né à Rivière-Ouelle en 1849. Il est le fils de
Georges D’Anjou et de Desanges Martin. Il épouse Marie-Victoire
Lévesque de la même paroisse, fille de Georges Lévesque et de Marie
Boucher, à Saint-Mathieu-de-Rioux le 25 août 1880.
Les deux conjoints ont une certaine instruction. Auguste est
secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Mathieu de 1881 à
1890. En 1883, il est nommé juge de paix. Il est secrétaire de la
commission scolaire de 1889 à 1891. Il est responsable du bureau de
poste du 1er septembre 1889 au 21 juillet 1892.
Marie-Victoire, connue sous le prénom de Mary, a enseigné et sera
une grande lectrice toute sa vie. Elle a une plume très efficace et
très nuancée.
Auguste est marchand général à Saint-Mathieu et à ce titre, en
1889, il fait saisir la terre de Timothée Ouellet du cinquième rang
pour dettes impayées.
Le 14 janvier 1890, le marchand D’Anjou annonce qu’il fait cession
de ses biens. Un curateur est nommé. Le 4 mars 1890, une vente à
l’encan a lieu pour écouler les produits alimentaires, le matériel
de quincaillerie, les chevaux, les voitures, etc. Le terrain d’un
arpent sur un demi-arpent et les bâtisses, comme la maison, le
hangar, l’étable et la remise ne sont pas touchés.
Auguste D’Anjou cède alors ses biens immobiliers, terrain et
bâtisses, à son épouse Mary Lévesque. En 1892, une poursuite est
engagée par le grossiste Thibaudeau et frères de Québec. La saisie
est « contre dame Marie Lévesque, épouse séparée quant aux biens par
contrat de mariage d’Auguste D’Anjou, de la paroisse de
Saint-Mathieu, district de Rimouski, marchande publique, et le dit
Auguste D’Anjou, mis en cause pour assister et autoriser sa dite
épouse. »
L’objet de la saisie est « un emplacement situé à Saint-Mathieu,
avec maison et autres bâtisses dessus construites, étant connu et
désigné sous le numéro quatre-vingts (80), du cadastre officiel pour
la paroisse de Saint-Mathieu. » (Gazette officielle du Québec,
7 mai 1892).
Cette famille a été grandement éprouvée. Six des huit enfants nés à
Saint-Mathieu sont décédés en bas âge.
• Arthur, né le 12 novembre 1882, décédé à 1 jour.
• Candide, née le 24 avril 1885, décédée à 4 ans 8 mois.
• Hectorine, née le 21 octobre 1886, décédée à 5 mois.
• Philippe Auguste, né le 18 juillet 1888, décédé à 4 mois.
• Émérence, née le 17 mars 1890, décédée à 2 mois et 4 jours.
• Paul Emmanuel, né le 26 novembre 1892 , décédé à 20 jours.
Aimée, l’ainée de la famille, est née le 27 juin 1881. Elle est de
santé délicate. À l’aube de ses 18 ans, elle obtient son diplôme
d’enseignement à Rivière-Ouelle. Elle enseigne un peu plus d’un an,
puis elle entre chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en
janvier 1902. Vu son état de santé, les religieuses la renvoient à
la maison. Elle décède le 22 avril 1904 à l’âge de 22 ans : un autre
drame qui perturbe grandement la famille. Les parents auront vu
mourir sept de leurs neuf enfants.
Corine, la fille du couple, est née le 11 décembre 1883. Elle est
de santé normale. Le 4 mai 1909, elle épouse Alfred Bélanger, un
veuf ayant deux enfants. Pendant toute sa vie, elle se tient très
loin de sa famille à cause du climat toxique ambiant qui est
accentué par l’alcoolisme et des périodes dépressives de sa mère.
Presque huit ans après la naissance de son huitième enfant, le 27
décembre 1900 au Bic, Mary accouche d’un garçon qui est appelé Réal.
Cet être fragile sera toute sa vie sous la férule de sa mère qui
l’entraînera dans le vice. Cette histoire est racontée dans un livre
de 646 pages écrit par Odette Mainville en 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6205
3 janvier 2022
Nouvelles de 1932
En 1932, le journal La Presse donne des nouvelles de
Saint-Mathieu-de-Rioux à deux occasions :
1. La Presse, 23 juillet 1932
- Ces jours derniers étaient chantées en notre église les premières
messes de MM. les abbés Roland Belzile et Stanislas Gauvin.
- Ces jours derniers en l'église de Saint- Mathieu, a été célébré le
mariage de Mlle Germaine D'Auteuil, fille de M. Adélard D’Auteuil,
avec M. Henri Vaillancourt, fils de M. Félix Vaillancourt. La
bénédiction nuptiale leur fut donnée par M. l’abbé Stanislas Gauvin.
Après la cérémonie, une réception eut lieu chez Adélard D’Auteuil,
après quoi, les nouveaux époux partirent en voyage pour le tour de
la Gaspésie.
- Parmi nos collégiens de retour dans leurs familles, citons : M
Paul-Émile Ouellet, du Séminaire de Rimouski. M. Adrien Dionne, du
collège de Montmagny et M. Amédée Chouinard, de Sainte-Anne de la
Pocatière.
- M. J.-Bte Rioux de Montréal, étudiant au collège Bourget de
Rigaud, vient passer sa vacance chez son oncle M. Ernest Dionne.
- MM. C.-Eugène Belzile et Omer Clavette, d’Edmundston, N.-B,
étaient de passage ici ces jours derniers.
- M et Mme Ernest Dionne, leur garçon Louis-Philippe, ainsi que
leurs filles Valentine et Bertha sont de retour de voyage à Québec,
Montmagny et Edmundston, N-B.
- M. et Mme Armand Ouellet, de Berlin, sont actuellement en
promenade ici chez des parents.
- M. et Mme Hilaire Ouellet, de Saint-Fabien, étaient ici ces jours
derniers.
2.
La Presse, 3 décembre 1932
Ces jours derniers ont eu lieu
les funérailles de M. Honoré Chouinard, décédé à l'âge de 62 ans. Le
service fut chanté par le curé Joseph Gauvin, assisté comme diacre
et sous-diacre des abbés Charest et Anctil, curé et vicaire de
Saint-Simon. Les porteurs étaient MM. Thomas Lagacé, Édouard
Ouellet, Ernest Dionne, de Saint-Mathieu et Gonzague Lévesque de
Rivière-du-Loup.
M.
Ferdinand Lagacé de Trois-Pistoles portait la croix. Dans le
cortège, on remarquait l’épouse du défunt (Marie-Caroline Lagacé),
son fils Amédée, ses sœurs, Mmes Napoléon Fournier et Édouard
Ouellet, ses beaux-frères et sa belle-sœur, M. et Mme Ferdinand
Lagacé et M. Thomas Lagacé, ses neveux et nièces, MM. et Mmes Joseph
Lagacé, Joseph-Luc Beaulieu, Paul-Émile Beaulieu, Camille, Laure et
Géorgienne Lagacé, François, Anna et Emma Fournier, etc.
Note. Amédée Chouinard, le fils d’Honoré, est ordonné prêtre pour les Dominicains le 20 décembre 1936. Il décède le 16 janvier 1954. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6190
24 décembre 2021
Deux premières messes
Dans son édition du 12 juillet 1932, le quotidien
La Presse informe que deux premières messes ont été célébrées
à
Saint-Mathieu-de-Rioux. Voici le texte :
«
Les abbés Roland Belzile et Stanislas Gauvin ont chanté le même jour
leur première messe dans notre paroisse.
L'abbé R. Belzile était
assisté par ses cousins MM les abbés Médard Belzile, Lazare et X.
Lebel, et ses quatre frères Eugène, Albert, Georges et Fénelon.
L'abbé Hilaire Desmeules dirigeait les cérémonies.
L'abbé Stanislas Gauvin était
assisté par trois frères. MM les abbés Joseph Gauvin, curé de
Saint-Mathieu, Jean-Baptiste Gauvin et André-Albert Gauvin.
Dans le chœur, on remarquait
les chanoines Hermel Tremblay et Eugène Pelletier, les abbés Georges
Gauvin, Wilfrid Dionne, Louis-D. D’Auteuil, J.–H. Charest, Jean
Ross, Charles Pelletier, L.-J. Lavoie, Hermel Pelletier, P.
Lafrance, Grégoire Rioux, C.-E. Parent et Laurent Lavoie.
L’abbé Philippe Anctil
dirigeait la chorale et l'abbé Gilbert Lindsay touchait l'orgue. Le
sermon fut prononcé par l’abbé Georges Dionne, professeur au
Séminaire de Rimouski. » (Fin du texte cité)
Roland Belzile est né à
Saint-Mathieu le 1er juin 1906. Il est le fils d’Alfred
Belzile, beurrier, et d’Eugénie Lebel. Il fait ses études classiques
au Séminaire de Rimouski et sa théologie au Grand Séminaire de la
même ville. Il est ordonné prêtre par Mgr Georges Courchesne le 26
juin 1932. Il est nommé vicaire à Lac-au-Saumon.
Stanislas Gauvin est né à
Sacré-Cœur le 21 septembre 1906. Il est le fils de Joseph Gauvin,
cultivateur, et de Christine Gagnon. Il fait ses études classiques
au Séminaire de Rimouski et en partie sa théologie au Séminaire des
Missions-Étrangères de Pont-Viau. Il est ordonné prêtre par Mgr
Georges Courchesne le 26 juin 1932. Il est nommé vicaire à Cabano.
Au moment de son ordination, l’abbé Stanislas Gauvin demeure au presbytère chez son frère le curé de Saint-Mathieu. Il a été curé de cette paroisse de 1971 à 1973. C’était quand même assez rare qu’un prêtre devienne curé de la paroisse où il a dit sa première messe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6180
18 décembre 2021
Nouvelles du 26
décembre 1929
Dans son édition du 26 décembre 1929, l’Action
Catholique, quotidien de Québec, livre des nouvelles concernant
Saint-Mathieu-de-Rioux.
L’Immaculée-Conception
Cette fête a été célébrée ici
avec tout l’éclat possible. Les Enfants de Marie ont tenu à
l'honneur de décorer l’autel de la Ste-Vierge afin de mieux
souligner leur fête patronale. Pendant la messe, la quête a été
faite par Mesdemoiselles Rose-Aimée Dionne et Marie-Laure Théberge.
Plusieurs cantiques appropriés furent très bien rendus à cette
occasion.
Mariage
Le 27 novembre, M. Arthur
Gaudreau cultivateur de cette paroisse, fils de M. Philéas Gaudreau
épousait Mlle Marie-Ange Ouellet, fille de M. Joseph Ouellet,
également de cette paroisse.
Baptême
Le 21 novembre, M. et Mme
Joseph-Luc Beaulieu, née Yvonne Lagacé, une fille sous le prénom
d’Agathe. Parrain et marraine M. et Mme Camille Lagacé.
Départ
À la fin de novembre, M.
Joseph Paradis, rentier, nous quittait pour aller résider à Montréal
chez ses parents.
Élevage de la volaille
Dimanche, le 15 décembre, en
notre salle publique, M. Mercier aviculteur du district nous a donné
une très intéressante causerie sur ce qui concerne l’élevage de la
volaille. Monsieur Gauthier, agronome, a vivement intéressé les
cultivateurs en leur donnant des renseignements sur l’utilité des
engrais chimiques.
Absence M. Alfred Belzile s’est absenté quelques jours pour assister aux funérailles de son frère M. Fénelon Belzile de Saint-Octave, Matane. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6160
6 décembre 2021
Décès de Louis
Parent
Dans son édition du 2 novembre
1928, le journal L’Action catholique fait un compte-rendu des
funérailles de Louis Parent, de Saint-Mathieu-de-Rioux et père de
l’abbé Charles-Eugène Parent :
« Samedi le 13 octobre, ont eu
lieu en l’église de Saint-Mathieu les funérailles de feu Louis
Parent, décédé subitement, mercredi le 10.
La
levée du corps fut faite par M. l’abbé D. S. Giguère, curé de la
paroisse. Le service fut chanté par M. l’abbé Charles-Eugène Parent,
fils du défunt, assisté de M. l’abbé Hermel Pelletier, curé de
Saint-Zénon du Lac-Humqui, de M. l’abbé Fortunat Gagnon, préfet des
études au Séminaire de Rimouski. Sa Grandeur Mgr Georges Courchesne
présida à l’absoute. »
Suivent les noms de 23 prêtres dont Mgr Samuel Langis, vicaire
général, les chanoines Joseph-E. Pelletier, curé de Trois-Pistoles,
Hermel Tremblay, ancien curé de Saint-Mathieu et l’abbé Joseph
Gauvin, directeur de l’école d’Agriculture de Rimouski.
« M. Louis Fournier du Bic portait la croix. Les porteurs du
cercueil étaient MM. Jean Parent de Trois-Pistoles, Magloire Chénard
du Bic, Joseph Parent de Sayabec, Ferdinand Parent de Saint-Éloi,
tous neveux du défunt.
Conduisaient le deuil : ses fils Victor, Gérard, Léonard et Louis-Joseph, ses filles Mme Joseph Bérubé (Anna), Cécile, Irène, Marie-Jeanne et Germaine, son gendre Joseph Bérubé, Mme Narcisse Jean de Sayabec, sœur du défunt, Mme Georges Parent, belle-sœur du défunt, MM et Mmes Octave Bérubé, Amqui, Émile Lavoie et Ernest Pelletier, Michel Parent, MM. Philippe, Georges, Louis-Jacques, Robert et Édouard Chénard, Mme Vve Gonzague Dionne, Mme Joseph Chénard, Mme Magloire Chénard, Mme Ferdinand Parent, M. et Mme Michel Côté de Saint-Fabien, MM Alphonse Gagnon, Paul-Émile Gagnon, MM et Mmes Alphonse et Georges Bérubé, M. Louis Bérubé, M. Télesphore D’Amours de Trois-Pistoles et une foule d’autres parents et amis dont les noms nous échappent. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6140
24 novembre 2021
Nouvelles de 1920
En 1920, le Progrès du Golfe et le journal La Presse
ont publié des nouvelles sur Saint-Mathieu-de-Rioux.
Décès de Marie-Rose Théberge
Madame Thomas Ouellet, née Marie-Rose Théberge, est décédée le 8
janvier à l’âge de 36 ans, laissant pour pleurer sa perte son mari,
huit enfants, son père, sa mère, des frères et des sœurs. (Progrès
du Golfe, 13 février 1920)
Complément.
Marie-Rose Théberge est née le 15 novembre 1883. Elle est la fille
d’Alfred Théberge et de Rose Rousseau. Ses enfants vivants au moment
de son décès sont : Robert (né en 1907), Rodolphe (1908), Romuald
(1909), Rose-Aime (1912), Ernestine (1913), Émilienne (1914),
Marie-Anne (1916), François-Xavier (1917).
Décès d’Yvonne Théberge
La mort est venue plonger une de nos braves familles dans un deuil
cruel. Le 6 juillet 1920 s’envolait vers le ciel l’âme de Mlle
Yvonne Théberge, fille de M. Désiré Théberge, propriétaire de
l’hôtel Victoria (à Trois-Pistoles), âgée de 12 ans et 4 mois, après
une longue maladie soufferte avec résignation à la volonté de Dieu.
(Le Progrès du Golfe, 23
juillet 1920)
Complément.
Désiré Théberge est le frère de la défunte Marie-Rose. Yvonne
Théberge est la nièce de Marie-Rose. Désiré et Marie-Rose ont épousé
deux Ouellet de la même famille : Lucette et Thomas.
Mariages
- Le 27 janvier, mariage de M. Thomas Albert, de Saint-Simon, avec
Mlle Aurore Ouellet, de Saint-Mathieu.
-
Le 10 février, mariage de M. Jos. N. Ferdinand Lévesque,
Trois-Rivières, avec Mlle Mathilda-Ida Lagacé.
- Mariage de M. Charles Eugène Jean, Saint-Mathieu, et Mlle
Marie-Louise Roy de Saint-Fabien. (Progrès du Golfe, 13
février 1920)
Des jumelles La Presse publie la photo ci-contre des jumelles Jeanne et Blanche, enfants de Joseph Audet et de Claire Vaillancourt de Saint-Mathieu. (La Presse, 14 août 1920) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6120
12 novembre 2021
La poste à
Saint-Mathieu-de-Rioux
Le premier bureau de poste de Saint-Mathieu ouvre ses portes le 1er
février 1868. C’est le premier curé de la paroisse, le révérend
Antoine Chouinard, qui en est le responsable, lui qui est en
fonction depuis un peu plus d’un an seulement.
Dans le site
Bibliothèque et Archives Canada (BAC),
on trouve les responsables successifs du bureau de poste de 1868 à
1971 avec la date d’entrée en fonction et celle de départ. Voici les
données :
Le premier bureau de poste est situé dans le presbytère. Il
déménage au magasin général, puis dans la maison située à l’est du
terrain de la fabrique du côté sud. Plus tard, on le trouve dans la
maison située immédiatement à l’ouest de l’église au nord de
la salle paroissiale. Enfin,
en 1966, un édifice est construit.
Un deuxième bureau de poste
Sur le même site,
on peut lire que le 1er juillet 1913 un deuxième bureau
de poste ouvre ses portes au Faubourg du Moulin sous le nom de Ville
Réal. Ce bureau de poste a été en opération pendant presque 18 ans,
ayant fermé ses portes le 31 mai 1931 à cause d’une clientèle
restreinte. Voici le nom des personnes qui en ont été responsables
pendant ce temps :
Le bureau de poste de Ville Réal est situé successivement au moulin à farine et au rez-de-chaussée de la maison en face de l’ancienne école no 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6100
30 octobre 2021
Nouvelles du 4
juillet 1913
Sous le pseudonyme de Fleur du pays, le Progrès du Golfe
du 4 juillet 1913 publie des nouvelles concernant
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Mariages
-
Le 21 juin, M. Philéas Parent, cultivateur de
Ste-Perpétue-de-l’Islet à Mlle Alice Jean, fille de M. Narcisse Jean
de cette paroisse.
-
Le 1er juillet, M. Cyprien Plourde, fils de Joseph
Plourde, a uni sa destinée à Mlle Aurore Théberge, fille de M.
Alfred Théberge, sacristain. Pour cette circonstance, l’église avait
revêtu sa toilette des grandes fêtes. Il y eut du chant fait par les
jeunes filles, enfants de Marie. L’orgue était tenu par M. Ernest
Couillard, ecclésiastique, cousin de la mariée.
Travaux
Un
ingénieur et quelques arpenteurs ont fait les travaux préliminaires
de la passe qui relie les deux lacs et de l’embouchure de la rivière
pour rendre la navigation possible jusqu’à St-Fabien. Les ouvriers
se sont mis à l’œuvre ces jours-ci et les travaux sont poussés avec
activité.
Bureau de poste
Un
nouveau bureau de poste a été ouvert dans la paroisse. Le nom de ce
bureau est Ville Réal. Le transport des malles partant du village à
ce bureau sera fait deux fois par jour. Le contrôle a été accordé à
M. Alfred Belzile. C’est une grande amélioration pour les gens du 4e
et du 5e rang.
Décès
-
Est décédé, à l’âge de 57 ans, Elzéar Bélanger, époux de dame Marie
Plourde. Il a été inhumé le 9 juin dernier.
-
Aussi vient d’être enlevé à l’affection des siens, à l’âge de 23
ans, Alfred Lévesque, étudiant au collège de St-Hyacinthe. Il était
le fils d’Elzéar Lévesque, commerçant. Son service et sa sépulture
ont eu lieu lundi le 23 du courant, à St-Mathieu au milieu d’un
grand concours de parents et d’amis. L’église avait la parure de
grand deuil. Le chant fut très réussi. Le premier cantique fut
chanté par M. Ernest Couillard. Le second La cloche tinte pour
les morts par M. E. Bellavance.
En
visite
-
Au presbytère, nous comptons plusieurs parents de M. le curé. C’est
M. Alphonse Cayouette, marchand de Ste-Justine, avec son épouse,
leur bébé et leur jeune fils Gaétan, puis Mlle Marie-Louise, sa
sœur, de Ste-Claire et une de ses belles-sœurs, Mme Fénelon
Cayouette de Ste-Justine.
-
Mme Georges Parent des Trois-Pistoles était en promenade à
St-Mathieu ces jours derniers.
Excursion Mercredi dernier, partaient du presbytère Mlle O. Richard, tante de M. le curé, Mlle Rose-Aimée, sa sœur, et leurs hôtes pour se rendre à la grève de St-Simon, sur l’aimable invitation de M. et Mme Nicole. La plus franche gaieté n’a cessé de régner pendant tout le trajet. Au retour, tous se rendirent à la jolie résidence de M. Nicole où un excellent souper leur fut servi. Mme et Mlle Marie-Thérèse surent, avec tout le tact et la gentillesse qu’on leur connaît, faire passer d’agréables heures à leurs hôtes. On fit de la musique et du chant. Bref, les excursionnistes reprirent le chemin du presbytère de St-Mathieu emportant le souvenir de leur jolie promenade et de la cordiale réception de M. et Mme A. Nicole. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6080
18 octobre 2021
Beurrerie et boîtes à beurre
Au temps de la colonisation, dès qu’une paroisse comptait
suffisamment de producteurs laitiers, une beurrerie ou une
fromagerie y était érigée. Antérieurement, les habitants
produisaient leur propre beurre. Ils le faisaient aussi par la suite
quand l’entreprise fermait en hiver.
Malgré la présence d’une beurrerie, certains cultivateurs avaient
leur propre installation comme c’est le cas pour Jean-Baptiste
Dionne de Saint-Mathieu-de-Rioux. C’est ce que nous rapporte Le
Soleil dans son édition du 14 février 1907 :
« M. J.-Baptiste Dionne, riche cultivateur, avait pour habitude de
fabriquer son beurre depuis plusieurs années. Il avait une laiterie
fort bien aménagée tel que séparateur à main Alpha, malaxeur,
glacière, etc. M. Dionne avait un beurre de laiterie de première
classe et obtenait tous les automnes le plus haut prix.
Au 1er avril 1906, après une rencontre avec son ami M.
Alphonse Nicole de Saint-Simon, il se décida de porter son lait à la
beurrerie de M. Alfred Belzile. Comme cette beurrerie est un vrai
modèle, il était confiant de l’avenir. Il a obtenu 35 $ par vache et
se propose de continuer à la beurrerie. Soit dit en passant que M.
Dionne a un beau troupeau de vaches et sa plus grande attention est
le soin de ses vaches. »
Le correspondant du journal en profite pour souligner la qualité des
boîtes à beurre provenant de Saint-Mathieu.
« Nous avons ici au milieu de notre paroisse une grande manufacture
de boîtes à beurre appartenant aux MM. Dionne. Ces deux messieurs
sont de vieux ouvriers d’expérience. Ils ont en partie fabriqué
leurs machines eux-mêmes afin de s’assurer du bon fonctionnement.
Aujourd’hui, ils peuvent sortir de cette manufacture 1000 boîtes par
jour.
Tout dernièrement, M. Nicole recevait un rapport des commerçants
d’Angleterre par l’entremise de l’importante maison qu’il
représente. Il était dit que le beurre venant du district de
Rimouski (1) donnait pleine et entière satisfaction et que les
boîtes étaient de qualité supérieure à toutes celles antérieurement
reçues. Nous devons être fiers de cette bonne note et nous
encourager à faire encore mieux à l’avenir. »
* * * * * * *
(1) Selon mes recherches, la manufacture de boîtes à beurre de Saint-Mathieu était alors la seule dans le district de Rimouski. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6065
9 octobre 2021
Décès de Pierre
Dionne
Dans son édition du 3 avril 1909, le journal L’Action sociale
nous informe du décès de Pierre Dionne de
Saint-Mathieu-de-Rioux :
« Dimanche, le 21 mars dernier, M. Pierre Dionne, époux de feu
Angèle Boucher, rendait son âme à Dieu, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec la plus parfaite résignation. Il
s’éteignit paisiblement entouré de ses enfants dans sa 88ème
année. C’était un des plus anciens colons de la paroisse et sa mort
a causé un deuil profond à la population toute entière car, par son
excellente conduite, il avait su gagner l’estime de tous ses
concitoyens.
Le
défunt laisse pour déplorer sa perte sept enfants dont voici les
noms : M. Jean Dionne, M. Jean-Baptiste Dionne, Mmes Joseph Jean et
Léon Vaillancourt, ceux-ci résidant dans la paroisse, M. Louis
Dionne, de Péribonka, Lac-St-Jean, M. Antoine Dionne de Oaktown,
Michigan, et M. Pierre Dionne, résidant aussi aux États-Unis. En
outre, il laisse à sa suite 123 petits-enfants. Il est le grand-père
de M. Antoine Dionne, de la Cie Dionne & Dionne et de M. Félix
Vaillancourt, gardien des lacs Cassette.
Ses funérailles ont eu lieu le 23 au milieu d’un nombre considérable
de parents et d’amis. »
Pierre Dionne est né vers 1821. Il est le fils de Pierre-Antoine
Dionne et d’Anastasie Martin. Il s’est marié le 8 août 1843 à
l’Isle-Verte. Son épouse, Angèle Boucher, est née le 26 juin 1817 à
l’Isle-Verte. Elle est la fille de Bénoni Boucher et de Félicité
Grandmaison.
Pierre Dionne est le grand-père de deux enfants qui se sont égarés au rang 5 de Saint-Mathieu le 25 octobre 1884 : Ferdinand Dionne, 12 ans, et Philias, 8 ans. Les deux enfants sont les fils de Jean-Baptiste Dionne et de Marguerite Gaudreau mariés le 7 mai 1867 à Saint-Mathieu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6050
30 septembre 2021
Nouvelles du 11
avril 1913
Dans son édition du 11 avril 1913, le Progrès du Golfe
publie
des nouvelles provenant de Saint-Mathieu-de-Rioux sous la signature
Fleur du pays.
Décès
- Le 3 mars, est décédé
Paul-Émile Étienne, enfant d’Arthur Ouellet et d’Alice Bélanger.
- Le 30 mars, est décédée Mlle
Clara Rousseau, âgée de 17 ans, fille d’Édouard Rousseau et
d’Aurélie Chassé.
- Le 4 avril est décédé M.
Joseph Plourde, à l'âge de soixante ans, époux de Victoria Lévesque.
Les funérailles qui ont eu lieu le 7 avril ont été très imposantes.
L’église était remplie d'une foule de parents et d'amis qui ont tenu
à rendre hommage à cet homme intègre qui ne laisse que des regrets
après hui. De son premier mariage, il eut deux enfants, dont une
fille vivante ; de son second mariage, il eut dix-neuf enfants en
tout 21 enfants, dont neuf sont morts. Son épouse et douze de ses
enfants lui survivent.
- Le lendemain 8 avril, avait
lieu l'inhumation de Mme Majorique Rousseau, née Geneviève Marquis.
Elle est décédée après une longue maladie soufferte avec une grande
résignation. Elle laisse pour pleurer sa perte un époux inconsolable
et 12 enfants vivants. Deux ou trois de ses enfants sont morts en
bas âge. Elle était âgée de 48 ans. Ses funérailles furent
solennelles et l’assistance nombreuse. Tous ont voulu témoigner à la
famille en deuil en quelle grande estime ils tenaient la défunte.
Ces deux personnes disparues
laissent dans chaque famille douze enfants vivants : vingt-quatre
orphelins qui regretteront longtemps, les uns leur père, et les
autres, leur mère.
Retour
Cinq familles absentes nous sont revenues dans la paroisse. Ce sont
les familles de M. Ludger Ouellet, de M. Adélard Ouellet, de M.
Ernest Jean qui étaient aux États-Unis depuis deux ans. M. Alexandre
Vézina, absent depuis un an est revenu dans sa maison du village. M.
Arthur Ouellet a vendu sa terre et réside maintenant au village.
Boîtes à beurre
La manufacture de boîtes à
beurre fonctionne encore. Elle a employé 21 hommes tout l'hiver.
Antoine Dionne, propriétaire de cette manufacture, a acheté le
moulin à scie de M. Joseph Bélanger.
Température
Nous sommes gratifiés d'une
température idéalement capricieuse. Une journée chaude et
ensoleillée nous fait croire au printemps vraiment arrivé. Le
lendemain, froid, neige, vent, tempête qui nous rejette en plein
hiver. Malgré cette inclémence du temps, le sucre est commencé.
Mariage M. Hermel Fournier, fils de M. Napoléon Fournier, a épousé Mlle Joséphine Thériault de Saint-Fabien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6040
24 septembre 2021
Décès de dame Pierre Talon
Dans son édition de 28 octobre 1904, le
journal Le Peuple nous apprend que deux citoyens de
Saint-Mathieu-de-Rioux sont des descendants d’intendants de la
Nouvelle-France. L’un des paroissiens est Pierre Talon dont
l’ancêtre est Jean Talon, le premier intendant résident
dont la gestion a été remarquable
(1665-1668 et
1670-1672). L’autre est Auguste Bigot dont l’ancêtre est François
Bigot, le dernier intendant dont les fraudes sont connues
(1748-1760). Ces liens de parenté apparaissent dans le texte
ci-après qui informe du décès d’une dame Talon de la paroisse :
« À St-Mathieu-de-Rioux, comté de Rimouski, est décédée le 19
courant, dame Pierre Julien Talon (née Céleste St-Laurent) à l’âge
avancé de 84 ans. Elle était la fille de feu Joseph St-Laurent de
Trois-Pistoles et épouse en premières noces de Joseph Bourgault du
même lieu. Elle était la sœur de feu Joseph St-Laurent, pilote, et
de feu Théophile St-Laurent, navigateur et marchand à Cacouna.
Le
père Talon, âgé lui-même de plus de 80 ans, est extrêmement affligé
de la perte de la compagne de sa vie. Il est l’ancien maître de
poste de St-Mathieu et il a occupé cette charge pendant longtemps.
Il est, nous assure-t-on, un des descendants de Jean Talon, premier
intendant de la Nouvelle-France. La noblesse de ses sentiments fait
croire qu’il a bien cette origine.
Chose singulière dans la même paroisse de St-Mathieu s’éteignait, à
la fin d’août dernier, Mme Auguste Bigot dont le mari est de la même
souche que le fameux intendant de ce nom. On dirait que les familles
des intendants du Canada se sont donné rendez-vous pour aller vivre
et mourir à St-Mathieu.
Les funérailles de Mme Talon ont eu lieu, samedi dernier à
St-Mathieu, au milieu d’un grand concours de paroissiens de
St-Mathieu, des Trois-Pistoles et des environs. » (Fin du texte
cité)
La
dame Bigot est Emma Lagacé qui est décédée le 18 août 1904 à
Saint-Mathieu à l’âge de 47 ans.
Je n’ai pas vérifié les liens de parenté entre Pierre et Jean Talon d’une part et entre Auguste et François Bigot d’autre part. Si c’est vrai, tant mieux. Si ce n’est pas vrai, cela est amusant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6015
9 septembre 2021
Noces
d’argent du curé Cayouette
Le journal L’Action sociale, un quotidien de
Québec, dans son édition du 8 octobre 1910, fait un compte-rendu de la
fête organisée
pour souligner le 25e
anniversaire de prêtrise du l’abbé J. A. Réal Cayouette, curé
de la paroisse depuis 10 ans. Voici ce texte :
« Lundi le 19 septembre,
c’était jour de fête à Saint-Mathieu. Le ciel était pur et le soleil
d’automne brillait d’un éclat inaccoutumé. Tout dans la nature
semblait s'harmoniser parfaitement avec les cœurs. C’était le 25e
anniversaire de prêtrise de notre curé M. l’abbé J. A. Cayouette.
Connaissant la modestie et l’humilité de notre curé qui ne voulait pas
de fête publique, nous n’avons pas voulu faire résonner trop haut les
échos de cette joyeuse journée mais la fête quoique privée avait
revêtu un cachet de distinction et de délicatesse.
MM. les abbés Riou, curé du
Bic, Amiot, curé de Saint-Simon, Lavoie, curé de Saint-Fabien, et M.
et Mme Alphonse Nicole de Saint-Simon et beaucoup d'autres sont venus
rehausser l'éclat de la fête par leur noble présence.
M. le curé reçut de nombreux
et riches cadeaux de la part de ses parents d'Ottawa, de sa famille
résidant à Sainte-Claire, de ses paroissiens et de ses amis. La joie
rayonnait sur tous les fronts et on semblait heureux de témoigner
quelque peu de reconnaissance à un si dévoué pasteur. Oh! … la
reconnaissance, ce chant du cœur, cette fumée de l’encensoir qui sans
cesse tend à s'élever vers le ciel, et que tout cœur bien né ne peut
laisser gésir au fond de son âme sans ressentir le poids de
l’ingratitude.
Le soir, il y eut réunion au
presbytère où la joie et la gaieté ne furent pas épargnées grâce à
l'amabilité de celui qui était l’objet de cette fête et à la
courtoisie des gentilles demoiselles R. A. Cayouette et de Mlle O.
Richard qui firent les honneurs de la maison de la manière la plus
gracieuse. Durant la soirée, on passa des rafraîchissements qui
semblaient activer davantage la conversation.
Le lendemain matin, il y eut
une messe de circonstance. L’église était décorée avec goût. Le chant
fut puissamment exécuté sous l'habile direction de notre organiste
Mlle Rose-Aimée Cayouette, sœur de M. le curé.
Notre vénéré curé est un des
pasteurs les plus zélés et les plus dévoués pour le troupeau dont il
est le gardien. Ses forces physiques plus faibles que son courage et
que son énergie semblent parfois défaillir sous le poids des fatigues
qu'impose son ministère. Il gouverne avec sagesse et bonté et depuis
les 11 ans qu’il réside au milieu de nous l’estime et la vénération
vont toujours grandissants dans le cœur de ses paroissiens qui
reconnaissent en lui un homme doué des plus grandes richesses
intellectuelles jointes à une bonté de cœur indéfinissable.
La correspondante répond
certainement aux sentiments des paroissiens en souhaitant à notre
pasteur une bonne et longue vie et qu’il reste longtemps à la place
qu’il occupe si bien. La paroisse de Saint-Mathieu contribuera à la
réalisation de ce souhait par ses prières et son obéissance à son
pieux pasteur. Donc à vingt-cinq ans aux noces d ’or. (1) » (Fin du
texte cité)
Le même journal publie
d’autres nouvelles ce jour-là.
-
M. Jos. Jean, marchand, est à se faire construire une jolie résidence
près de son magasin.
- M. le curé Thériault, de
Montmartre, Saskatchewan, était en visite au presbytère la semaine
dernière.
- Mlle Émilie Théberge,
institutrice à Saint-Simon, était de passage à Saint-Mathieu dimanche
dernier, en visite chez son père M. Alfred Théberge.
- M. Hermel Pelletier (2),
fils de M. Thomas Pelletier et d’Anna Lévesque, et Charles Rioux, fils
de M. Narcisse Rioux, sont partis pour le Séminaire de Rimouski. Un
autre fils de M. Rioux nous quittera bientôt pour entrer à l’institut
des Frères de la Croix de Jésus à Rimouski.
* * * * * * *
(1) Le curé Cayouette est
décédé subitement le 12 avril 1919 dans son presbytère de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
(2) Hermel Pelletier est né le 25 avril 1897. Il est le plus jeune d’une famille de 17 enfants. Il est le premier à être ordonné prêtre à Saint-Mathieu, le 25 juillet 1921. Il est curé de Saint-Simon pendant 25 ans. Il décède le 16 mai 1981. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 6000 18 juin 2021
Première messe
de Mathieu et Ulric Ouellet
Le 6 février 1949, Mgr Georges Courchesne ordonnait prêtres les deux
frères Mathieu et Ulric Ouellet à Rimouski. Le lendemain, ceux-ci
disaient leur première messe dans leur paroisse natale,
Saint-Mathieu-de-Rioux. Voici de larges extraits d’un texte paru dans le
Progrès du Golfe, édition du 11 février 1949 :
« C’est toute une paroisse qui a chanté l’hymne de reconnaissance au
Seigneur pour avoir choisi trois fils prêtres dans la famille de M. et
Mme Émile Ouellet, de Saint-Mathieu.
Mgr l’Archevêque était assisté dimanche de M. le chanoine Louis Martin,
supérieur du Séminaire, et de M. l’abbé Louis Lévesque, directeur du
Grand Séminaire. Cérémoniaire : M. l’abbé Édouard Courcy,
ecclésiastique. »
Suit une liste de 28 noms de prêtres qui occupaient le chœur.
« Le parrain d’ordination et le prêtre assistant de M. l’abbé Mathieu
Ouellet était M. l’abbé Élie Beaulieu, son cousin ; celui de M. l’abbé
Ulric Ouellet était M. l’abbé Louis-Joseph Lavoie, curé de
Saint-Mathieu.
Le lendemain lundi, les deux jeunes prêtres célébraient leur première
messe en l’église de Saint-Mathieu, que remplissait la foule. La chorale
paroissiale exécuta la messe du jour et des chants de circonstance. Au
prône, M. l’abbé Hermel Pelletier, curé de Saint-Simon, se fit
l’interprète des paroissiens de Saint-Mathieu pour féliciter les deux
nouveaux élus, les deuxième et troisième de cette même famille, et pour
rendre hommage à M. et Mme Émile Ouellet qui se sont imposé de lourds
sacrifices afin de répondre à l’appel du Seigneur. Il loua le ministère
du prêtre et expliqua la sublime grandeur humaine et divine de la
vocation sacerdotale.
M. l’abbé Mathieu Ouellet célébra sa première messe à l’autel majeur
(Saint-Mathieu) et M. l’abbé Ulric Ouellet à l’autel de la
Sainte-Vierge. C’était émouvant et l’assistance, impressionnée par le
spectacle de ces deux frères célébrant en même temps leur première messe
dans l’église paroissiale, priait avec une piété vraiment édifiante. »
Suit une liste de neuf prêtres qui assistaient les deux frères.
« Au premier rang de l’assistance, on remarquait les parents des abbés
Ouellet, M. et Mme J.-Émile Ouellet (Célina Bérubé), leurs frères et
sœurs, Sœur Saint-Edgar s. m. de l’Hôpital Sainte-Marie de
Trois-Rivières, M. et Mme Gérard Ouellet (Germaine Parent), M. et Mme
Raoul Vignola (Adrienne Ouellet), M. et Mme Louis Ouellet (Laura
Vaillancourt), M. et Mme Adrien Ouellet (Marie Ouellet), Mlle Claire,
MM. Dominique et Jacques Ouellet, leur tante Sœur Ange-Marie, s. m. »
Suit une liste de plus de 80 noms d’oncles et de tantes, de cousins et
de cousines.
« À l’issue de la messe, un banquet fut servi à la maison paternelle, réunissant autour des deux nouveaux prêtres, un grand nombre de parents et d’amis, y compris tous les prêtres présents à la première messe. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5980
6 juin 2021
M. Edmond Pelletier (de Rimouski), le propriétaire, a montré beaucoup
d’énergie, de zèle et de courage pour l’érection de cette bâtisse qui
est construite sur un très beau plan, et qui ne laisse rien à désirer
sous tous les rapports pour la fabrication d’un bon fromage.
La direction de la fabrication est confiée à M. Louis Soucy qui a
beaucoup d’expérience dans cette ligne, et qui, sans doute, donnera
satisfaction à tous les patrons. Le comité nommé pour la direction de
l'association est composé de membres intelligents, entre autres M. le
curé, L. C. H. Tremblay, nommé président honoraire, et M. Théophile
Lévesque, nommé secrétaire. Ce dernier s’est montré fort zélé et
courageux pour arriver à la création de cette fabrique, et comme
surveillant, il ne manquera pas d’être utile au fabricant pour la
comptabilité, tant par sa capacité que par sa bonne volonté.
En somme, tout promet de bien marcher dans l’intérêt de la localité. »
(Fin du texte cité »
Dans Saint-Mathieu raconte son histoire, l’auteur de ce blogue
décrit comment la fromagerie a dû fermer ses portes.
« Le rêve du curé tourne au cauchemar quand, un an après la signature du
contrat, la bisbille s’installe entre le fromager et la société. Le
groupe représenté par Johnny Bérubé, époux d’Emma Vaillancourt, reproche
à M. Pelletier de ne pas respecter ses engagements. Le 30 avril 1889, un
mandat de comparution est adressé au propriétaire.
Le jugement tombe le 24 septembre. Le tribunal donne raison aux
producteurs laitiers. Joseph-Edmond Pelletier va en appel et finalement
se désiste. La fromagerie est saisie et mise en vente. C’est Alphonse
Nicole, beurrier de Saint-Simon, qui en fait l’acquisition. L’aventure
n’aura duré que 20 mois. » (Fin du texte cité »
Dans son édition du 22 février 1890, la
Gazette officielle du Québec
annonce la mise en vente de la fromagerie. Voici le texte :
« Jean alias Johnny Bérubé, de la paroisse de Saint-Mathieu,
cultivateur, demandeur ; contre Joseph Edmond Pelletier, du même lieu,
fromager, actuellement de Ia ville de Saint-Germain de Rimouski,
défendeur, et Jules Lapointe et al., mis en cause, savoir :
Un emplacement sis et situé au premier rang de la paroisse de Saint-
Mathieu, contenant cinquante pieds de front sur cinquante pieds de
profondeur; borné au nord, au sud et à l'ouest à Vital Rousseau, et à
l’est à la route – avec fromagerie et autres bâtisses dessus
construites, et dépendances, formant partie du lot numéro
soixante-quatorze (74), du cadastre officiel de ladite paroisse de
Saint-Mathieu. Pour être vendu à la porte de l'église de la paroisse de Saint-Mathieu dans le district de Rimouski, le vingt-sixième jour d'avril prochain, mil huit cent quatre-vingt-dix, à onze heures de l'avant -midi. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5955
21 mai 2021
Une histoire d’élections
Dans son édition du 29 mars 1963, le Progrès du Golfe révèle la
liste des candidats officiels en vue des élections fédérales devant se
tenir le 8 avril suivant. On y trouve six candidats dont trois portent
le même nom : Gérard Ouellet. À l’époque au fédéral, le bulletin de vote
n’indiquait pas le parti. En cas de noms identiques, le métier et
le lieu de résidence étaient donnés. Voici ce que le journal raconte :
« La présentation officielle des candidats, le lundi 25 mars, a créé une
certaine stupéfaction chez les électeurs du comté de Rimouski. Outre les
candidats des quatre partis engagés dans la présente campagne, deux
autres citoyens ont posé leur candidature, ce qui portait à six le
nombre des candidats.
Mais dès mercredi matin, Me Derome Asselin, président d'élection dans le
comté de Rimouski, nous révélait qu’un candidat libéral indépendant du
nom de Gérard Ouellet, journalier de St-Mathieu, s'était retiré de la
lutte. Enfin, jeudi matin, Me Asselin nous confirmait qu'un autre
fantôme, candidat créditiste indépendant celui-là, s'était retiré de la
lutte. Ce qui laisse donc sur les rangs quatre candidats officiels dans
la circonscription de Rimouski.
M. Gérard Légaré, député sortant de charge, brigue à nouveau les
suffrages sous l'étendard libéral. M. Raymond D'Auteuil, de Rimouski, se
présente sous l'étiquette NPD. M. Fernand Dionne, de Mont-Joli, est le
candidat du parti Progressiste-Conservateur. M. Gérard Ouellet
(cultivateur) de
Outre Gérard Ouellet qui n'a pas retiré sa candidature et qui est un
citoyen de Saint-Mathieu-de-Rioux, un autre candidat Fernand Dionne est
natif de la même paroisse. Il est le fils de Gracia Ouellet et d’Onésime
Dionne, ancien maire de Saint-Mathieu pendant 20 ans et préfet du comté
de Rimouski pendant huit ans. Des quatre candidats à cette élection,
Gérard Ouellet en sortit vainqueur.
Selon le document des mises en candidature, deux Gérard Ouellet
résidaient à Saint-Mathieu et le troisième à Sacré-Cœur (Rimouski). Le
candidat créditiste qui ne s’est pas désisté est celui du centre dans ce
document qui donne le nom des personnes qui ont appuyé la candidature
des trois Gérard Ouellet.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5935
9 mai 2021
Olivier Vaillancourt et les pilules Moro
Dans son édition du 3 octobre 1908, le journal La Presse présente
un paroissien de Saint-Mathieu-de-Rioux qui a eu recours à une équipe
médicale pour soulager ses problèmes de santé. Le journal écrit :
« Aujourd’hui, nous publions le certificat de M. Olivier Vaillancourt,
de Saint-Mathieu, qui attribue sa guérison à l’usage des Pilules Moro.
Voici ce qu’il dit :
Olivier Vaillancourt, Saint-Mathieu, comté de Rimouski. »
Olivier Vaillancourt est né le 2 juillet 1834 à Saint-Simon. Il est le
fils de Célestin Vaillancourt et de Marcelline Thibault. Il épouse
Hélène Émond le 21 janvier 1861 à Saint-Simon. Comme les registres de
Saint-Mathieu-de-Rioux n’étaient pas ouverts lors du mariage, on présume
qu’il demeurait à Saint-Mathieu.
En 1878, il est propriétaire d’une terre au rang 5 et, en 1881, il
est nommé syndic pour la surveillance des travaux de la construction du
presbytère. En 1895, il épouse, en secondes noces, Adèle Lagacé, fille
d’Amable Lagacé et de Christine Pelletier. Il décède à Saint-Mathieu le
18 mai 1914 à l’âge de 79 ans.
De son premier mariage, Olivier Vaillancourt a huit enfants : Démerise
(née en 1862), Ferdinand (1866), Odila (1868), Emma (1870),
Jean-Baptiste (1871), Amanda (1875), Émélie (1877) et Elmire.
Au moment où il écrit sa lettre, Olivier Vaillancourt a 74 ans.
D’autres personnes de Saint-Mathieu-de-Rioux ont également participé à
des publicités dans les journaux.
Le curé Réal Cayouette
et le vin de Carmes en 1901
(# 5245).
Édouard Rousseau et les pilules Moro en 1907
(# 5195). Laura Théberge et les tablettes Baby’s Own en 1917 (# 5245). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5915
27 avril 2021
La loi des
12 enfants vivants
En 1890, pour atténuer
l’exode des québécois vers les États-Unis, le gouvernement du Québec
dirigé par Honoré Mercier fait voter une loi qui vise à encourager à la
fois la colonisation et la forte natalité. Cette loi accorde
gratuitement un lot de 100 acres, ou de quatre arpents de front, aux
parents de 12 enfants vivants et nés d’un mariage légitime.
La loi qui est en
vigueur jusqu’en mai 1905 connaît des changements au cours de son
application. Ainsi, pendant un temps, la prime de 50 $ est ajoutée au
lot. En un autre temps, ceux dont le dossier est accepté peuvent choisir
la prime de 50 $ au lieu du lot.
Sauf pour ceux qui louent leur terre ou qui la squattent, les lots
octroyés sont en bois debout et sans bâtisses. Ils sont situés dans des
cantons en début de colonisation. Le bénéficiaire du lot peut le céder à
un fils ou à un gendre
qui le veut
bien et qui doit s’expatrier. Il peut même le
vendre même si sa valeur marchande est au plus bas.
À
l’époque, selon Arthur Buies,
les jeunes gens manifestent un goût
de moins en moins prononcé pour le dur labeur lié au défrichement. Tout
cela parce qu’ils ont été habitués à travailler sur une terre faite et
avec des bâtisses. Pour cette raison, le programme du gouvernement n’a
pas eu les effets escomptés.
J’ai trouvé la liste
des 17 chefs de familles de Saint-Mathieu-de-Rioux qui se sont prévalus
des dispositions de cette loi. Huit ont été bénéficiaires d’une terre
et/ou de 50 $. Le lieu du lot choisi est alors indiqué. De plus, 9 ont
opté pour la prime de 50 $.
Bénéficiaires d’une terre
et/ou de 50 $ (8)
• Michel Parent et Célina Landry
(15 enfants)
Une terre à Ristigouche
(Bonaventure), rang 7, lot 16
• Cyprien Bélanger et Marie-Louise
Boulanger (13 enfants)
Une terre à Armagh (Bellechasse),
rang 5 nord-ouest, lot ? et prime de 50 $
• Sévérin Dubé et Émélie Bélanger
(13 enfants)
Une terre à Armagh (Bellechasse),
rang 5 sud-ouest, lot 33 et prime de 50 $
• Majorique Rousseau et Marie
Lagacé (12 enfants)
Époux en premières noces de
Desanges Vaillancourt (6 enfants)
Une terre à Ashburton (Montmagny),
rang 7, lot 16 et prime de 50$
• François Parent et Emma Dionne
(12 enfants)
Une terre à Ashburton (Montmagny),
rang 7, lot 18 et prime de 50 $
• Pascal Gaudreau et Aglaé Boucher
(13 enfants )
Une terre à Ashburton (Montmagny),
rang 7, lot 20 et prime de 50 $
• Joseph Plourde et Victoria
Levesque (19 enfants)
Une terre à Raudot (Témiscouata),
rang 3, lot 47 et prime de 50 $
• Édouard Ouellet et Rosalie
Chouinard (16 enfants)
Une terre à Raudot (Témiscouata),
rang 3, lot 49 et prime de 50 $
Bénéficiaires de la prime
de 50 $ (9)
• Thomas Bélanger et Marie-Célina
Gagnon (19 enfants)
• Johnny Bérubé et Emma
Vaillancourt (10 enfants)
Époux en premières noces
d’Antoinette Gauvin (3 enfants)
• Jean Couturier et Adèle Lagacé
Époux en premières noces de Suzanne
Bourgouin et en secondes noces d’Ursule Garon
• Jean-Baptiste Dionne et Aglaé
Rioux (13 enfants)
• Jean-Baptiste Lepage et Joséphine
Bérubé (15 enfants)
• Joseph Lagacé et Rose-Anna
Ouellet (4 enfants)
Époux en premières noces de
Démerise Vaillancourt (10 enfants)
• François Ouellet et Rose-Odila
Vaillancourt (11 enfants)
Époux en premières noces de
Vitaline Gravel (7 enfants)
• Guillaume Rousseau et Clémentine
Côté (6 enfants)
Époux en premières noces de
Marie-Louise Michaud (6 enfants)
• Majorique Rousseau et Geneviève Marquis (15 enfants) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5895
15 avril 2021 Nouvelles du 26 mai 1910
Dans
son édition du 26 mai 1910, le journal l’Action sociale publie des
nouvelles provenant de Saint-Mathieu-de-Rioux
Baptêmes
- Marie Georgienne Lucienne, fille de Thomas Lagacé et de Rose Lavoie.
Parrain et marraine : M. et Mme Narcisse Jean.
- M. Élise Candide, fille de Théophile Jean et d’Élise Boucher. Parrain
et marraine : M. et Mme Jos. Paradis.
- Jos. Charles-Eugène, fils de Charles D’Auteuil et d’Émilia Dionne.
Parrain et marraine : M. et Mme Noël Girouard.
- Charles-Eugène, fils d’Ernest Jean et de Cédulie Gaudreau. Parrain et
marraine : M. et Mme Pierre Thibault.
- Jos. Ovide, fils de Gonzague Moreau et d’Adèle Lepage. Parrain et
marraine : M. et Mme Honoré Chouinard.
- Jos. Pierre Adélard, fils d’Adélard D’Auteuil et d’Elmire Gaudreau.
Parrain et marraine : M. et Mme Pascal Gaudreau.
- M. Louise, fille de Jérémie Jean et de Malvina Gagnon. Parrain et
marraine : M. et Mme Johnny Jean.
Décès
Le 19 du mois courant, eurent lieu les funérailles de Mme Élise Boucher,
41 ans, (photo ci-contre) épouse de Théophile Jean. Elle laisse pour
déplorer sa perte 11 enfants dont plusieurs en bas âge. M. Théophile
Jean est aussi malade depuis quelques jours. Espérons que Dieu
n’éprouvera pas davantage ces chers petits en leur enlevant leur père.
(Note. Parmi les baptêmes ci-avant, apparaît la fille d’Élise Boucher et
de Théophile Jean.)
Le 22 est décédée Virginie Lévesque, épouse de Zacharie Côté. Ses
funérailles auront lieu jeudi. Elle était âgée de 76 ans.
Première communion
Le 11 mai, M. le curé a fait faire la première communion à 28 enfants de
cette paroisse.
Le mois de Marie
Les exercices du mois de Marie ont été bien suivis. Tous les soirs, il y
eut du chant par les jeunes filles du village.
En promenade Mme Vve François Ouellet, de Trois-Pistoles, ainsi que sa fille, sont en promenade chez M. François Ouellet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5870
30 mars 2021
L’incendie de
1860
En 1860,
il y a déjà 30 ans que le premier arbre
a été abattu à Saint-Mathieu-de-Rioux.
La paroisse est érigée
canoniquement depuis deux ans. Le curé de Saint-Simon est alors
desservant. Il le sera jusqu’à l’arrivée du premier curé en 1866.
Comme tous les actes religieux et civils sont
enregistrés à Saint-Simon, on ne connaît pas le nombre exact d’habitants
de Saint-Mathieu en 1860. Toutefois, il est raisonnable de penser que la population y était
d’au moins 650 personnes.
L’incendie à Saint-Épiphane
À l’été 1860, une bonne partie du Québec est touchée
par des incendies majeurs. Dans son édition du 2 mars 1863, la
Gazette des campagnes explique la situation vécue trois ans
auparavant en présentant les causes de l’incendie à Saint-Épiphane, une
paroisse près de Rivière-de-Loup.
« Nous sommes à l’été 1860. Pendant plusieurs
semaines, un soleil ardent, une chaleur étouffante avait asséché la
terre ; point de pluie depuis plus d’un mois. Le feu, allumé dans les
bois voisins ou conservé dans des anciens abattis, attiré, rallumé par
un fort vent d'ouest, s’est élevé tout-à-coup ; et voilà qu’il
s’agrandit, s’avance, s’approche des champs ensemencés et des demeures
des colons. Des efforts vigoureux, inouïs, sont faits pour arrêter
l'élément destructeur. C’est en vain ! ... En quelques heures, plusieurs
maisons, granges et autres bâtisses, ainsi que près de 500 minots (1) de
grain ensemencé, sont devenues la proie des flammes. C’était le 7
juillet. »
L’incendie a pu progresser d’une paroisse voisine à
l’autre. Ou encore, elle s’est déclarée dans les mêmes conditions dans
d’autres paroisses.
L’incendie aux Trois-Pistoles
Dans son édition du 3 août 1860, le journal Le
Franco-Canadien décrit les ravages causés par l’incendie aux
Trois-Pistoles qui se traduisent en pertes considérables. Le
correspondant écrit : « Je
ne parle que pour la paroisse de Trois-Pistoles, laissant aux autres
paroisses le soin de faire connaître leur misère.
Maisons
incendiées : 28
Granges incendiées : 28
Grains de semence : 661 minots
Patates : 96 minots
Têtes de bétail : 43
Familles ayant perdu par le feu leurs habitations, ménages, semences et
fourrages : 30
Nombre d’individus dans ces familles : 159
Familles qui n‘ont
sauvé que leurs bâtisses : 17
Personnes ayant perdu par le feu une partie de leur
semence et de leur fourrage : 18
Les bois en
arrière de notre paroisse sont incendiés sur une superficie d’au moins
40 milles. Un seul enfant est mort des suites de ses brûlures, mais
beaucoup d’autres ont été atteints par les flammes. Il n’y a personne de
disparu. »
Le correspondant raconte qu’une rumeur a circulé à
l’effet qu’une femme de Saint-Éloi s’est réfugiée dans un étang avec ses
enfants et qu’elle était en compagnie d’un ours et d’un orignal.
Pour ce correspondant, l’information est fausse. Il
explique ce qui, selon lui, a donné lieu à cette rumeur : « Six hommes
étaient occupés dans le township Bégon (Saint-Jean-de-Dieu) à préparer
le bois d’une grange ; surpris par l’élément destructeur, ils ont couru
se réfugier dans une petite rivière où ils ont passé trois terribles
heures à s’entre-jeter de l’eau pour s’empêcher de brûler. À quelques
pas d’eux était un ours qui, lui aussi, faisait de son mieux pour se
protéger du feu. Ils avaient avec eux un cheval et c’est lui qu’on aura
transformé en orignal ; car à part lui et l’ours, il n’y avait
avec eux que des lièvres. »
Les secours arrivent
Certaines paroisses des comtés de Kamouraska et de
l’Islet ont été épargnés par ce terrible fléau et la récolte y a été
abondante. Aussi, les brûlés de Trois-Pistoles et des environs ont été
secourus par des connaissances, des parents et des amis de ces
paroisses.
« Chaque jour, la charité distribuait le blé, la
viande, le linge et l’argent pour secourir les malheureuses victimes, et
cela avec une bienveillance, une sympathie et une générosité dignes des
plus beaux éloges. »
(2)
Les colons purent ainsi nourrir leurs familles et
empêcher leurs animaux de mourir de faim pendant l’hiver de 1861.
Toutefois, comme beaucoup de colons par manque d’argent
ne pouvaient pas se procurer de grains de semence, les curés des
localités incendiées se réunirent à l’Isle-Verte pour préparer une
demande d’aide au Gouvernement. Ce dernier, après hésitation, acquiesça
à la demande et remis entre les mains des curés des montants d’argent
qu’il devait distribuer aux colons « au meilleur de leur connaissance et
conscience. » (3)
Conclusion
En 1860, les surfaces cultivables des rangs 3, 4 et 5 sont habitées
en bonne partie. Il est à espérer que le feu ne s’est pas répandu sur le
territoire de la paroisse.
Toutefois, on sait que le
feu ne connaît pas de frontières. Aussi, vu l’ampleur de la
catastrophe à Trois-Pistoles, il est peu probable que la paroisse de
Saint-Mathieu ait été complètement épargnée.
……….
(1) Un minot de grain correspond à 60 livres ou environ
27 kilogrammes.
(2)
Gazette des
campagnes : journal du cultivateur et du colon, 2 mars 1863
(3) Idem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5850
18 mars 2021
Un curé affligé
Joseph-Octave Béland est né à Québec le 7 décembre 1822. Il est ordonné
prêtre dans sa ville natale le 18 septembre 1852 alors que le diocèse de
Rimouski n’existe pas encore. Il deviendra le deuxième curé de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Premières fonctions
L’un de ses anciens paroissiens de Ste-Julie a écrit (1) : « M. Béland était bien le curé qu'il fallait à Sainte-Julie. Courageux, d'une santé robuste, d'une charité et d'un zèle apostoliques, il ne se laissait jamais abattre par les difficultés. Son temps se partageait entre les travaux du ministère et les travaux des champs. Il était prêtre et défricheur. C'est lui qui a commencé le défrichement de la terre de la fabrique. Au besoin, il se mêlait aux ouvriers et travaillait comme eux. M. Béland a fait terminer l'intérieur de l'église. Il a été sept ans curé de Sainte-Julie. »
Les citoyens de Sainte-Julie ont conservé un souvenir impérissable de
son passage dans la paroisse, car lors de sa mort on peut lire ce
témoignage (2) :
« Les anciens savent qu’il a vécu ici dans les privations, parce que ses revenus étaient fort minimes. Cependant cette pauvreté n’a pas ralenti son courage et son dévouement pour le bien spirituel et le développement matériel de cette paroisse naissante. Malgré les sacrifices qu'il lui a fallu faire, il ne s'est jamais départi de sa gaieté habituelle. »
En
1861, il est nommé curé de Saint-Victor de Tring ; en 1865, missionnaire
à la Pointe-aux-Esquimaux et en 1867, curé de Saint-Anaclet.
À
Saint-Mathieu-de-Rioux
À
l’automne 1871, la paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux est en
effervescence. La
discorde sévit entre deux clans : l’un est en faveur de la construction
d’une église, l’autre est contre. Dans le cadre de cette guerre des
clans, une agression armée se produit. Melchior Jean attaque à coups de
hache l’un de ses coparoissiens, Thomas Charest. C’est le geste ultime
qui incite l’évêque de Rimouski à retirer le jeune curé de 33 ans,
Antoine Chouinard. Pour calmer les ardeurs des paroissiens et en même
temps pour les punir, l’évêque ne désigne pas de curé. Il nomme un
desservant avec résidence à Saint-Simon. L’élu est l’abbé Joseph-Octave
Béland.
À cause du choc
de la perte d’un curé, les paroissiens de Saint-Mathieu
réussissent à s’entendre et la construction de l’église commence.
En février
1872, l’abbé Béland devient le deuxième curé de Saint-Mathieu.
La
pierre angulaire de l'église est bénie le 3 septembre de la même année.
Malheureusement, en 1874, la maladie l’atteint et il doit quitter son
poste. En considérant l’ensemble de sa vie, il est raisonnable de penser
qu’il s’agit d’une maladie mentale. Il demeure au repos jusqu’en 1879
alors qu’il est nommé curé de Saint-Joseph-de-Lepage. Un an plus tard,
il doit encore abandonner son poste. Il est en retrait pendant quatre
ans. En 1884, il reprend ses fonctions comme curé de
Saint-Joseph-de-Lepage.
Nouvel abandon
En
1887, un événement tragique survient. « Ayant par
mégarde pris un jour du poison en guise de remède, il a pu, grâce à sa
forte constitution, échapper à Ia mort, mais ses jambes se sont
couvertes de plaies qui l’ont fait souffrir jusqu'aux derniers jours de
sa vie. » (3) Devenu impotent, il quitte sa cure de
Saint-Joseph-de-Lepage pour prendre une retraite définitive.
Il est admis à
l'hospice Saint-Jean-de-Dieu de Montréal, un institut psychiatrique qui
plus tard deviendra l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.
Les Sœurs de la Providence l’ont accueilli chez elles avec dévouement et
compassion. Voici un témoignage de sa haute piété :
« Il a témoigné sa reconnaissance à ses
bienfaitrices par sa piété et ses prières, et les a édifiées par sa
patience et son abandon à Dieu. Ne pouvant plus dire sa sainte messe
depuis une couple d’années, il assistait à celle de la communauté et
faisait la communion chaque matin. Dans l’après-midi, il passait 3 à 4
heures en présence du St-Sacrement. On le regardait comme un saint
prêtre, et on l'avait en vénération et en haute estime. » (4)
L’abbé Joseph-Octave Béland décède le 4 novembre 1900 après avoir
séjourné à l’hospice pendant 13 ans. Il était âgé de 77 ans et 11 mois.
Requiescat in pace.
* * * * *
(1) Recherches historiques, vol. 7, bulletin publié par
Pierre-Georges Roy, janvier 1901.
(2)
Journal
L’Écho des Bois-Francs, Victoriaville, 17 novembre 1900.
(3) Ibidem (4) Ibidem
* La photo de
l’abbé Béland a été puisée dans Bulletin des recherches historiques,
avril 1901. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5840 12 mars 2021
Nouvelles du 31 octobre 1912
Dans son édition du 31 octobre 1912,
le journal l’Action
sociale publie des nouvelles provenant de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Le 17 octobre, s’éteignait Mme Vve Louis Couillard, née Démerise
Rousseau. Elle était la sœur de Mme Alfred Théberge chez qui elle est
décédée. Mme Couillard était âgée de 63 ans. Elle a lentement été
emportée par une maladie de cœur qui la faisait parfois violemment
souffrir. Sa mort fut vraiment consolante. Aussi avait-elle passé une
vie exemplaire, remplie d’exemples de piété, de dévouement et de
courage.
Elle laisse pour lui survivre 6 garçons dont l’un, M. Ernest Couillard,
est étudiant au Grand Séminaire de Rimouski.
Son service et sa sépulture ont eu lieu le 21 octobre à Saint-Mathieu.
Grand nombre de personnes de Saint-Simon où elle a vécu longtemps ont
tenu à rendre un dernier témoignage d’estime à la défunte en assistant à
ses funérailles. Parmi ceux de Saint-Simon, on remarquait M. et Mme Jos
Lévesque, M. et Mme Xavier Théberge, M. Siméon Fortin, M. Marcel
Théberge et plusieurs autres. Ses quatre fils portaient le corps. Son neveu, M. Émile Théberge, portait la croix. On remarquait au chœur M. le curé Amiot, de Saint-Simon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5820
27 février
2021
La famine de la décennie 1830
En 1830, Michel Jean s’installe au troisième rang
de
Saint-Simon-de-la-Baie-Ha! Ha! (1), aujourd’hui faisant partie de
Saint-Mathieu-de-Rioux. Au cours de cette décennie,
le mouvement de colonisation y progresse lentement. De nouveaux chefs de
famille viennent occuper les terres d’abord celles du village actuel et
celles contigües à l’ouest.
Au plan national,
la décennie 1830 est marquée par le mouvement des patriotes qui conduit
aux troubles de 1837-1838 et par une crise économique qui affecte autant
les gens de la campagne que des villes. Cette crise économique a comme
origine la perte de récolte de céréales causée en grande partie par des
gels hâtifs en automne. Les pertes sont tellement importantes qu’elles
conduisent à la famine dans plusieurs régions du Québec.
On ne connaît pas en détails l’ampleur de la crise
sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Rioux, mais on peut présumer que
les conséquences sont à peu près les mêmes que celles des autres
paroisses voisines touchées.
Les hivers 1833 et 1834
Le premier gel hâtif de cette décennie a lieu à
l’automne 1832. Une grande partie des récoltes particulièrement de
grains est avariée ou détruite. Le même scénario se produit à l’automne
1833. Selon les journaux de l’époque, l’est du Québec est
particulièrement touché par ces pertes qui conduisent sans pitié vers
une famine sévère. Les comtés visés sont ceux de Saguenay, de
Bellechasse, de Kamouraska, de Beauce et de Rimouski, ce dernier
s’étendant de Rivière-du-Loup à Matane.
L’hiver 1833 et pire encore celui de 1834 s’avèrent
pénibles. La famine provoque une grande détresse dans la population et
principalement chez les chefs de famille. Ceux-ci ont peur de voir
mourir les leurs à petit feu, mais aussi de ne pas pouvoir se procurer
des grains de semence à crédit pour mettre en terre au prochain
printemps. Certains vont jusqu’à surhypothéquer leur terre pour payer
les denrées alimentaires et craignent qu’à un moment donné le crédit ne
sera plus disponible.
Dans un
premier temps, des quêtes sont menées dans les églises pour venir en
aide aux plus touchés par la famine. Les curés s’impliquent dans la
distribution de l’argent récolté. Malgré bien des efforts, la situation
devient tellement alarmante que les curés et les notables de ces lieux
se tournent vers le Parlement provincial du Bas-Canada. La Chambre
d’assemblée forme
un comité spécial appelé
Comité sur les requêtes des paroisses en détresse.
Témoignages dans le comté de Rimouski
Dans l’édition du 5 février
1834, le journal Le Canadien publie un résumé du rapport du
comité spécial. Voici un aperçu des témoignages dans les
paroisses du comté de Rimouski :
• Messire Mailloux, curé de la
Rivière-du-Loup : « Sur le chemin du lac Témiscouata, sur 80 quelques
habitants, un seul a de quoi vivre. Déjà des enfants, en allant à
l’école, sont tombés en faiblesse, d’autres ont passé deux jours sans
prendre de nourriture, 8 familles n’ont absolument rien (à manger), 10
autres à la Rivière, locataires, ne trouvent rien à gagner, et le peu
qu’ils avaient a péri. »
• Messire Roy, curé de
Cacouna : « Environ 23 à 30 familles n’ont les uns rien, les autres
presque rien récolté ; ce qu’ils ont d’animaux va être leur seul soutien
jusque vers la fin de février. Tous les habitants, excepté 5 ou 6, ont
souffert plus ou moins ».
• Messire Béland, curé de
l’Isle-Verte : « Il est à craindre, si on n’a pas quelque secours, que
quelques-uns ne meurent de faim cet hiver ; 72 familles pourront à peine
subsister deux ou trois mois. »
• Messire Fortier, curé de
Trois-Pistoles et, en plus, desservant de Saint-Simon et
de Saint-Fabien : « Sur la récolte de 1832,
dans Saint-Fabien, deux habitants seulement m’ont payé la dîme (2) : ce
qui m’a donné trois minots et demi de mauvais grains. Dans cette
paroisse, 30 familles vont être à bout ; il y en a déjà qui n’ont rien
(à manger). Sur 135 familles dans Saint-Simon et 271 dans les
Trois-Pistoles, le tiers commence déjà à manquer de tout : c’est la
deuxième année que tout manque. Malgré tous nos efforts, il est certain
que plusieurs périront de faim si la Providence ne vient à leur
secours. »
• M. Destroismaisons, curé de
Rimouski, dit que dans Rimouski et Sainte-Cécile du Bic, 75 familles
sont dans un véritable état de détresse, dont la plupart n’ont seulement
pas une vache. Il ajoute que Sainte-Luce et Sainte-Flavie sont en
détresse dans la même proportion. « Dans les deux Matane, dit-il, il est
probable que 22 familles manqueront de nourriture dès le mois de
février. »
• M. Rivard de Rimouski : « À
sa connaissance, nombre de familles de Saint-Fabien, Sainte-Cécile et
une partie de Rimouski, n’avaient plus aucune nourriture à la fin de
décembre. Il connaît un chef de famille, avec trois enfants, qui a passé
trois jours sans manger. La gelée y aurait détruit toutes les
céréales ».
Recommandations du comité
spécial
Le comité spécial sur la détresse recommande de
secourir 527 familles dans le comté de Rimouski. Voici la répartition :
Le Parlement
se prononce
Des débats ont
lieu au Parlement. Les uns parmi les élus sont d’accord pour verser des
subsides aux victimes de la famine ; d’autres comme Louis-Joseph
Papineau s’opposent à ce que l’on aide sans conditions. Celui-ci
préfèrerait des prêts qui seraient garantis par les bénéficiaires ou par
des notables des paroisses. Il argue dans une formule lapidaire : «
Notre
objet sera donc d'aider des
gens qui ne s'aident pas eux-mêmes, et qui se contentent de demander ».
Toujours
est-il que, le 25 février 1834,
le Parlement vote 4629 livres pour
secourir les paroisses en détresse de tout l’est du Québec. Il décide
que cette somme sera donnée en pur don aux habitants des paroisses
concernées.
Cette somme doit être
administrée par le curé en concertation avec les marguilliers. Pour
s’assurer que l’argent aille aux personnes vraiment nécessiteuses, un
comité de surveillance d’au moins neuf cultivateurs devait être formé
par paroisse. L’argent devait « servir à l’achat de grains et de patates
de semence pour les cultivateurs qui, sans secours, ne pourraient pas
ensemencer leurs terres. » De cette somme, Trois-Pistoles et Saint-Simon
devaient recevoir 332 livres.
Il semble que le montant total
de 4629 livres n’est pas très élevé si on considère que le comité avait
ciblé 2243 familles dans le besoin : ce qui donnerait en moyenne un peu
plus de deux livres par famille. À titre de comparaison, la veille un
montant de 500 livres avait été voté comme aide aux dames Ursulines afin
d’agrandir leur maison d’enseignement.
L’hiver 1837
À l’automne
1836, des gelées prématurées détruisent encore les récoltes.
Le journal La Minerve, dans son
édition du 9 janvier 1837, décrit une situation dramatique : « Une
lettre des Trois-Pistoles en date du 30 décembre, dont on nous a donné
communication, fait un affreux tableau de misère qui règne en cet
endroit. Elle est telle que plusieurs habitants mangent leurs chevaux.
La lettre en nomme deux, entr’autres l’un de Saint-Fabien et l'autre de
Saint-Simon, qui n'ayant chacun qu'un seul cheval maigre, les ont tués
pour s'en nourrir eux et leurs familles. Les récoltes ont manqué depuis
quatre ans et beaucoup d’habitants n'ont pas une patate. Les plus aisés
ont à peine assez pour eux et leurs familles en bien ménageant. Que vont
devenir tous ces pauvres malheureux d'ici au mois de mai ? C'est un
supplice d'y songer. Il est certain que la plupart d’entr’eux mourront
de faim, si l’on ne vient pas promptement à leur secours. » (fin du
texte cité)
Dans son
édition du 4 février 1837, le journal
L’ami du peuple, de l’ordre et
des lois mentionne que « la misère affreuse
accable le pays » et que le district de Montréal est le moins touché par
la famine, même si « les pauvres y fourmillent ». Il continue en
écrivant :
« Mais la détresse de ce
district n’est rien en comparaison de celle qui se fait sentir dans les
districts inférieurs. Là, la misère se présente dans toutes ses phases ;
les habitants privés depuis longtemps de récoltes sont dénués de vivres
et souffrent toutes les cruelles angoisses de la famine la plus dure. On
a vu par des lettres que nous avons publiées déjà que, vers les
Trois-Pistoles, environ 1200 personnes étaient sur le point de mourir de
faim. »
Le journal déplore les
assertions du journal Morning Courier qui « pour toute
consolation aux malheureuses victimes de l’intempérie des saisons, les
accable de reproches sur leur mode d'agriculture, et se répand en
invectives sans nombre sur l’ignorance des habitants des campagnes. »
Encore une fois, les familles
ont besoin d’aide. Le Parlement ne semble pas disposé à renouveler son
secours. Dans son édition du 1er mai 1837, le journal Le
Populaire écrit que « ce sont les citoyens de Québec qui se sont
rendus cautions des subsides accordés pour arrêter la famine des
Trois-Pistoles, de la Malbaie, etc. »
Conclusion
On souhaiterait bien que les pionniers installés à
Saint-Mathieu-de-Rioux dans la décennie 1830 n’aient pas été touchés par
cette famine. Toutefois, vu l’ampleur de la catastrophe, il est
difficile de penser qu’ils en aient été épargnés. Bref,
Saint-Mathieu-de-Rioux est née dans une détresse vécue ou appréhendée.
* * * * * * *
(1) Cette appellation deviendra officiellement Saint-Simon-de-Rimouski
le 21 mars 2020.
(2) La dîme était une contribution d'environ 10 % de la récolte des cultivateurs, versée à la fabrique. Dans le droit canonique de l’église catholique, elle n’est plus en vigueur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5810
21 février
2021
Décès de
Charles D’Auteuil
Dans son édition du 28 février
1931, le journal Le Soleil nous apprend le décès de Charles
D’Auteuil, un paroissien de Saint-Mathieu-de-Rioux.
« À Saint-Mathieu de Rimouski,
le 10 février, est décédé à l'âge de 58 ans Charles D’Auteuil, époux de
feu Émélia Dionne, après une longue maladie très douloureuse soufferte
avec une grande résignation.
Il était le fils de feu Thomas
D’Auteuil et de feu Séraphine Théberge. Il laisse dans le deuil cinq
fils, Philippe, Jean-Marie, Eugène, Vézina et Romain, et trois filles,
Rosanna, Marie-Ange et Hélène, tous de Saint-Mathieu, deux frères, M.
Auguste D’Auteuil de New-Bedford, Mass., et Adélard, de Saint-Mathieu,
deux sœurs, Mmes Augustin Thibault (Rose-Anna) de Baie-des-Sables et Vve
Pierre Samson (Clémentine) de Saint-Grégoire de Montmorency, et une
foule de neveux et nièces.
Son service et sa sépulture
ont eu lieu le 12 dans l'église de la paroisse, au milieu d’un nombre
considérable de parents et d’amis venus de toutes parts de la paroisse,
ainsi que de Saint-Simon et de Saint-Fabien, pour rendre un dernier
hommage au regretté
disparu. » (Fin du texte cité)
Charles
D’Auteuil est né le 10 février 1873 à Saint-Mathieu-de-Rioux. Il a
épousé Émélia Dionne le 11 juillet 1905. Émélia Dionne est la fille de
Ludger Dionne et de Marie Lemay. Elle est née à Saint-Jean-de-Dieu le
20 juillet 1876. Elle est décédée à Saint-Mathieu-de-Rioux le 27
décembre 1924 à l’âge de 48 ans.
L’une des filles du couple,
Hélène, est devenue religieuse de la Charité de Québec le 15 août 1938
sous le nom de sœur Saint-Jean-Claude. Elle est née le 5 octobre 1918
pendant la pandémie de la grippe espagnole
L’une des petites-filles du couple, Fernande, une fille d’Eugène D’Auteuil et d’Aurore Plourde a aussi opté pour la vie religieuse. Elle est née le 5 octobre 1936. Elle est entrée chez les sœurs de la Charité de Québec le 15 août 1957. Son nom en religion est sœur Sainte-Fernande-de-Jésus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5795
12 février
2021 Deux enfants
disparus
Dans son édition
du 14 novembre 1884, le journal Le
Franco-canadien publie un article intitulé
Protection divine. Ce texte relate les circonstances où deux enfants
du rang 5 de Saint-Mathieu-de-Rioux se sont égarés dans la forêt.
« M. le rédacteur,
Auriez-vous la
bonté de me permettre l'usage d'une colonne de votre journal pour faire
connaitre publiquement un fait tout à fait extraordinaire arrivé dans la
paroisse de Saint-Mathieu, comté de Rimouski ? Si je me permets de le
livrer au public, c’est pour le prier de remercier Dieu, avec tous les
habitants de ladite paroisse, de leur avoir accordé une telle grâce.
Samedi, 25
octobre, la tranquille paroisse de Saint-Mathieu était menacée d’un
grand malheur. Deux enfants de M. Jean-Baptiste Dionne (fils de Pierre),
dont l’un était âgé de 12 ans et l’autre de 8 ans, s'étaient éloignés de
la maison pour aller casser quelques branches de cèdre. À peine ces
enfants avaient-ils fait quelques arpents dans le bois qu'ils se
trouvèrent complétement égarés, et continuèrent ainsi à marcher sans
savoir où aller.
À cinq heures, les
parents, ne voyant pas leurs enfants revenir au foyer, se mirent
immédiatement à leur recherche. À eux vinrent se joindre d'autres
personnes qui cherchèrent en vain jusqu'à dix heures du soir. Dimanche à
trois heures du matin, le curé fut averti de l'accident par le père
désolé qui mit en lui toute sa confiance. En bon père, consolé par les
avis de son pasteur, qui lui avait assuré qu'il les trouverait, il
retourne chez lui après avoir éveillé tous les habitants de son
arrondissement et les avoir priés de vouloir bien continuer avec lui les
recherches de la veille.
À six heures, au
moins 30 hommes armés d'un grand courage cherchèrent jusqu’à midi, mais
en vain. Immédiatement après la grand-messe, le curé est prié de vouloir
bien se rendre sur les lieux afin d'animer, par sa présence, le courage
de ces infortunés, c'est ce qu'il fit, non pas avec joie, mais avec les
sentiments de véritable père.
À 1 heure précise,
après avoir récité avec une grande ferveur le chapelet de la Ste Vierge
et celui du Sacré-Cœur, et aussi après plusieurs invocations au grand
Saint-Antoine de Padoue, cinquante personnes accompagnées de leur curé,
se rendirent sur le lieu du malheur et cherchèrent toujours en vain
jusqu'à 6 heures. Le père et la mère se laissèrent alors aller au
désespoir et n'espéraient plus les trouver au moins vivants ; le curé de
nouveau essaya de les consoler, en leur disant qu’ils trouveraient leurs
enfants.
Le lundi, la messe
se disait en l'honneur du Sacré-Cœur afin d'obtenir succès dans cette
entreprise, et toutes les personnes présentes s’unissaient d'intentions
au célébrant. À 9 heures, quatre bons marcheurs, parmi lesquels se
trouvaient d'habiles chasseurs se mirent de nouveau à la recherche des
petits malheureux. À onze heures, ils commencèrent à trouver des traces
de leur passage. Pleins d'espoir de les trouver, ils continuèrent à
suivre ces traces autant que possible et parvinrent enfin auprès de ces
chers enfants qui erraient encore pleins de vie.
Voyons maintenant
en quelques mots la conduite de ces deux affligés pendant le court
pèlerinage involontaire. Dès samedi soir, ces enfants avaient entendu la
voix des personnes qui les cherchaient, mais ils croyaient que c'était
le cri des chars (trains de Saint-Simon), et au lieu de revenir vers ces
voix, ils s'en éloignaient. À la nuit, ils se campèrent au pied d'un
sapin pour passer la nuit, étant obligés de coucher sur la terre gelée
et même couverte de neige. Ils voulurent étendre sous eux des branches,
leurs petites mains engourdies par le froid refusèrent de leur rendre ce
service ; ils passèrent donc la nuit dans cet état. Le plus âgé était
agité, et au milieu de ce demi-sommeil, il suppliait de sa voix
enfantine son père ou sa mère de venir les chercher.
Ils passèrent
toute la journée du dimanche à marcher. Le soir ils se mirent dans le
même état que la veille pour y passer la nuit, et le lendemain ils
continuèrent à marcher jusqu’à une heure. Au moment de leur heureuse
délivrance, le plus âgé avait fait placer son jeune frère dans un pin
creux, parce qu'il ne pouvait plus marcher, tandis que lui-même
s'efforcerait de trouver ses bons parents, qui ensuite viendraient le
chercher.
Le plus âgé a été
trouvé très bien disposé et a parcouru avec une grande facilité la
longue distance qui les séparait du foyer ; mais le plus jeune avait un
pied tellement endommagé par le froid qu'il ne pouvait pas s'en servir
dans le moment. Ils ont donc été deux jours et deux nuits exposés à la
rigueur de la dure saison et déclarent à qui veut les entendre qu'ils
n'ont souffert ni de la faim, ni du froid, ni de la fatigue.
Tous ensemble
rendons grâce à Dieu, et à vous M. le Rédacteur merci pour votre
bienveillante hospitalité. »
(Signé) Un
paroissien,
St-Mathieu, 29 octobre 1884
Jean-Baptiste
Dionne est né le 21 avril 1845 à l’Isle-Verte. Il est le fils de Pierre
Dionne et d’Angèle Boucher. Il épouse Marguerite Gaudreau le 7 mai 1867
à Saint-Mathieu-de-Rioux. Marguerite est la fille de Pascal Gaudreau
père et de Séraphine Caron. Le couple a eu 12 enfants. Au moment des
faits, Jean-Baptiste est cultivateur au rang 5.
D’après leur âge,
les deux enfants touchés par ce drame sont Ferdinand, né le 27 mai 1872,
et Philéas, né le 21 janvier 1876. Entre les deux enfants, se trouve
Delphine qui a épousé Philéas Gaudreau, lequel a possédé une terre au
début du rang 5, là où commence la route du sixième rang. Philéas
Gaudreau est le fils de Pascal Gaudreau fils et d’Aglaé Boucher.
Le curé est le révérend Hermel Tremblay qui est à ce poste depuis un an. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5750
15 janvier 2021
Dérives du régime
seigneurial à Saint-Mathieu-de-Rioux
En 1627, la Nouvelle-France adopte le
régime seigneurial qui vise à faciliter la possession du sol et son
exploitation par le biais de distribution de terres. La subsistance des
familles et l’occupation du territoire sont les deux fondements de cette
politique.
Certaines personnes parmi les plus
influentes du pays reçoivent de larges territoires qui correspondent à
cinq ou six paroisses actuelles et souvent même plus. Ces territoires
sont appelées seigneuries. Avec le temps, des gens fortunés achètent des
fractions de territoire.
En 1790, une partie de la seigneurie Nicolas-Rioux est achetée par
Joseph Drapeau, un riche marchand de Québec. Outre
Saint-Mathieu-de-Rioux, cette seigneurie comprend alors les paroisses
actuelles de Saint-Simon-de-Rimouski, de Saint-Fabien et de
Saint-Eugène-de-Ladrière. En 1829, les six filles de Joseph Drapeau
héritent de la seigneurie. Luce-Gertrude Drapeau en est
l’administratrice.
Le seigneur doit concéder gratuitement
à un chef de famille un lot qu’il a l’obligation de défricher, d’y
construire une habitation et d’y résider. En retour, l’acquéreur qu’on
appelle censitaire doit verser au seigneur une redevance annuelle
appelée cens.
Ce régime seigneurial est parfois
victime de gens déjà riches ou de gens ambitieux qui cherchent fortune.
Ceux-ci acquièrent des lots dans le but de les revendre à profit ou
d’exploiter la forêt en engageant des bûcheurs à gages. Ils ne se
soucient guère de leur obligation envers la colonisation.
Nous vous
présentons 12 cas où visiblement, à
Saint-Mathieu-de-Rioux, la spéculation
et l’exploitation forestière priment sur le développement agricole.
(1)
Cas 1. William Venner
William Venner, écuyer,
naît à Québec en 1813. Il est le premier marchand à s’établir à
Saint-Anselme-de-Lauzon. Après 20 ans, il fait office de courtier et de
banquier à Québec.
Il est l’un des hommes les plus riches
du quartier Saint-Roch de cette ville. Il
décède en 1890.
En 1858, il possède un lot au village de Saint-Mathieu-de-Rioux. Sa terre mesure 4 arpents de front et 20 arpents de profondeur. Elle est située entre celle de Joseph Paradis et celle de Philomène Lauzier.
En mars 1872,
Antoine Chouinard, ancien curé de Saint-Mathieu (1866-1871), achète
une terre de quatre arpents de front (2) au quatrième rang de
Saint-Mathieu. Le vendeur est René-Édouard Caron, 71 ans, à ce moment
juge à la Cour du banc de la reine (photo ci-contre). Antérieurement, Caron a été maire de
Québec pendant huit ans, député au Bas-Canada, bâtonnier, juge à la Cour
supérieure. Il sera plus tard le deuxième lieutenant-gouverneur du
Québec.
René-Édouard Caron avait obtenu cette terre de Nicolas Leblond en
1838. Leblond l’avait acheté de Joseph Caron qui lui-même l’avait obtenu
des seigneuresses Drapeau en 1834.
L’acte d’achat par le révérend Chouinard ne mentionne pas de
bâtisse. On présume que la terre n’est pas encore défrichée. Nonobstant
ce fait, Chouinard a déboursé 100 $ pour cet achat, un montant payable
en cinq ans avec un taux d’intérêt de 7 %. Pour en assurer le paiement,
il a hypothéqué son lot.
En 1878, le juge Caron possède au moins
une autre terre sans bâtisse à Saint-Mathieu. On apprend cela quand la
seigneuresse Luce-Gertrude Drapeau fait vendre aux enchères publiques
une terre qui appartient à Édouard Létourneau. Voici la description du
lot :
« Une terre située en la paroisse de
Saint-Mathieu, contenant huit arpents de front sur trente arpents de
profondeur, plus ou moins, en le quatrième rang de la seigneurie Nicolas
Rioux ; joignant d'un côté au nord-est à la veuve Thadée Bélanger ou
représentants, d'autre côté au sud-ouest aux représentants du juge Caron
— sans bâtisses. »
Cas 3. Le révérend Louis-Théophile Fortier
Louis-Théophile Fortier naît à Québec en 1803.
Il est ordonné prêtre en 1826. Il succède au révérend Édouard Faucher à
la cure de Trois-Pistoles, soit de 1831 à 1835. Il décède à Nicolet en
1874.
En 1858, il possède une terre de six arpents au rang 4. Elle est
située entre celle de Vital Rousseau et celle de William Price.
Cas 4. Félix Têtu
Félix Têtu, écuyer, est un riche
marchand et maître de poste de Trois-Pistoles. Il est commissaire pour
les petites causes dans la seigneurie de Trois-Pistoles. Il décède à
Trois-Pistoles le 16 juin 1876 à l’âge de 74 ans.
En 1858, il possède une terre de huit
arpents au rang 3 de Saint-Mathieu-de-Rioux. Elle est située entre celle
de Magloire Bérubé et celle de Simon Talbot.
Ulric-Joseph Tessier est né le 3 mai
1817 à Québec. Il est le
fils de Michel Tessier, marchand, et de Marie-Anne Perrault. Il
est admis au barreau du Québec le 22 juin 1839. En 1847, il
épouse à Rimouski Marguerite-Adèle Kelly, fille
d'Augustin Kelly et
d’Adélaïde Drapeau, l’une des seigneuresses. Il est l’avocat des
seigneuresses Drapeau. Il est tour à tour maire de Québec, député,
conseiller législatif, sénateur, seigneur et juge. Il décède en 1892 à
Québec.
En 1858, il possède une terre de neuf
arpents au rang 5. Elle est située entre celle de François Lefebvre et
l’une de William Price.
Cas 6. Le révérend
Édouard Faucher
Édouard Faucher naît à
Saint-Michel-de-Bellechasse en 1802. Il est ordonné prêtre en 1824. Il
est nommé curé de Trois-Pistoles en 1829, l’année même où les Dames
Drapeau héritent de la seigneurie Nicolas-Rioux. Le 22 octobre 1829, il
achète de Pierre Michaud une terre de 10 arpents de front au troisième
rang de Saint-Simon. Quelques mois plus tard, il obtient une cure à
Lotbinière et vend son bien à deux de ses sœurs.
Détail surprenant. Le 10 février 1835,
Luce-Gertrude Drapeau, administratrice de la seigneurie, épouse le
notaire Thomas Casault. Ce dernier est le frère de Marie-Geneviève
Casault qui est la mère du révérend Faucher. Ce dernier devient le neveu
de la seigneuresse Drapeau.
Cas 7. Les Ouellet
Fait intriguant. Dans la liste des
propriétaires des terres en 1858, on retrouve sept dénommés Ouellet qui
ont chacun un arpent de terre au rang 3 et qui sont voisins. Ce sont :
Joseph, Pierre, Angélique, Éliza, Justine, Sophie et Génoffe dans cet
ordre. Il est fort probable que ce sont des membres d’une
même famille,
mais je n’ai rien trouvé qui permet de l’affirmer.
Une surprise. On retrouve les
mêmes noms dans le même ordre au rang 4 avec encore chacun un arpent
sauf que Sophie est remplacée par Marie. (Serait-ce la même ?) Aucune de
ces personnes n’est décédée à Saint-Mathieu.
Au total, les Ouellet possèdent 14
arpents de terre.
Cas 8. Nazaire Têtu
Nazaire Têtu, écuyer, est né en
1814 à Montmagny.
Il est le cousin de Félix Têtu.
Il devient
coseigneur d’une cinquième partie de la seigneurie de Trois-Pistoles,
n’ayant toutefois que deux censitaires. Il s’associe à William Price
pour le commerce du bois, tout en ayant sa propre scierie à
Trois-Pistoles. Il décède à cet endroit
en 1891.
Cas 9. Firmin Dion
Firmin Dion est originaire de
Saint-Roch des Aulnaies. Pendant un certain temps, il est propriétaire
du premier moulin à farine de Saint-Mathieu-de-Rioux. À un moment donné,
il éprouve des difficultés financières. En 1877, Jane Price, la fille de
William, fait vendre aux enchères publiques non seulement la terre de
quatre arpents où est situé le moulin à farine, mais encore six autres
de ses terres.
Au rang 4, y compris la précédente,
Dion possède trois terres contigües bornées à l’est à Charles Lagacé et
à l’ouest à Bélonie Pigeon. Au rang 5, Dion possède quatre terres
contigües bornées à l’est à Placide Lafontaine et à l’ouest aux
seigneuresses Drapeau. Ces sept terres sont sans bâtisse sauf celle
voisine de Pigeon où une grange a été érigée. Les sept terres chacune de
quatre arpents totalisent 28 arpents.
Cas 10. Les frères Turcot (ou Turcotte)
Six membres de la famille Augustin
Turcot et Angélique Lavoie ont chacun une terre à Saint-Mathieu-de-Rioux
en 1858. Ceux-ci sont nés à Trois-Pistoles. Le père est décédé en 1855 à
Saint-Fabien.
Au rang 3, on retrouve les
propriétaires suivants : Majorique, quatre arpents, Fabien, six arpents,
Octave, quatre arpents, Séverin, quatre arpents et Sifroid, sept
arpents. Les terres des quatre premiers frères sont voisines dans
l’ordre donné. De plus, leur frère Jean-Baptiste possède une terre de 12
arpents de front et de six arpents de profondeur au rang 4. Les Turcot
ont 37 arpents de front au total.
Il est probable qu’aucun de ces frères
n’a demeuré à Saint-Mathieu. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun n’y est
décédé. D’ailleurs, trois d’entre eux ont aussi des terres au deuxième
rang de Saint-Simon.
Cas 11. Louis Bertrand
Louis Bertrand est né en 1786 à
Cap-Santé. Il s’installe à l’Isle-Verte en 1811. En tant que marchand de
bois, il mène des contrats de coupe de bois pour des négociants
extérieurs à la région. Il est seigneur de l’Isle-Verte. Parmi ses
autres titres, on peut citer : député, maire, lieutenant-colonel de
milice. Il est décédé à l’Isle-Verte en 1871.
En 1858, il possède au rang 3 de
Saint-Mathieu-de-Rioux deux terres chacune de deux arpents, une de cinq
arpents et une autre de 34 arpents. Il possède aussi une terre de quatre
arpents au rang 4. Ses possessions totalisent 47 arpents.
Cas 12. William Price
William Price, marchand de bois, naît
en 1789 au Royaume-Uni. Il est propriétaire de nombreux moulins à scie
dans les régions de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du
Bas-Saint-Laurent. À Saint-Mathieu-de-Rioux, il a en sa possession
pendant un certain temps un moulin à scie et un moulin à farine. Il
décède en 1867.
En 1858, Price
possède une terre de six arpents au rang 3,
une autre de 24 arpents au rang 4 et une troisième de 36 arpents au rang
5. Au total, il possède 66 arpents de terre : ce qui correspond à
3,86 kilomètres de front.
Autres cas non documentés
Dans le cadastre de Siméon Lelièvre de 1858, on constate qu’il y a deux
représentants, l’un est Olivier Simon qui a aussi une terre de six
arpents au deuxième rang de Saint-Simon, l’autre est Paul Sylvain. On ne
sait pas si, de fait, ces deux hommes habitent sur les terres dont les
propriétaires sont inconnus.
Il y a d’autres cas qu’il a été impossible de confirmer. Par exemple, en
1858, Éloi Rioux possède une terre de deux arpents au rang 3. Est-ce le
nommé Éloi Rioux qui est un coseigneur de la seigneurie des
Trois-Pistoles ?
On peut aussi penser que certains cultivateurs qui sont parmi les plus
fortunés achètent un ou d’autres lots pour les revendre ou en faire
l’exploitation forestière. Ces cas n’ont pas été retenus dans le calcul
global.
Conclusion
À Saint-Mathieu-de-Rioux, en 1858, 760 arpents de terre sont concédés ou
revendus. On trouve 355 arpents au rang 3, 243 arpents au rang 4 et 162
arpents au rang 5. Aucune terre du rang 6 n’est alors concédée.
L’ensemble des cas cités montre qu’environ 33 % du territoire qui est
concédé ou revendu est présumément voué à la spéculation ou à
l’exploitation forestière. Si on considère l’ensemble du territoire de
Saint-Mathieu, y compris le rang 6, c’est environ 35 % du sol seulement
qui est en train d’être
colonisé.
Les dames Drapeau sont-elles responsables de cette situation ? Il semble
exister une certaine complicité entre les élites et les seigneuresses.
Certains membres du clergé, certains notables ou certains exploitants
forestiers obtiennent des terres sans vouloir s’y installer et les
défricher en vue de semer et de récolter. Bref, les seigneuresses
Drapeau concèdent des terres sans présumément obliger les tenanciers à
faire de l’exploitation agricole.
Ces dérives du régime seigneurial ne sont pas totalement négatives. En
effet, le fait d’exploiter les ressources forestières aide à consolider
l’économie locale en donnant du travail d’appoint à certains
cultivateurs ou à leurs fils et en permettant aux moulins à scie de
produire autant pour les besoins locaux que pour l’exportation. Bien
souvent, à cette époque,
les moulins à scie
constituent la base de l’économie d’une paroisse.
Ces retombées positives ne doivent pas nous faire oublier qu’à
Saint-Mathieu-de-Rioux la distribution et l’occupation des terres ne se sont pas toujours
faites dans un climat sain et que des élites ont abusé de leur notoriété
pour détourner à leur profit les ressources forestières sans se soucier
des colons qui trimaient dur pour faire vivre décemment leur famille.
* * * * * * * Notes
(1) La plupart des renseignements concernant
les noms des propriétaires de terre sont tirés du Cadastre abrégé de
la seigneurie de Nicolas Rioux établi, en 1858, par Siméon Lelièvre,
écuyer et commissaire.
Voici le lien qui a été vérifié le 14 janvier
2021 :
(2) Lorsque la profondeur d’une terre n’est pas mentionnée, c’est qu’elle est de 30 arpents. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5730
3
janvier
2021
La saga du premier moulin à farine de Saint-Mathieu-de-Rioux
Jusqu’en 1854, le régime seigneurial oblige les seigneurs à bâtir un
moulin à farine sur leurs terres. En revanche, les censitaires doivent y
faire moudre leurs grains et céder un droit de mouture, appelé droit de
banalité.
En 1830, quand Michel Jean s’établit au troisième rang de
Saint-Simon-de-Rimouski, aujourd’hui Saint-Mathieu-de-Rioux, les six
filles de Joseph Drapeau sont propriétaires de façon indivise de la
seigneurie Nicolas-Rioux que leur père a achetée en 1790. À ce moment,
aucun moulin à farine n’existe dans la paroisse de Saint-Simon (1).
Construction d’un moulin à farine
En 1836, Joseph Migné Lagacé (2), un cultivateur de 56 ans de Kamouraska
et père de 19 enfants, achète une terre de deux arpents au Faubourg du
moulin à Saint-Mathieu. On peut raisonnablement penser qu’il a opté pour
ce lot à cause de la rivière Neigette qui y coule du sud au nord et
qu’il a des plans précis pour la faire fructifier.
Le vendeur de la terre est Antoine Ouellet (3) qui s’est marié à
Kamouraska en 1828. Il est âgé de 32 ans et est cultivateur à
Saint-Mathieu. Le lien qui unit les deux hommes se consolidera quand
Narcisse Ouellet, le fils d’Antoine, épousera en 1851 Hortense Lagacé,
la fille de Joseph.
Le 21 janvier 1842, un avis public est lu sur le perron de l’église de
Saint-Simon. Par cet avis, Joseph Lagacé somme les seigneuresses
Drapeau, dont Luce-Gertrude est l’administratrice, d’ériger un moulin à
farine sur le territoire de cette paroisse, sinon il le fera. À cette
époque, le deuxième rang de Saint-Simon est peu peuplé à cause
d’obstacles naturels et le troisième rang, aujourd’hui de Saint-Mathieu,
est habité partiellement seulement depuis 12 ans. Par ailleurs, les
côtes abruptes constituent un frein pour les déplacements entre les deux
paroisses. Le pari, pour Lagacé, de s’engager dans un tel bras de fer
est risqué.
Devant le refus des dames Drapeau de souscrire à son ultimatum, Joseph
Lagacé entreprend par ses propres moyens la construction d’un moulin à
farine sur son lot en 1843. Il se procure les machines-outils
nécessaires dont deux moulanges. Il hypothèque son lot de Kamouraska et
celui de Saint-Mathieu. Il engage Jean Bouchard comme meunier et le
moulin commence à opérer le 24 juin 1845.
La bâtisse (4) est située à une cinquantaine de mètres au sud du pont
qui enjambe la rivière Neigette, aujourd’hui appelé pont à Désiré. Elle
a deux étages. Le rez-de-chaussée fait office de meunerie. Un escalier
extérieur joint le deuxième étage qui sert de résidence au meunier. Du
côté ouest tout près, un barrage est érigé sur la rivière Neigette.
Les
seigneuresses
Drapeau n’apprécient pas qu’un de leurs censitaires les défie. Pour
empêcher Lagacé de bâtir, puis de faire fonctionner son moulin, elles
font émettre des protêts notariés. Lagacé ne bouge pas.
Les
dames
Drapeau continuent à revendiquer leurs droits en justice.
Elles confient leur défense à un jeune avocat de Québec du nom
d’Ulric-Joseph Tessier (5). Ce dernier fait partie de leur famille
puisqu’il épouse en 1847 une fille d’Adélaïde Drapeau, l’une des
seigneuresses.
Le 14 mars 1850, Joseph Lagacé cède son lot et le tiers des parts du
moulin à farine à son fils Édouard (6) qui a 26 ans et qui est marié
depuis moins d’un mois. L’année suivante, sans qu’on en connaisse la
raison, Édouard rétrocède à son père cette même terre en même temps que
les parts du moulin.
Joseph Lagacé se tourne vers William Price, de la compagnie Price
Brothers, qui
a un droit de coupe de bois dans la seigneurie.
Price prend possession de la terre et du moulin et cède à Lagacé en
échange un lot de quatre arpents au rang 4, de même qu’un terrain
adjacent. Lagacé devait être bien mal pris financièrement pour accepter
cet échange.
Droit de banalité en jeu
Les dames Drapeau réclament de la compagnie Price une indemnité pour
compenser leur droit de banalité. Le commissaire de la tenure
seigneuriale décide que celles-ci ne sont pas éligibles à une telle
indemnité. En 1858, elles vont en appel. Leur avocat affirme de façon
erronée « que
le moulin bâti par le nommé Migné Lagacé n'a été érigé non pas comme un
moulin à farine véritable, mais que ce n’était qu’une petite bâtisse
construite par un pauvre homme sur un terrain qui ne lui appartenait
pas, mais appartenait à William Price, écuyer. (7) »
Il continue en soutenant qu’un bail avait été négocié entre William
Price et les requérantes. Ce bail reconnaissait que les dames Drapeau
conservaient leur droit de banalité. L’appel est rejeté.
De nouveaux propriétaires
Plus tard, Firmin Dion achète le moulin à farine des Price. Toutefois,
en 1877, Jane Price, la fille de William, fait vendre aux enchères
publiques la terre maintenant de quatre arpents où est situé le moulin à
farine et six autres terres appartenant à Dion. Il semble clair que Dion
ne peut pas remplir ses obligations financières envers la compagnie
Price. Voici l’acte de mise en vente de la terre où est situé le
moulin :
« Demoiselle Jane Price, demanderesse, contre Firmin Dion, défendeur,
savoir :
Une terre située en le quatrième rang de la seigneurie Nicolas-Rioux,
paroisse de Saint-Mathieu, de la contenance de quatre arpents de front
et trente arpents de profondeur, borné au nord aux terres du troisième
rang, au sud aux terres du cinquième rang, à l’est à Charles Lagacé ou
ses représentants, à l’ouest au défendeur, avec un moulin à farine, un
moulin à scie et maison et autres bâtisses sus-construites,
circonstances et dépendances.
Pour être vendue à la porte de l’église de la paroisse de Saint-Mathieu le 10 avril 1877. » (Gazette officielle du Québec, 24 mars 1877)
Un nouvel acheteur se pointe en la personne de Jean-Baptiste Lavoie (8)
qui est originaire de Kamouraska, tout comme Joseph Lagacé. En voilà un
autre qui ne tiendra pas le coup très longtemps.
En 1880, Joseph Dionne, un cultivateur et maître de poste de Sainte-Anne
de la Pocatière entre en scène. Il a le titre d’écuyer, signe qu’il a
une certaine fortune et une certaine notoriété. Il fait vendre aux
enchères publiques la terre où se trouve notamment le moulin à farine.
Voici l’acte de mise en vente :
« Joseph Dionne, de la paroisse de Sainte-Anne la Pocatière, district de
Kamouraska, demandeur, contre Jean-Baptiste Lavoie, de la paroisse de
Saint-Mathieu, dans le district de Rimouski, cultivateur, défendeur,
savoir :
Une terre située en le quatrième rang des concessions de la seigneurie
de Nicolas-Rioux, paroisse Saint-Mathieu, contenant quatre arpents de
front sur trente arpents de profondeur ; bornée au nord au troisième
rang, au sud au cinquième rang, au sud-ouest à Jules Fournier, et au
nord-est à Joseph Ouellet, avec les moulins à scie et à farine et autres
bâtisses sus-construites, appartenances et dépendances.
Pour être vendue à la porte de l'église de ladite paroisse de
Saint-Mathieu, le 21 décembre 1880. »
(Gazette officielle du Québec,
16 octobre 1880)
On ne sait pas de quelle façon Joseph Dionne a acquis des droits sur
cette terre. Toutefois, fait intriguant, cet homme est le père de
Léonidas Dionne qui pratique le droit à Rimouski depuis 1875 avec comme
associé, Auguste Tessier (9), le fils d’Ulric-Joseph Tessier. Ce dernier
est toujours l’avocat des seigneuresses Drapeau. Voilà un élément qui
pourrait faire penser à un complot, mais sans preuve on ne peut rien
affirmer.
On croit que Jean-Baptiste Lavoie continue d’être meunier, car on
retrouve son nom et ce titre dans la liste des partants vers les
États-Unis en 1889.
Selon Fernand Dionne, un petit-fils d’Ernest Dionne, ce dernier et son
frère Ferdinand (10)
se portent acquéreurs du moulin Lagacé en 1890. Ils sont les premiers
propriétaires originaires de Saint-Mathieu.
Dernier propriétaire
Le moulin à farine passe dans les mains d’Alfred Bernier (11), un
habitant de Saint-Simon-de-Rimouski. En 1937, le moulin est encore en
opération. Selon
un rapport intitulé Inventaire
des ressources naturelles et industrielles 1938 : comté municipal de
Rimouski, cette année-là,
Bernier « a
moulu près de 215 000 livres de blé représentant 150 000 livres de
farine, ainsi que 600 000 livres de moulées alimentaires. M. Bernier
moud à commission pour les cultivateurs et garde comme rémunération de
son travail 12 % des grains qu'il reçoit. Il est parfois payé en
argent. »
En 1937,
la paroisse de Saint-Mathieu importe 140 000 livres de farine,
représentant 70 % de la consommation locale.
En plus, elle importe 20 000 livres de moulées alimentaires.
Avec le temps, les importations de farine et de moulées s’accentuent.
En 1940, un moulin à
farine coopératif voit le jour à Saint-Mathieu-de-Rioux. Même si ce
moulin est davantage axé sur la moulée, il n’aide pas à la rentabilité
du moulin de Bernier.
Le 30 mai 1942, la Gazette officielle du Québec publie un acte de
vente aux enchères publiques du moulin :
« Cour Supérieure, District de Rimouski
Ludger Bernier, Noranda, vs Alfred Bernier, savoir :
1. Parties des lots 225, 226, et 227 au cadastre officiel de la paroisse
de St-Mathieu bornées au nord au chemin, au sud à deux arpents au sud de
l'écluse du moulin, à l'est et à l'ouest sur le haut de l'écart de la
Rivière Neigette, avec la maison, moulin à farine, et accessoires, et
autres bâtisses, circonstances et dépendances.
2. Partie du lot N° 227 au cadastre officiel de la paroisse de
St-Mathieu, d'environ 50 pieds carrés, bornée au nord et à l'est à
Édouard Bélanger, au sud à Désiré Dionne, à l'ouest à la Rivière
Neigette.
Pour être vendues à la porte de l'église de la paroisse de St-Mathieu,
le 9 juin prochain (1942). »
On peut raisonnablement penser qu’à ce moment le moulin à farine avait
cessé d’opérer.
Conclusion
Le premier moulin à farine de Saint-Mathieu-de-Rioux a eu une histoire
mouvementée. Elle commence par une mise en demeure d’un habitant de
Kamouraska envers les seigneuresses Drapeau les intimant de construire
un moulin banal. Cet habitant, Joseph Lagacé, passe aux actes en
construisant un moulin privé. Des poursuites juridiques s’enclenchent et
durent des années. Finalement, Joseph Lagacé en sort vainqueur.
Dans un premier temps, Joseph Lagacé cède une partie des parts du moulin
à son fils Édouard. S’agit-il d’un cadeau empoisonné ? Toujours est-il
qu’au bout d’un an, Édouard remet ce cadeau à son père.
Joseph Lagacé échange son moulin contre des propriétés de William Price.
Ce dernier cède ses parts à sa fille Janette. Par la suite, au moins
deux propriétaires (12) se succèdent et sont forcés de vendre. Ce sont
Firmin Dion et Jean-Baptiste Lavoie. Puis, les frères Ernest et
Ferdinand Dionne achètent le moulin. Ils le revendent à Alfred Bernier
qui abandonne vers 1940. Le moulin privé aura opéré pendant plus de 90
ans.
* * * * * * *
Références (1) Certains renseignements concernant les débuts du moulin à farine de Saint-Mathieu ont été puisés dans l’article La guerre des moulins de Saint-Simon (1836-1870) dont les auteurs sont Jean-Pierre Proulx et Lucie Plante. Cet article a été publié en juin 2019 dans la revue l’Estuaire et met l’accent sur les « relations conflictuelles entre un censitaire et une seigneuresse dans le cadre du régime seigneurial ». Voici le lien permettant de lire l’article : la_guerre_des_moulins_de_saint-simon_1836-1870.pdf (st-simon.qc.ca) (Lien vérifié le 2 janvier 2021) (2) Joseph Lagacé est né le 10 février 1780 à Rivière-Ouelle. Il épouse Modeste Pelletier à Kamouraska le 24 juillet 1809, puis Léocadie Dionne le 12 février 1816. Tous ses enfants sont nés à Kamouraska. Il semble bien qu’il quitte Kamouraska pour Saint-Mathieu vers 1850. Il décède le 6 octobre 1864 à Saint-Mathieu à l’âge de 84 ans. (3) Antoine Ouellet est le fils d’Antoine Ouellet et de Marie-Geneviève Ouellet. Il décède à Saint-Mathieu le 30 décembre 1894 à l’âge de 90 ans. Son fils Narcisse est né le 31 août 1831. Il décède à Saint-Mathieu le 7 avril 1917.
(4) La description est faite d’après mes souvenirs vers 1948. La bâtisse
abandonnée et le barrage étaient encore en place.
(5) Ulric-Joseph Tessier est né le 3 mai 1817 à Québec. Il est le fils de Michel Tessier, marchand, et de Marie-Anne Perrault. Il est admis au barreau de Québec le 22 juin 1839. Il est tour à tour maire de Québec, député, conseiller législatif, sénateur, seigneur et juge. Il décède en 1892 à Québec.
(6) Édouard Lagacé est né le 6 mai 1824 à Kamouraska. Il épouse Desanges Bérubé le 5 février 1850 à Trois-Pistoles. Il décède à Saint-Mathieu le 1er juin 1880.
(7) Extrait d’un document produit par Ulric-Joseph Tessier lors de la requête des dames Drapeaux en appel à la Cour de Révision des commissaires de la tenure seigneuriale.
(9) Auguste Tessier naît le 20 novembre 1853 à Québec. Il est
admis au Barreau du Québec le 18 juillet 1876.
Il épouse Corinne Gauvreau à Rimouski le 21
août 1878.
(10) Fernand Dionne est le petit-fils d’Ernest Dionne. Ce dernier est né à Saint-Mathieu le 12 novembre 1870. Il épouse Odila Vaillancourt le 3 février 1891. Il décède le 11 novembre 1947 à l’âge de 77 ans. Il est le fils de Jean-Baptiste Dionne et d’Aglaé Rioux. Ferdinand Dionne est né à Saint-Mathieu le 27 octobre 1868. Il épouse Délima Vaillancourt le 5 mars 1889. Il décède le 18 février 1941 à Amqui.
(12) Il est fort possible que d’autres propriétaires aient existé entre William Price et les frères Dionne. Pour les trouver, il aurait fallu consulter le registre foncier du Québec. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5720
27 décembre 2020
Funérailles de Séraphine Théberge
Dans son édition du 5 avril 1924, le journal
Le Soleil nous apprend le décès de Séraphine Théberge.
« Le 26 mars dernier, est décédée en notre paroisse à l’âge de 81
ans et 8 mois dame Séraphine Théberge, épouse de sieur Thomas D’Auteuil
après une courte maladie de trois semaines soufferte avec résignation.
Son service et sa sépulture ont eu lieu le 28 mars dernier au
milieu d’un groupe de parents et d’amis. Le service a été chanté par M.
l’abbé Giguère, curé de la paroisse.
Les porteurs de la dépouille mortelle étaient ses fils, M. Auguste
D’Auteuil, de New-Bedford, Charles D’Auteuil, Adélard D’Auteuil, Noël
Girouard, son gendre. Portait la croix M. Hermel Samson de St-Grégoire
de Montmorency, son petit-fils.
Conduisaient le cortège ses enfants, Mme Noël Girouard, Mme Pierre
Samson du Lac-Édouard, Mme Augustin Thibault, de Sandy-Bay (aujourd’hui
Baie-des-Sables), M. Octave Thibault, son beau-frère de Sandy-Bay, Mme
Charles D’Auteuil, Mme Alfred Théberge.
Ses petits-fils : Évangéliste, Ambroise, Octave Girouard, Philippe,
Jean-Marie D’Auteuil, Pierre, Maurice, Lucie D’Auteuil, Rosée D’Auteuil,
Mme Joseph Fournier, Mlle Béatrice Samson de St-Grégoire de Montmorency,
Ses neveux : Eusèbe, Noël Théberge, M. et Mme Philippe Théberge de
St-Fabien, Alphonse Théberge de Trois-Pistoles, M. et Mme Ferdinand
D’Auteuil, P. D’Auteuil, Mme Édouard Ouellet de Ste-Françoise M. et Mme
Émile Théberge de St-Mathieu et beaucoup d’autres dont les noms nous
échappent.
La défunte laisse pour pleurer sa perte son époux, ainsi que M. Alfred Théberge, son frère. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5695
12 décembre 2020
Nouvelles du 13 novembre 1914
Dans son
édition du 13 novembre 1914, Le
Progrès du Golfe publie des nouvelles concernant
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Mariages
Le 11 août, M. Arthur Lagacé, fils
de Majorique, conduisait à l’autel Mlle Emma Bérubé, fille de Johnny
Bérubé.
Le 5 octobre M. Ernest Berger,
fils d’Émile Berger, de St-Fabien, avec Mlle Emma Vaillancourt, fille
d’Alfred Vaillancourt.
40-Heures
Les 40-heures ont eu lieu dans notre paroisse le 26 octobre. Les
Révérends MM. Amyot, Jean et Pelletier sont venus prêter leur concours â
M. le curé. On peut dire que presque tous les paroissiens se sont
approchés de la Ste-Table en ces beaux jours.
Il en a été de même pour la
Toussaint et le jour des Morts. La fréquente communion est très en
honneur par ici.
Mois du Rosaire
Quelques jeunes filles et les
enfants de l’école du village ont fait les frais du chant aux exercices
du mois du Rosaire. Il était beau d’entendre ces voix jeunes et pures
répondre aux litanies chantées par Mlle Octavie Plourde dont la voix est
si sympathique
Maladie
Mlle Émilie Théberge, institutrice à l’école modèle du village, se
voit forcée d’abandonner la classe pour prendre quelques mois de repos.
C’est une grande perte pour les enfants
car
cette demoiselle était très dévouée pour sa classe et a remporté de
grands succès dans l'enseignement. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. Elle est remplacée par Mlle E. Bernier, de St-Simon.
Mme Ferdinand Parent, malade depuis quelque
temps prend du mieux.
M. Cyprien Desjardins est malade d'une
inflammation de poumons.
M. Johnny Jean, à la suite d’un accident à un bras est si malade qu’il a été obligé d’aller demeurer quelque temps près du médecin aux Trois-Pistoles, afin de recevoir les soins appropriés à son état. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5670
27 novembre 2020
Fêtes chez Désiré Théberge
Le Progrès du Golfe
publie deux comptes rendus concernant la famille Désiré Théberge. Le
premier souligne le 30e anniversaire de naissance de son
épouse, Rosalie Parent. Pour le second, c’est le cinquième anniversaire
de mariage. Désiré Théberge est originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux et
demeure alors à Trois-Pistoles.
Le soir des Rois (6 janvier)
quelques intimes se rendaient à la résidence de Mme Désiré Théberge,
pour lui présenter leurs compliments et bons souhaits à l’occasion de
son 30e anniversaire de naissance. Il y a eu lecture
d’adresses par ses filles, Mlles Jeanne et Rose-Aimée Théberge. Mme
Eugène Vaillancourt (Laura), au nom des dames présentes, adressa à sa
belle-sœur des paroles bien appropriées pour la circonstance.
À l’occasion de cette fête, Mme
Théberge a reçu de nombreux cadeaux. M. Théberge lui a donné un
magnifique cabinet à argenterie ; Mlles Rose-Aimée, Jeanne et Thérèse
Théberge, des gerbes de fleurs ; M. Armand Théberge, un set à thé en
argent ; Mme J. A. Parent, du Bic, mère de Mme Théberge, un chèque ; M.
Adélard Parent et Mlle Maria Parent, du Bic, des cartes de prix, etc.
Vers minuit, un succulent goûter
préparé par ses filles fut servi aux personnes qui ont pris part à cette
charmante réunion et qui ont été si bien reçues par M. et Mme Théberge.
Cette magnifique soirée s’est terminée par du chant et de la musique.
2. Le
Progrès du Golfe, 28 juillet 1922
Le 16 juillet 1922, un groupe de parents et d’amis se rendait au
domicile de M. Désiré Théberge, commis-marchand de cette ville
(Trois-Pistoles), pour lui présenter ainsi qu’à Madame Théberge des vœux
de bonheur à l’occasion du cinquième anniversaire de leur mariage.
Parmi les personnes présentes, on remarquait Madame Alfred Théberge (Rose Rousseau), Mlles Clémentine et Corinne Théberge de St-Mathieu, mère et sœurs de M. Théberge, Mlles Marie-Ange et Marie-Laure Théberge, ses nièces, M. Léo Théberge, son neveu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5655
18 novembre 2020
Une famille noble à Saint-Mathieu
Jusqu’à la fin du 19e siècle, la population du Québec est
partagée en deux classes sociales, les nobles qui sont une minorité et
les roturiers. Les avocats, les notaires, les médecins, les prêtres et
les hauts gradés de l’armée sont souvent associés aux nobles, mais ne
font pas nécessairement partie de cette classe.
À cette époque, il est rare que des nobles vivent dans des petites
paroisses rurales. Pourtant, en 1886, un couple noble s’installe à
Saint-Mathieu-de-Rioux. Voici les circonstances :
En 1883, l’abbé Hermel Tremblay, âgé de 30 ans et natif des Éboulements,
est nommé curé de Saint-Mathieu-de-Rioux. Comme cela se fait souvent à
l’époque, le curé héberge ses parents au presbytère. Son père, André
Tremblay, a 75 ans et sa
Publication d’un ban
Il me semble voir le curé Hermel Tremblay dans la chaire de l’église de
Saint-Mathieu dimanche le 14 février 1886 lors de la grand’messe. Il a
la tête haute et le cœur à la joie quand il prononce ces mots : « Il y a
promesse de mariage entre Wilfrid Joseph Tremblay, écuyer, major de
milice et négociant, de cette paroisse, fils majeur d’André Tremblay,
cultivateur, et d’Adélaïde Tremblay de cette paroisse et autrefois de
Notre-Dame des Éboulements et
Marie-Lucette d’Estimauville de Beaumouchel (2),
fille majeure de feu Robert Anne Chevalier d’Estimauville de
Beaumouchel, écuyer et avocat de Saint-François de Montmagny et d’Adèle
Zoé Couillard de Lespinay. Le mariage sera célébré à Montmagny mardi de
cette semaine. »
Le curé Tremblay reprend son souffle et dit : « Je serai absent de la
paroisse une bonne partie de la semaine. Le curé de Saint-Simon a bien
voulu accepter de répondre aux urgences. Je vais à Montmagny pour bénir
le mariage de mon frère William Joseph. »
Voyage à Montmagny
On peut penser que, dès le lundi, le bedeau attelle le cheval de la
Fabrique. Direction : la gare de Saint-Simon. Le curé Tremblay prend
place dans la sleigh à patins. Ses parents ne sont pas du voyage.
Sa mère est décédée l’année précédente à Saint-Mathieu (3). Son
père a 81 ans. Le curé est accompagné d’Auguste D’Anjou, marchand et
secrétaire-trésorier de la municipalité, qui sera le témoin du marié
(4).
Il est fort probable que le marié fait aussi partie du voyage parce
qu’il est alors domicilié à Saint-Mathieu. Puis, c’est le train qui
conduit tout ce monde à Montmagny.
Le mariage
Dans son édition du 19 février 1886, le Journal de Québec annonce
que le mariage de W. Joseph Tremblay et Marie-Lucette d’Estimauville a
eu lieu à Montmagny le 16 février. Il continue :
« La bénédiction nuptiale a été donnée par le révérend messire Hermel
Tremblay, curé de Saint-Mathieu, et frère du marié, assisté par le
révérend messire F. (Fréderic Auguste) Oliva, curé de Saint-François. Un
chœur d’amis, sous l’habile direction de M. Joseph Létourneau, organiste
de Montmagny, a rehaussé l’éclat de la cérémonie. Après le déjeuner pris
chez James Oliva, écuyer, C. R., beau-père de la mariée, l’heureux
couple est parti pour Saint-Mathieu. »
Tout comme le marié, James Oliva est écuyer. À l’époque, c’est une
qualification noble. En plus, il est conseiller du roi (C. R.). En 1872,
il épouse Adèle Zoé Couillard, mère de la mariée, qui a eu 16 enfants de
son premier mariage. Le prêtre qui assiste le curé de Saint-Mathieu lors
de la cérémonie de mariage est le frère de James Oliva. Ce dernier est
un personnage important dans l’histoire de Montmagny.
Retour à Saint-Mathieu
Comme on le sait, après le mariage, W. Joseph Tremblay et Lucette
D’Estimauville viennent vivre à Saint-Mathieu. Ils auront quatre enfants
dont l’aîné est né à Saint-Mathieu et les autres à Roberval (5).
Ils quitteront la paroisse en 1887 ou en 1888.
Conclusion
Saint-Mathieu-de-Rioux a hébergé une famille noble pendant deux ou trois
ans. Pourquoi W. Joseph Tremblay a-t-il quitté la paroisse
? A-t-il été rappelé par la
milice canadienne pour une mission ? Peut-on penser qu’après son
mariage, il demeurait encore au presbytère et que l’incendie de cette
bâtisse le 28 avril 1887 l’a incité à aller vivre ailleurs,
notamment parce que les paroissiens n’ont pu sauver qu’une partie
seulement de l’ameublement de la bâtisse et que le curé Tremblay a dû
loger dans la salle publique.
Aucun document consulté ne répond à ces questions.
(1)
Le marié
W. Joseph Tremblay est né aux Éboulements le 13 mai 1851. Son vrai
prénom de baptême est Joseph Guillaume. Lors de son mariage, il a 34
ans. En 1880, il est nommé major commandant du 88e bataillon
de Charlevoix et de Kamouraska. Il démissionne en 1892. À cause de ses
services dans la milice canadienne, on lui attribue le titre d’écuyer.
En janvier 1899, il est élu maire du village de Roberval,
poste qu’il occupe pendant trois ans. Pour gagner sa vie, il est
marchand et banquier. Il est décédé le 2 juin 1921 à l’âge de 70 ans.
(2) La mariée
Lucette d’Estimauville de Beaumouchel est née le 25 décembre 1852 à
Saint-Thomas de Montmagny. On lui a donné aussi les prénoms de
Marie-Luce Anaïs. Lors de son mariage, elle a 33 ans. Son grand-père
paternel était écuyer et adjudant greffier. Son bisaïeul paternel était
capitaine et seigneur de Beaumouchel. Son trisaïeul était sire et baron.
Elle est décédée le 6 février 1932 à l’âge de 80 ans.
(3) Acte de sépulture de la mère du marié
« Le vingt-trois novembre mil huit cent quatre-vingt-cinq nous prêtre
soussigné curé de Saint Mathieu Rimouski, fils de la défunte, avons
inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de Adélaïde à l’âge
de soixante-douze ans. Étaient présents Joseph Tremblay écuyer et Thomas
Tremblay fils de la défunte lesquels ont signé avec nous en présence. »
L’acte de sépulture est signé notamment
par le curé Tremblay.
Plus tard, le 6 janvier 1899, André Tremblay rend l’âme à l’âge de 90
ans. Il est inhumé au même endroit.
(4) L’acte de mariage
« Le seize février mil neuf cent quatre-vingt-six vu la dispense de de
deux bans et la publication du troisième faite au prône de notre messe
paroissiale ainsi qu’à St-Mathieu, diocèse de Rimouski, comme il appert
par le certificat du curé du lieu, entre William Joseph Tremblay,
écuyer, major dans la milice active et négociant, domicilié à
St-Mathieu, diocèse de Rimouski, fils majeur de André Tremblay,
cultivateur, et de défunte Adélaïde Tremblay, des Éboulements d’une
part, et Marie Lucette d’Estimauville de Beaumouchel, fille majeure de
feu Robert Chevalier d’Estimauville de Beaumouchel, écuyer, avocat, et
de dame Zoé Couillard de cette paroisse d’autre part, ne s’étant
découvert aucun empêchement au dit mariage, nous soussigné, curé de
St-Mathieu, avons de l’agrément du curé de cette paroisse, reçu leur
mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction
nuptiale en présence de James Oliva, écuyer, avocat, beau-père de
l’épouse et de Auguste D’Anjou, ami de l’époux, qui ont signé avec nous
ainsi que les époux et plusieurs autres parents. » Suivent 15
signatures.
(5)
Enfants du couple
1. Marie Joseph Robert André François Xavier Hermel Tremblay, né le 2
décembre 1886 à Saint-Mathieu.
2. André
Anne Raphaël George Joseph Tremblay, né le 20 novembre 1888 à Roberval.
3. Marie Joseph Henri Louis Philippe Léonce Tremblay, né le 9 mars 1890
à Roberval.
4. Marie Joseph Robert Tremblay, né le 10 novembre 1892 à Roberval. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5645
12 novembre 2020
Funérailles de Raymond Ouellet
Le décès par la tuberculose d’un jeune homme de Saint-Mathieu qui
étudiait au Séminaire de Rimouski a fortement ébranlé la population de
la paroisse et ses confrères du collège. Voici ce que rapporte le
Progrès du Golfe dans son
édition du 13 juin 1947 :
« Un émouvant hommage a été rendu, le mercredi 4 juin, à la douce
mémoire de Raymond Ouellet, étudiant au Séminaire de Rimouski, enfant de
M. et Mme J.- Émile Ouellet, de Saint-Mathieu, décédé au Sanatorium
Saint-Georges de Mont-Joli, à l'âge de 20 ans et 3 mois, après 19 mois
de maladie.
Le défunt a laissé dans le deuil : son père, M. J.-Émile Ouellet ;
sa mère Célina Bérubé ; ses frères, M. l’abbé Paul-Émile,
assistant-procureur à l'Archevêché de Rimouski, MM. les abbés Mathieu et
Ulric, étudiants en théologie au Grand Séminaire de Rimouski, Gérard,
Louis, Dominique, Jacques ; ses sœurs : la Rév. Sœur Saint-Edgar, S. M.,
Adrienne, Marie-Claire ; ses belles-sœurs : Mme Gérard (Germaine
Parent), Mme Louis (Laura Vaillancourt) ; son beau- frère : M. Raoul
Vignola.
Les funérailles eurent lieu à l'église paroissiale, au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis. La levée du corps fut faite à la
demeure du défunt par M. l’abbé Louis-Joseph Lavoie, curé de l’endroit.
Le service funèbre fut chanté par le frère du défunt, M. l'abbé
Paul-Émile Ouellet, assisté de son cousin, M. l'abbé Élie Beaulieu,
économe à l’Archevêché, et de son frère, M. l’abbé Mathieu, ces derniers
remplissant l’office de diacre et de sous-diacre. »
Suit une liste de 19 membres du clergé qui assistaient au chœur
dont Mgr Médard Belzile, représentant de Mgr Georges Courchesne,
archevêque de Rimouski, M. l’abbé Donat Crousset, préfet des études au
Séminaire de Rimouski et représentant de Mgr Georges Dionne, supérieur
du Séminaire, M. l’abbé Raoul Thibault, directeur du Séminaire et
plusieurs de ses anciens professeurs au Séminaire.
Suit une autre liste de plus de 100 personnes de Saint-Mathieu dont
le maire Onésime Dionne, plusieurs oncles et tantes, plusieurs cousins
et cousines et les révérendes sœurs du Saint-Rosaire avec leurs élèves.
Une autre liste comprend les noms de plus de 100 personnes provenant
principalement de Rimouski et des environs de la paroisse de
Saint-Mathieu.
« Les élèves de Rhétorique du Séminaire de Rimouski, promotion de
1946-47, assistaient tous au service de leur confrère. Ils portèrent la
dépouille mortelle, la bannière des Enfants de Marie, la Croix du
Tiers-Ordre, le drapeau Lacordaire du Séminaire.
À l’orgue, M. l’abbé Fernand Beauchemin. La chorale locale était
assistée des confrères séminaristes du défunt. Le corbillard était
conduit par M. Georges Théberge, cousin. M. Émile Théberge, oncle et
parrain du disparu, portait la croix. »
Dans son livre
Horace ou l’art de porter la
redingote, Bertrand B. Leblanc, un confrère de Raymond Ouellet au
Séminaire de Rimouski, écrit :
« On demanda au directeur la permission d’assister aux obsèques. On nolisa un autobus et on partit sous un soleil arrogant, vers Saint-Mathieu à quelques milles au sud du littoral, dans les montagnes. L’infinie tristesse d’une petite église froide où des étrangers en noir pleuraient incontrôlablement. Et nous tous, comme des intrus, conscients de perdre vraiment cette fois un confrère, un ami qu’il fallait rendre à sa famille. D’ailleurs il était méconnaissable. Ça ne pouvait pas être lui le copain dont on espérait le retour. Les mains exsangues, la bouche filiforme, le corps squelettique, il avait déjà la vieillesse indéfinissable de la mort. Et toutes ces gens qui nous donnaient la main, qui nous remerciaient, à qui on faisait certes un peu de bien mais qui ne pouvaient cacher une sourde rancœur, parce que nous rappelions, avec nos redingotes, la machine hideuse qui leur avait arraché un membre. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5615
24 octobre 2020
Funérailles de dame Jean Dionne
Dans son
édition du 15 août 1918, L’Action
catholique, un journal de Québec, nous apprend le décès d’Hélène
Jean, épouse de Jean Dionne. Voici ce qui y est écrit :
« Le 2 août,
madame Jean Dionne, née Hélène Jean, rendait son âme à son Créateur,
munie de tous les secours de la religion, après une cruelle maladie de
trois mois chrétiennement soufferte.
S’il est vrai
de dire que le Seigneur éprouve ses fidèles amis, madame Dionne fut plus
que tout autre l’amie de choix de son Seigneur et de son Dieu ; car
depuis vingt-neuf ans, elle était incapable de vaquer à ses occupations
journalières et parfois souffrait cruellement. Elle sut accepter cette
croix et la porter courageusement jusqu’au bout à l’exemple du Maître.
Aussi, nous en avons la douce espérance reçut-elle la couronne de vie
dès son entrée au paradis. C’est une citoyenne intègre et une chrétienne
fervente, une épouse fidèle et une mère dévouée qui disparaît.
Madame Dionne
était de ceux dont la bienveillance et la bonté naturelle jointe à un
cœur hospitalier et droit s’attachent des amis nombreux et ne se créent
guère d’ennemis malgré les divergences de caractère et d’opinions. Les
qualités du cœur font les âmes selon ce qu’on dit : rien de plus vrai.
Entourée d’affection, jouissant de la considération générale, heureuse
d’une vie paisible et douce, elle avait le bonheur de demeurer près de
l’église depuis douze ans. Vivant de son labeur et de son esprit de
prévoyance, elle quitta tout à l’âge de 72 ans pour sa véritable patrie.
Son dernier sacrifice, elle l’accepta avec la sérénité qu’un chrétien ne
peut posséder à cette heure dernière.
Son service
et sa sépulture ont eu lieu, mardi le 6, au milieu d’un immense concours
de parents et d’amis dont voici les noms :
Conduisaient
le deuil : M. Jean Dionne, son époux. Portaient la croix : M. Eugène
Vaillancourt, neveu de la défunte. Portaient le corps : MM Antoine
Dionne, Théophile Dionne, François-Xavier Dionne, fils de la défunte, et
Georges Leclerc, son gendre.
Portaient les
coins du poêle (drap mortuaire) : Madame Narcisse Rioux, sœur de la
défunte, Madame Joseph Jean, belle-sœur et Madame Xavier Dionne ainsi
que Madame Théophile Dionne, ses brus.
Suivaient le
corps : Madame Georges Leclerc et Mademoiselle Elmina Dionne, ses deux
filles, M. Joseph Jean et M. Théophile Jean, ses frères, Madame veuve
Léon Vaillancourt, sa belle-sœur.
Cousins : M.
Vézina Jean de St-Simon, M. Narcisse Jean de St-Mathieu et Ferdinand
Jean, Gonzague Dionne, Cyprien Lagacé de St-Mathieu, Émile Gauvin de
St-Simon.
Neveux et
nièces : M. Philéas Gaudreau et son épouse de St-Mathieu, Mme Félix
Vaillancourt, M. Ernest Dionne, F. Dionne, Omer Vaillancourt, Félix
Vaillancourt, Joseph Audet.
Autres :
Alfred Dionne, Robert Leclerc, M. Antoine Ouellet, notaire de St-Pascal,
M. Jean D’Anjou et Clovis Gagné, M. Vézina Jean, Johnny Gauvin, Joseph
Nicole et Mlles Nicole également de St-Simon. M. Cyprien Plourde et son
épouse, M. Joseph Ouellet et son épouse, François Parent, Alphonse
Bélanger, Georges Parent, Alfred Théberge, Elzéar Lévesque, Samuel
Lévesque, François Ouellet, Désiré Rousseau et Émile Ouellet de
St-Mathieu.
Bouquets
spirituels : Offerts par les demoiselles Richard et Cayouette, Mlle
Marie-Ange Vaillancourt, M. et Mme Narcisse Rioux, Mlle Adélia Jean de
St-Mathieu.
Offrandes de messes : M. et Mme Georges Leclerc de Lévis, M. et Mme Joseph Jean, Xavier Dionne et Narcisse Dionne. Signé. Un témoin » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5590
9 octobre 2020
Nouvelles de 1918 et 1919
Dans son
édition du 23 novembre 1918, le
Progrès du Golfe publie des nouvelles concernant
Saint-Mathieu-de-Rioux.
Décès
Encore une nouvelle victime de la
grippe. Cette fois-ci, il s’agit d’une jeune femme enlevée à la fleur de
l’âge à l’affection des siens : Madame Cyprien Plourde, née Aurore
Théberge, décédée mardi et inhumée mercredi le treize à l’âge de 26 ans.
(NDLR. Ce fut le dernier décès lié à la grippe espagnole à St-Mathieu.)
Elle laisse pour déplorer sa perte
son époux et une jeune enfant de deux ans. Son père et sa mère ainsi que
deux frères et quatre sœurs lui survivent.
Condoléances
Ci-dessous la copie des
résolutions de condoléances à propos de la mort du maire de la paroisse
M. Georges Caron.
À une assemblée spéciale du
conseil de cette municipalité tenue lundi le onzième jour de novembre à
9 h du matin, il a été proposé par M. Ernest Dionne, secondé par MM.
Louis Parent et François Dumont.
« Que les membres de ce conseil
ont appris avec chagrin la mort de M. Georges Caron, maire de cette
municipalité, et qu'ils offrent à Mme la mairesse leurs plus sincères
condoléances.
Il a aussi été proposé que copie de la présente résolution soit
envoyée à la famille ainsi qu’au journal le Progrès du Golfe.
Adopté
Joseph Audet, séc.-trés. »
Dans son
édition du 17 janvier 1919, le
Progrès du Golfe écrit :
« Marguillier
M. Narcisse
Jean en remplacement de M. Cyprien Plourde, marchand.
Conseillers municipaux
Alphonse
Lagacé, Napoléon Létourneau et Théophile Dionne. M. Antoine Dionne,
manufacturier de boîtes à beurre, a été élu maire de la paroisse.
Statistiques (de 1918)
Baptêmes 42,
mariages 6, sépultures 15.
Visite
M. l’abbé
Omer Dubé, curé de St-Simon, était l’hôte de M. le curé le jour de l’An
au soir.
Le même soir eut lieu le départ de M. l’abbé Ludger Harvey qui était parmi nous depuis 2 ½ mois pour prêter secours à M. le curé durant sa longue maladie (grippe espagnole). Ce jeune prêtre par ses grandes qualités a su se concilier l’estime de tous et c’est avec regret que nous l’avons vu partir. Nous lui souhaitons bons succès dans l'exercice de son saint ministère à sa nouvelle cure de St-Narcisse. » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5560
21 septembre 2020
Vente de terres à l’encan
Dans son édition du 31
janvier 1880, la Gazette
officielle du Québec annonce que six terres appartenant à des
cultivateurs de Saint-Mathieu-de-Rioux seront vendues aux enchères
publiques à Rimouski le 1er mars prochain à moins que le
paiement soit effectué avant le jour indiqué. Le journal précise que ces
ventes seront faites à cause de taxes dues à la municipalité.
Les lecteurs seront surpris du fait que les montants dus sont
minimes. Proposons quelques explications. Il est possible que les taxes
scolaires qu’on appelle alors des cotisations soient aussi non payées.
De plus, à cette époque, la coutume est à l’effet de faire « marquer »
dans les commerces, c’est-à-dire d’acheter à crédit. Le fait de faire
saisir leur terre est alors une façon pour les cultivateurs de se
débarrasser de leurs dettes, y compris parfois l’hypothèque.
De plus, certains cultivateurs laissent aller leur terre soit pour profiter
des avantages offerts aux colons d’obtenir gratuitement un lot de
colonisation dans des nouvelles paroisses, soit pour recommencer à neuf,
soit pour émigrer aux États-Unis.
Voici la localisation de six terres mises aux enchères, leur
propriétaire et le montant dû, tels que précisés dans le journal :
1. Deux arpents de terre de front sur trente arpents de profondeur,
situés en le troisième rang de la paroisse de Saint-Mathieu ; bornés au
nord-est à Frédéric Gaudreau et au sud-ouest à Louis Dubé, circonstances
et dépendances ; la propriété de Pierre Ouellet.
Montant dû : 75 ¢
2. Deux arpents de terre de front sur trente arpents de profondeur,
voisine du côté nord-est à Thomas D’Auteuil et au sud-ouest à Damase
St-Pierre, lesquels sont situés en le troisième rang de la paroisse de
Saint-Mathieu ; la propriété de Pierre Ouellet.
Montant dû : 1,16 $
3. Deux arpents de terre de front sur trente arpents de profondeur,
situés en le cinquième rang de la paroisse de Saint-Mathieu ; voisine du
côté nord-est à Édouard Lagacé et au sud-ouest à Renouf et Rioux ; la
propriété de Joseph Dionne.
Montant dû : 18 ¢
4. Trois arpents de terre de front sur trente arpents de
profondeur, situés en le cinquième rang de la paroisse de Saint-Mathieu
; bornés au nord-est à Firmin Bérubé et à l'ouest à Narcisse Beaulieu ;
la propriété de Thomas Dumont.
Montant dû : 88 ¢
5. Deux arpents de terre de front sur trente arpents de profondeur,
situés en le cinquième rang de la paroisse de Saint-Mathieu ; bornés au
nord-est à Alphonse Dionne et au sud-ouest à Dumas St-Jean ; la
propriété de Pierre Fraser.
Montant dû : 8,33 $
6. Quatre arpents de terre de front sur trente arpents de
profondeur, situés au cinquième rang de la paroisse de Saint-Mathieu ;
bornés à l’est aux Dames Casault, seigneuresses, et à l'ouest à un
inconnu ; la propriété de Hyacinthe Beaulieu.
Montant dû : 88 ¢ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5535
6 septembre 2020
Nouvelles du 14 février 1913
Dans son
édition du 14 février 1913, le
Progrès du Golfe, un journal de Rimouski, publie des nouvelles
concernant Saint-Mathieu-de-Rioux.
Mariages
- Le 7 janvier, M. Louis Gagnon, de St-Fabien, unissait sa destinée
à celle de Mlle Adélia Rioux, fille de M. Narcisse Rioux, cultivateur.
- Le même jour, M. Antoine Paradis, fils de M. Jean-Baptiste
Paradis à Mlle Joséphine Caron, fille de M. Georges Caron.
- Le 27 janvier, M. Eugène Dévost, fils de Pierre Dévost, à Mlle
Marie-Hélène Rioux, des Trois-Pistoles.
- Le 3 février, M. Charles-Eugène Lagacé, fils de Joseph Lagacé,
maire des Trois-Pistoles, à Mlle Marie-Anne Jean, fille de Jean (Johnny)
Jean.
Sépulture
Le 16 janvier a été inhumée Mme Élise Dubé, épouse de Jean Lagacé.
Elle s’est éteinte à l'âge de 40 ans. Elle laisse pour la pleurer un
époux bien-aimé et une fille Mme Charles Rousseau (Marie-Anne Lagacé).
Baptême
L’épouse de M. Georges Leclerc, arpenteur de Lévis,
a donné le jour à un fils qui porte les noms de Georges Robert Rosario.
Parrain et marraine, M. et Mme Jean Dionne, grands-parents de l’enfant.
En visite
- Mlle Clairina Cayouette, de la Rivière de Trois-Pistoles, était
de passage au presbytère la semaine dernière.
- Mme Vve Ulric Bérubé est en promenade chez ses parents et amis,
ces jours-ci.
- M. le notaire Ouellet, de St-Pascal, était en visite chez son
père M. Étienne Ouellet, dimanche dernier.
- Mme Georges Parent, de Trois-Pistoles, était aussi de passage
ici, durant les jours gras, en visite chez ses parents et amis.
- Mlle Rose-Aimée Cayouette est de retour d’une promenade dans sa
famille à Ste-Claire, où elle était allée pour assister au mariage de
son frère M. Fénelon Cayouette.
Malade
Mme Majorique Rousseau est dangereusement malade.
Fête des Saintes Reliques.
Le 29 janvier, la fête des Saintes Reliques a eu lieu dans cette
paroisse. M. le chan. Lavoie, Rév. M. Jean, Rév. M. Santerre, Rév. M.
Pelletier, Rév. M. Amyot et le Rév. M. Arpin sont venus prêter leur
concours à M. le curé. Le sermon a été donné par le Rév. M. Arpin : il a
été très apprécié des auditeurs.
Statistiques Durant l’année qui vient de s'écouler il y a eu 9 mariages, 9 sépultures et 26 baptêmes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5500
15 août 2020
Émigration vers les États-Unis
Vers 1840, un mouvement d’émigration de Québécois vers les États-Unis
prend forme et dure jusqu’en 1930 alors que le pays ferme ses
frontières.
À Saint-Mathieu-de-Rioux, le mouvement débute en 1887. Nous avons eu la
chance de mettre la main sur un article d’un citoyen de Trois-Pistoles,
qui semble être bien informé. L’article dont le titre est
Le fléau de l’émigration a
été publié dans L’Électeur,
un quotidien de Québec, le 16 juillet 1892. On y trouve d’abord une
brève description de la situation économique de Saint-Mathieu qui
apparaît comme désastreuse. Puis, l’auteur fait une liste de familles
qui ont émigré aux États-Unis de 1887 à 1892. Voici le texte de
présentation :
« La paroisse de St-Mathieu, dans le comté de Rimouski n’est pas
prospère. Le sol est pauvre. Les trois quarts des terres sont
surchargées d’hypothèques et il est impossible à leurs propriétaires de
songer à se défaire de ces obligations onéreuses au moyen des produits
de la ferme. La récolte n’est pas assez abondante chaque année pour
qu’ils puissent entretenir ces espérances. Même si, par impossible, ils
récoltaient beaucoup, ils ne seraient guère plus avancés, ils vendraient
nécessairement leurs produits à vil prix.
Aussi, il ne faudra pas être étonné de voir cette paroisse se dépeupler
graduellement. Il est indubitable que le tiers de ses habitants auront
émigré dans les États de la Nouvelle-Angleterre avant deux ou trois ans.
La population de St-Mathieu est actuellement de 900 âmes environ. » (Fin
du texte cité)
Voici la liste des partants de 1887 à 1892 et leur nombre par
année en supposant que chaque homme est accompagné de son épouse :
En 1887 : 7 personnes dont 5 enfants
Anatole Moreau, 5 enfants
En 1888 : 49 personnes dont 37 enfants
Narcisse Lévesque, 8 enfants
Noël Lévesque, 4 enfants
Frédéric Rioux, 6 enfants
Lucien Rioux, 8 enfants
Pierre Fraser, 6 enfants
Denis St-Jean, 5 enfants
En 1889 : 76 personnes dont 54 enfants
Joseph Bérubé, 7 enfants
Napoléon Charrette, 0 enfant
Joseph Dévost, 6 enfants
J. B. Lavoie, forgeron, 4 enfants
J. B. Lavoie, meunier, 5 enfants
Théophile Lévesque, 0 enfant
Pierre Ouellet, 5 enfants
Michel Paradis, 9 enfants
Charles Ricard, 5 enfants
Marcellin Rousseau, 5 enfants
Joseph Sergerie, 8 enfants
En 1890 : 195 personnes dont 143 enfants
Édouard Bérubé, 10 enfants
Édouard Bérubé, fils de Séverin, 4 enfants
Charles Caron, 4 enfants
William Castonguay, 3 enfants
Jean Côté, 7 enfants
Léandre Dévost, 8 enfants
Louis Dubé, 4 enfants
Maxime Dubé, 7 enfants
Séverin Dubé, 7 enfants
Paul Gaudreau, 5 enfants
Luc Jean, 6 enfants
Xavier Jean, 8 enfants
Louis Leclerc, 6 enfants
Eusèbe Lévesque, 4 enfants
Narcisse Lévesque, fils de David, 7 enfants
J. B. Michaud, 6 enfants
Charles Morin, 4 enfants
Aristobule Paradis, 4 enfants
Venant Plourde, 8 enfants
Simon Rioux, 6 enfants
Joseph Roy, 5 enfants
Pierre Roy, 3 enfants
Germain St-Laurent, 5 enfants
Étienne Tardif, 2 enfants
J. B. Tondreau, 4 enfants
Célestin Vaillancourt, 6 enfants
En 1891 : 33 personnes dont 23 enfants
Barthélémy Dandurand, 3 enfants
Charles Dandurand, 4 enfants
Denis Fournier, 4 enfants
Philippe Lagacé, 7 enfants
Cléophas Turcot, 5 enfants
En 1892 : 21 personnes dont 15 enfants
Octave Boucher, 8 enfants
Narcisse Lévesque, père, 4 enfants
Jos. Paradis, père, 3 enfants
Voici un tableau qui résume la situation :
« La plupart de ces familles sont maintenant dans les États du Maine et
du Massachusetts. Quelques-unes d’entre elles se sont fixées dans les
villes manufacturières de l’État du Michigan ; enfin, d’autres, en petit
nombre, sont dans l’ouest américain dans le Minnesota et le Dakota. »
Il semble bien que la prédiction de l’auteur de l’article ne s’est pas
réalisée parce que de 1891 à 1900 la population de Saint-Mathieu a
diminué de 107 personnes dont 54 avaient émigré en 1891 et 1892.
D’ailleurs, l’année marquante est de loin 1890, comme le montre le
tableau précédent. Les 195 départs ont, sans aucun doute, constitué tout
un choc pour la population de la paroisse.
Selon des experts, autour de la moitié des partants du Québec sont
revenus chez eux après quelques années aux États-Unis. En est-il de même
pour les Mathéens ? On n’en sait rien.
Alors que la population de Saint-Mathieu-de-Rioux est de 1175 habitants en 1881, pendant les années subséquentes, elle sera à son plus bas niveau en 1921 avec 781 habitants pour dépasser les 1000 personnes de 1941 à 1966. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5475
30 juin 2020
La commission scolaire
Selon le Journal de
l’Instruction publique de juillet 1859, la commission scolaire de
Saint-Mathieu-de-Rioux a été érigée en 1859.
Dans l’Album-souvenir du
centenaire publié en 1966, j’avais écrit : « 31 décembre 1869.
Première assemblée de la Commission scolaire consignée au registre. Le
président est M. le curé Antoine Chouinard et les commissaires sont
Georges Parent, Édouard Bérubé et Barthélémy Dandurand. Le
secrétaire-trésorier est Théophile Lévesque. »
J’avais puisé cette information dans les registres de la commission
scolaire. Se peut-il que le secrétaire ne consignait pas les procès
verbaux dans un grand livre avant cette date? Pour le savoir, il
faudrait peut-être retrouver le registre qui a été ouvert en 1869 car
il a été égaré.
En novembre
1859, le Journal de l’Instruction
publique, annonce que « Son Excellence, le Gouverneur Général, a
bien voulu, le 25 octobre dernier, faire les nominations suivantes de
commissaires d’école pour Saint-Mathieu : MM. Célestin Vaillancourt,
Damase Devost, Hyacinthe Gagnon, Vital Rousseau et Édouard Lagacé. »
« Les
commissions scolaires reconnues comme pauvres reçoivent des subventions
du Gouvernement. La commission scolaire de Saint-Mathieu reçoit pour 1865 une subvention
ordinaire de 84,10 $. Elle a prélevé en cotisations (impôts scolaires)
118,60 $. En plus, elle reçoit une subvention supplémentaire de 30 $
alors qu’elle demandait 36 $. »
Journal de l’Instruction publique, février 1866
« La
commission scolaire de Saint-Mathieu reçoit pour 1866 une subvention ordinaire de 84,10 $. Elle a prélevé
121 $ en cotisations. En plus, elle reçoit une subvention supplémentaire
de 27 $ alors qu’elle demandait 32 $. » Journal
de l’Instruction publique, mars 1867
En 1867,
« cette municipalité n’a que deux écoles mais on avise aux moyens d’en
ouvrir une troisième dans un canton éloigné des écoles établies. Les
progrès sont satisfaisants dans ces deux écoles que fréquentent 98
élèves, avec une assistance quotidienne de 67 élèves. On note que les
livres de comptes sont bien tenus. »
Journal de l’Instruction publique,
mai 1867.
« La
commission scolaire de Saint-Mathieu reçoit
pour 1870 une subvention ordinaire de 84,10 $. Elle a prélevé 94,32 $.
En plus, elle reçoit une subvention supplémentaire de 30 $ alors qu’elle
demandait 30 $. On note que quatre écoles existent. »
Journal de l’Instruction publique, janvier 1871
« La
commission scolaire de Saint-Mathieu reçoit
pour 1871 une subvention ordinaire de 84,10 $. Elle a prélevé en
cotisations 152,90 $. En plus, elle reçoit une subvention supplémentaire
de 30 $ alors qu’elle demandait 36 $. On note que quatre écoles
existent. »
Journal de l’Instruction publique, mars 1872
Les derniers
extraits nous montrent le peu de ressources financières de la commission
scolaire. Par exemple, en 1871, le budget annuel de l’organisme est de
267 $ pour quatre écoles, soit une moyenne de 66,75 $ par école. Avec
cet argent, il fallait payer l’institutrice et assurer le loyer des
maisons d’école et l’entretien des écoles, en particulier le chauffage
pendant l’hiver.
Le 30 octobre
1880, la Gazette officielle du
Québec publie un avis de demande d’annexion. Le texte se lit comme
suit :
« Annexer à
la municipalité de Sainte-Françoise, dans le comté de Témiscouata, le
territoire suivant de la paroisse de Saint-Mathieu, dans le comté de
Rimouski, savoir : dix-huit arpents de front sur la cinquième
concession, et 14 arpents sur la sixième concession ; bornée au nord aux
terres de la quatrième concession, de la seigneurie de Nicolas Rioux, au
sud aux terres de la septième concession, à l’ouest à la ligne de
Sainte-Françoise, et à l’est à Thomas P. Pelletier, écuyer, sur les deux
concessions. »
En septembre 1892, le journal L’enseignement primaire écrit : « Il a plu à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, par un ordre en conseil, en date du 8 juillet dernier (1892), de détacher de la municipalité de Saint-Mathieu de Rioux, comté de Rimouski, les propriétés nos 135, 136, 137, 138 et 139 du cadastre de la dite paroisse, et les annexer pour les fins scolaires à la municipalité de la paroisse des Trois-Pistoles, comté de Témiscouata. Cet ordre en conseil ne prendra effet que le premier de juillet prochain (1893) ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5465
24 juin 2020
Nouvelles du 16 janvier 1909
Dans son
édition du 16 janvier 1909,
L’Action sociale, journal de Québec qui a précédé
l’Action catholique,
on peut lire
plusieurs nouvelles concernant la paroisse de Saint-Mathieu-de-Rioux.
Des éléments d’information ont été ajoutés.
« À une
assemblée des anciens et nouveaux marguilliers, M. Cyprien Bélanger a
été élu marguillier en remplacement de M. Charles Ouellet sortant de
charge. Les deux autres marguillers sont Thomas Pelletier et Ludger
Ouellet.
Baptêmes. M.
et Mme Charles d'Auteuil (Émilia Dionne) ont fait baptiser une fille
sous les noms de Marie Rose Anna. Parrain et marraine : M. et Mme
Adélard d'Auteuil (Elmire Gaudreau). Note. Rose Anna est née le 31
décembre 1908. Elle épousera Georges Roy le 23 décembre 1944 à
Louiseville.
M. et Mme
Philéas Gaudreau (Delphine Dionne) ont fait baptiser une fille Marie
Rose Délima. Parrain David Ouellet, marraine Délima Gaudreau. Note. Rose
Délima est née le 31 décembre 1908. Elle épousera Ernest Desjardins le
26 décembre 1925 à St-Mathieu.
M. et Mme
Narcisse Rioux (Arthémise Jean) ont fait baptiser un fils sous les noms
de Joseph Roméo Camille. Parrain Victor Jean, marraine Marie-Anna Jean.
Note. C'est le 16e enfant du couple Rioux-Jean. Roméo Camille
est né le 5 janvier 1909. Il décédera le 13 octobre 1931 à l’âge de 22
ans.
M. et Mme
Joseph Côté (Marie Ouellet) ont fait baptiser une fille Marie Ange.
Parrain et marraine : M. et Mme Thomas Ouellet (Marie-Rose Théberge).
Note. Marie Ange est née le 27 décembre 1908.
Extrait des
registres Les registres mentionnent pour 1908 : 8 mariages, 39 baptêmes, 15 sépultures. » (Fin du texte cité) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5440
9 juin 2020 Émélie Théberge (1892-1915)
Émélie Théberge est née
à
Saint-Mathieu-de-Rioux le 4 septembre 1892. Elle est la fille
d’Alfred Théberge et de Rose Rousseau. Dans son édition du 13 novembre
1914, le Progrès du Golfe nous
apprend qu’Émélie Théberge est malade. Six mois plus tard, soit le 21
mai 1915, le même journal nous apprend son décès. « Le douze mai,
la mort (…) enlevait à la fleur
de l’âge, une victime de la terrible consomption, Mlle Émilie Théberge,
institutrice, âgée de 22 ans, fille de M. Alfred Théberge,
secrétaire-trésorier. Les funérailles, le 15 mai, furent très
solennelles. L’église avait revêtu ses plus riches tentures de deuil et
l’assistance était nombreuse. La levée du corps se fit à la maison
mortuaire. M. le curé Cayouette officiait.
La croix était portée par Mlle M. Audet, accompagnée des porteurs :
M. Thomas Ouellet, beau-frère de la défunte, ses frères M. Émile et
Désiré Théberge, ses beaux-frères M. Eugène Vaillancourt et M. Cyprien
Plourde. Les coins du poêle (drap mortuaire) étaient portés par des
enfants de Marie, amis de la défunte, Mlle Élise Bernier, institutrice,
Mlle Marie-Thérèse Nicole, de St-Simon, Mlle Octavie Plourde et Mlle
Léontine Parent.
Le deuil était conduit par M. et Mme Alfred Théberge, père et mère
de la défunte, Mesdames Thomas Ouellet, Eugène Vaillancourt et Cyprien
Plourde, Mlles Clémentine et Corine Théberge, toutes sœurs de la
défunte. Les enfants de l'école modèle vinrent ensuite pour rendre un
dernier hommage à celle qui fut leur maîtresse aimée.
Dans le cortège, nous remarquions toutes les institutrices de la
paroisse, Mme Vve Thomas. Rioux, Mlles Sirois et Ouellet, les deux
demoiselles Bilodeau.
Le chant fut très réussi. À part les chantres ordinaires, les deux
demoiselles suivantes chantèrent des cantiques avant le service.
Mademoiselle Octavie Plourde, dont la voix est si douce et si
sympathique, chanta le cantique « Jusques à quand, enfants des hommes »
avec beaucoup d’âme. Avant le « libéra », Mlle Élise Bernier chanta
l’Adieu de Schubert, avec paroles adaptées pour sépulture de jeune
fille. Sa voix harmonieuse et si émue fit couler bien des larmes.
Mlle Émilie Théberge, jeune fille distinguée par ses vertus, ses
talents et son aimable caractère avait su se créer un grand nombre
d’amis qui ne l’oublieront pas de longtemps. Sa maladie si longue fut
soufferte avec une grande résignation. Dieu est venu cueillir cette
belle fleur pour en orner son ciel. Elle emporte des regrets unanimes
comme le prouvent les nombreuses offrandes de bouquets spirituels.
À la famille affligée nos plus sincères sympathies. »
L’article est signé Fleur du Pays. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#
5420
27 mai 2020
Fin tragique de Majorique Rousseau
Chaque
paroisse vit ses propres drames. Dans l’édition du 24 octobre 1903,
La Presse, un quotidien de
Montréal, raconte la disparition d’un paroissien de
Saint-Mathieu-de-Rioux.
« Un brave
cultivateur de St-Mathieu, comté de Rimouski, M. Majorique Rousseau, âgé
d’environ 70 ans, partit de sa demeure l’autre après-midi pour se rendre
au bois sur sa terre. Le soir, le vieillard ne revenait pas et, à mesure
que la nuit avançait, l’émoi grandissait au foyer.
Le lendemain
matin, sa famille fit part au voisinage de la disparition du vieillard.
Plusieurs amis alors se mirent à sa recherche toute la journée du
samedi, mais sans succès.
Dimanche
dernier, M. le curé de St-Mathieu, dans l’anxiété lui-même de connaître
ce qu’était devenu cet estimé paroissien, dit une messe basse au lieu de
chanter la messe paroissiale ordinaire et demanda à ses paroissiens de
se mettre immédiatement après la messe à la recherche de M. Rousseau.
En effet,
grand nombre de paroissiens se rendirent de bonne grâce à cette
invitation et firent une battue générale dans le bois. Dans le cours de
l’après-midi, on trouva le vieillard couché au pied d’un arbre sur le
côté droit et la main droite sous l’oreille. Il semblait dormir.
M. Majorique
Rousseau était un citoyen très estimé à St-Mathieu. Il était connu sous
le nom amical de « Père Major ». (Fin du texte cité)
Majorique
Rousseau est né le 24 avril 1830. Il est le fils de Laurent Rousseau et
de Rosalie Lévesque. Il épouse en premières noces Desanges Vaillancourt
le 11 juillet 1854 en l’église de Saint-Simon. En secondes noces, il
épouse Marie Lagacé le 15 octobre 1872 à Saint-Mathieu, Il décède le 16
octobre 1903. Il a donc 73 ans lors du drame.
De ses deux unions, Majorique Rousseau a 18 enfants. Citons Majorique (Geneviève Marquis), Zoé (Louis Fortin), Luce (Luc Larrivée), Désiré (Caroline Drapeau et Claudia Lavoie), Charles-Eugène (Marie Anne Lagacé), Éva (Jos Vaillancourt), Clairina (Jean-Charles Couturier). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5400
15 mai 2020
Vente du magasin général
L’électeur,
journal du matin de Québec, dans son édition du 1er mai 1889,
annonce la vente de la maison de T. Lévesque, de Saint-Mathieu-de-Rioux.
Qui est ce T. Lévesque ? Il est fort à parier qu’il s’agit de Théophile
Lévesque. En effet, cet homme a été le premier propriétaire en 1866 du
magasin général situé en face de l’église. Il est né en 1836.
Il est le fils de Pierre Lévesque et de Madeleine Gauvin. Il épouse
Arthémise Michaud le 28 octobre 1862 à Trois-Pistoles.
Il a été le premier secrétaire-trésorier de la commission scolaire de
Saint-Mathieu-de-Rioux en 1869. Il a aussi été le premier
secrétaire-trésorier de la municipalité de 1872 à 1881. On en déduit
qu’il avait une certaine instruction. Lors de l’annonce de la vente de
la bâtisse, il a 63 ans.
Voici le texte de l’annonce :
« Maison à vendre, T. Lévesque
Une magnifique maison à deux étages de 25 × 30 pieds avec cuisine
attenante en arrière, de 15 × 25 pieds, située près de l'église
St-Mathieu de Rimouski, avec ensemble hangar, étable et remise, sur un
emplacement d’un arpent sur un demi-arpent de terre.
Le tout en très bon ordre avec un côté de la maison dans le premier
étage pour le magasin et très confortable pour la réception des
touristes qui ont l’habitude d’aller tour à tour passer quelques jours
pendant la saison d’été, pour y faire la pêche dans les beaux lacs de
cette paroisse.
Conditions faciles.
S’adresser sur les lieux à T. Lévesque, St-Mathieu. » La photo de la maison a été publiée dans la monographie Saint-Mathieu-de-Rioux raconte son histoire en 2016. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5365
24 avril 2020
Décès d’un centenaire
Daniel Jean Girouard, époux de Claire Girouard (née Henley), de Calgary,
Alberta, est décédé le samedi 22 février 2020 à l'âge de 100 ans et 4
mois. Il était natif de Saint-Mathieu-de-Rioux. La maison funéraire
McInnis & Holloway a publié
sur son site une courte biographie en anglais de cet homme.
Comme le récit de sa vie est assez exceptionnel pour l’époque, j’ai
pensé vous présenter ce texte. Le voici en traduction libre :
« Daniel John Girouard, est né le 22 octobre 1919 d'Alfred Girouard et
d'Yvonne Dionne dans la paroisse de St-Mathieu au Québec. Le temps que
Daniel a passé avec sa mère a été malheureusement bref. En 1921, peu de
temps après la naissance du frère de Daniel, Charles, sa mère et son
bébé Charles sont décédés de complications après la naissance. Cette
tragédie a incité Alfred à quitter le Québec pour commencer une nouvelle
vie dans l'Ouest, soit dans le district de Peace River en Alberta.
Quand Daniel eut 12 ans, son père est revenu à Saint-Mathieu pour le
ramener en Alberta. Au début du séjour, Daniel ne croyait pas qu'Alfred
était son père. Le lendemain, après le retour de Daniel de l'école,
Alfred était toujours là. Ses grands-parents ont réussi à le convaincre
qu'Alfred était bien son père et il a accepté la situation. Daniel a
voyagé avec son père, ses oncles Charles et Ferdinand Dionne, et
Philippe D'Auteuil en Alberta.
Son père s'était marié une deuxième fois avec Florentine Campbell en
1926, ils avaient deux enfants : Ted (Phillip Alfred) et Jeanne. Daniel
avait un demi-frère et une demi-sœur qu'il avait rencontrés à son
arrivée à la propriété familiale de Dreau en Alberta. Daniel a poursuivi
ses études jusqu'à l'âge de 15 ans quand il a fait une chute brutale de
son cheval et s'est blessé à la jambe. Après avoir récupéré à la maison,
il a été décidé qu'il avait suffisamment de scolarité, et il était temps
pour lui de commencer à travailler à plein temps à la ferme. Daniel a
travaillé à la ferme jusqu'à ce qu'il convainque son père de le laisser
aller dans un camp de bûcherons pour aider ses oncles. Il a également
défriché des terres avec son père et a travaillé pour le chemin de fer
dans sa jeunesse.
En 1941, à l'âge de 21 ans, Daniel s'est enrôlé dans les Forces armées
canadiennes à Grande Prairie en Alberta. Il s'est entraîné près de
Calgary, puis en Angleterre. Daniel a servi pendant la Seconde Guerre
mondiale avec une équipe de transport au sol. Il a été affecté en
Méditerranée centrale, en Europe du Nord-Ouest et en Hollande à la fin
de la guerre. Il est revenu au Canada en 1946. Il a noué des amitiés à
vie avec plusieurs de ses copains de l'armée, dont Dick Page et Henry
Johnson de la région de Didsbury, et plusieurs autres de partout en
Alberta et au Canada.
Daniel est retourné dans la région de Peace River pour travailler sur le
chemin de fer et la ferme. Là, il a rencontré l'amour de sa vie Claire
Marie Henley. En décembre 1946, ils se sont mariés à Girouxville, en
Alberta. La réception a dû être assez festive car l’édifice a brûlé
après le départ des invités tôt le matin.
Daniel et Claire ont acquis une terre au sud de Girouxville qu'ils ont
défrichée et cultivée jusqu'en 1950, tout en occupant d'autres emplois
pour joindre les deux bouts. En 1947, leur première fille est née,
Marguerite Yvonne. En 1948, leur premier fils est né, Richard Theodore.
La jeune famille demeurait près de Prince George, en
Colombie-Britannique, pour le travail, où leur deuxième fille, Paula
Louise, est née en 1949. Pendant leur séjour en Colombie-Britannique, un
incendie a de nouveau frappé et ils ont perdu de nombreux biens.
Daniel a ensuite trouvé un emploi dans une équipe sismique et la famille
a voyagé avec lui. Ils vivaient dans une petite remorque à la suite de
travaux sismiques en Alberta et en Saskatchewan. En 1953, ils sont
arrivés à Calgary et ont vécu dans le parc à roulottes d'Inglewood, puis
à Sunshine Auto Court, qui fait maintenant partie de Stampede Park. En
1954, Daniel a commencé à travailler pour Postes Canada, où il fut
facteur jusqu'à sa retraite en 1980.
En 1955, la famille emménage dans une toute nouvelle maison à Bowness.
Les enfants avaient de l’espace en masse : 850 pieds carrés, une grosse
différence par rapport à la roulotte. Les enfants ont fréquenté l'école
à Bowness, et Daniel et Claire se sont fait de nombreux nouveaux amis.
Daniel aimait voyager, et la famille a passé de nombreux week-ends sur
la route pour rendre visite à des parents et amis. À la surprise
générale, le quatrième enfant de Daniel et Claire, Paul Louis, est
arrivé en 1966, 17 ans après sa sœur.
Les voyages de Daniel et Claire les ont emmenés en Europe, en Amérique
du Sud et dans les Caraïbes. Après leur retraite en 1980, ils ont passé
plusieurs années à faire des voyages en camping-car à travers le Canada,
les États-Unis et le Mexique. Après que Daniel ait eu 80 ans, les
voyages ont été plus courts, mais ils ont quand même voyagé à travers le
Canada pour rendre visite à des amis et à leur famille.
Daniel était membre de la filiale 238 de la Légion royale canadienne. Il
a passé du temps en tant qu'officier de service et a aidé le Fonds du
coquelicot pendant de nombreuses années. Daniel et Claire étaient des
habitués du Jam du jeudi pour aînés et aimaient faire une danse ou deux.
Ils ont assisté à deux voyages « Merci Canada » en Hollande, où ils ont
été extrêmement bien traités grâce à l’implication de Daniel à la fin et
après la guerre. Daniel et Claire ont vécu dans leur maison de Bowness
jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à emménager dans une résidence de
retraite à l'âge de 97 ans.
Daniel avait un grand amour pour sa famille et ses amis. Il n'était
jamais plus heureux que lorsqu'il jouait avec des enfants. Il aimait
taquiner tous les enfants et ils revenaient tous vers lui. Daniel a fêté
ses 100 ans en octobre dernier, où il a eu le plaisir de rendre visite à
de nombreux amis et à sa famille qui ont voyagé pour profiter d'un
après-midi en son honneur. Daniel était très aimé, et sa mémoire vivra
avec nous pour longtemps.
Daniel a été précédé dans la mort par sa mère Yvonne Dionne, son père Alfred Girouard, deux frères, Charles Girouard et Ted Girouard, sa sœur Jeanne Gendron et ses grands-parents, Ferdinand Dionne et Marie Gagnon. » (Fin du texte cité) La photo appartient à la maison funéraire McInnis & Holloway. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 5340
9 avril 2020
Un père éprouvé
Jusque vers 1950, la mortalité infantile, les accouchements, les
maladies pulmonaires, les épidémies plombaient l’espérance de vie. Je
vous raconte l’histoire d’Alfred Théberge
de
Saint-Mathieu-de-Rioux qui a été durement éprouvé par
des pertes de vie dans sa famille immédiate.
Alfred Théberge
est le fils d’Alexandre-Timothée Théberge et d’Émérence St-Pierre. Il
est né le 26 février 1840. Il épouse en premières noces Arthémise
Bélanger le 24 novembre 1863 et en deuxièmes noces Rose Rousseau le 15
octobre 1878. Cette dernière décède le 13 mai 1940 à l’âge de 88 ans.
Pendant sa vie, Alfred Théberge a perdu sa première épouse, Arthémise
Bélanger. Elle décède le 3 octobre 1867 à l’âge de 23 ans d’une maladie
contagieuse. Elle avait mis au monde son deuxième enfant une semaine
plus tôt, soit le 27 septembre.
Pendant sa vie, Alfred Théberge a perdu 8 de ses 13 enfants. Voici les
noms par ordre chronologique de décès :
Victime 1. Délima. Née le 27 septembre 1867, elle décède le 25 novembre
1867 à l’âge de 2 mois de la même maladie que sa mère Arthémise.
Les victimes suivantes sont les enfants de Rose Rousseau qui a mis au
monde 11 enfants.
Victime 2. Adélard. Né le 28 mai 1880, il décède le 9 mai 1881 à l’âge
de presqu’un an.
Victime 3. Un autre Adélard. Né le 13 juillet 1881, il décède le 7
septembre 1882 à l’âge d’un an et 2 mois.
Victime 4. Hermel Alfred. Né le 25 mars 1888, il décède le 3 décembre
1889 à l’âge d’un an et 8 mois.
Victime 5. Éva. Née le 26 août 1894, elle décède le 10 février 1901 à
l’âge de 6 ans et 6 mois.
Victime 6. Émilie. Née le 4 septembre 1892, elle décède le 12 mai 1915 à
l’âge de 22 ans. Elle était institutrice.
Victime 7. Aurore. Née le 8 mars 1891, elle épouse Cyprien Plourde le 1e
juillet 1913. Elle décède le 12 novembre 1918 de la grippe espagnole à
l’âge de 27 ans. Elle a mis au monde un enfant anonyme la veille de sa
mort. Elle avait perdu un autre enfant anonyme le 29 septembre 1917.
Victime 8. Rose. Née le 15 novembre 1883, elle épouse Thomas Ouellet le
25 janvier 1905. Elle décède le 8 janvier 1920 à l’âge de 36 ans après
avoir mis au monde 9 enfants.
Quand Alfred Théberge décède le 9 août 1924 à l’âge de 84 ans, il ne reste plus que cinq de ses enfants sur 13 pour pleurer sa perte. Ce sont : Clémentine, Émile, Désiré, Laura, une ancienne institutrice, et Corine. Cette dernière, une institutrice, décède le 6 septembre 1924 à l’âge de 39 ans, moins d’un mois après son père. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour | Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres textes sur Saint-Mathieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
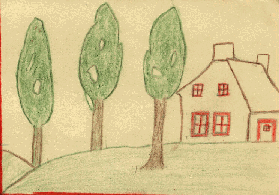
 Trois
candidates participèrent au concours de popularité : Mlles Gabrielle
Gaudreau, Yvonne Ouellet et Rachel Théberge. C’est Mlle Rachel
Théberge qui fut proclamée Reine du Carnaval, au soir du 21 février,
lors d’une soirée récréative à la salle paroissiale. Le billet
choisi par le jeune Normand Ouellet désigna Mlle Théberge au titre
de souveraine 1960.
Trois
candidates participèrent au concours de popularité : Mlles Gabrielle
Gaudreau, Yvonne Ouellet et Rachel Théberge. C’est Mlle Rachel
Théberge qui fut proclamée Reine du Carnaval, au soir du 21 février,
lors d’une soirée récréative à la salle paroissiale. Le billet
choisi par le jeune Normand Ouellet désigna Mlle Théberge au titre
de souveraine 1960. 
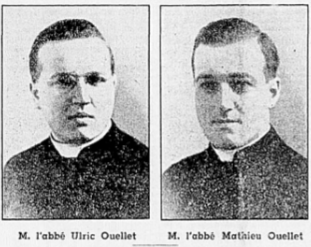 Dimanche
matin, en la chapelle du Séminaire, Son Excellence Mgr Georges
Courchesne, archevêque de Rimouski, conférait le sacrement de l’Ordre à
MM. les abbés Mathieu Ouellet et Ulric Ouellet, les deux frères,
originaires de Saint-Mathieu. Le 11 octobre 1942, à Saint-Mathieu, Son
Exc. Mgr Courchesne avait élevé à la prêtrise leur frère, M. l’abbé
Paul-Émile Ouellet qui étudie maintenant la théologie dogmatique et
morale au Collège Canadien de Rome où il séjournera deux ans.
Dimanche
matin, en la chapelle du Séminaire, Son Excellence Mgr Georges
Courchesne, archevêque de Rimouski, conférait le sacrement de l’Ordre à
MM. les abbés Mathieu Ouellet et Ulric Ouellet, les deux frères,
originaires de Saint-Mathieu. Le 11 octobre 1942, à Saint-Mathieu, Son
Exc. Mgr Courchesne avait élevé à la prêtrise leur frère, M. l’abbé
Paul-Émile Ouellet qui étudie maintenant la théologie dogmatique et
morale au Collège Canadien de Rome où il séjournera deux ans.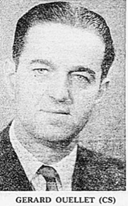 Mais
on a vite senti un remous dans l'opinion publique quand on a appris que
les deux candidats, dits indépendants, portaient également le nom du
candidat officiel du Crédit Social, M. Gérard Ouellet. Les observateurs
ont vu, dans cette manœuvre, une tactique pour créer de la confusion
parmi les électeurs et diviser les votes.
Mais
on a vite senti un remous dans l'opinion publique quand on a appris que
les deux candidats, dits indépendants, portaient également le nom du
candidat officiel du Crédit Social, M. Gérard Ouellet. Les observateurs
ont vu, dans cette manœuvre, une tactique pour créer de la confusion
parmi les électeurs et diviser les votes.  St-Mathieu est, cette année encore, candidat officiel du Crédit Social.
Les porte-étendards NPD et PC en sont à leur première tentative
électorale. » (Fin du texte cité)
St-Mathieu est, cette année encore, candidat officiel du Crédit Social.
Les porte-étendards NPD et PC en sont à leur première tentative
électorale. » (Fin du texte cité)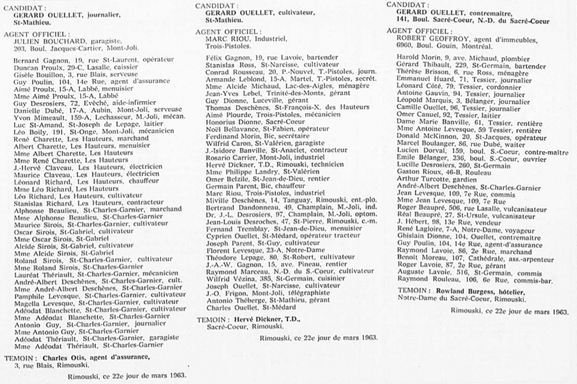
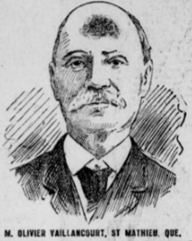 Depuis
des mois je souffrais d’une maladie de vessie, de rétention d’urine,
qu’aucun remède n’avait pu soulager. Le seul succès qu’un médecin avait
pu obtenir, c’était en se servant d’un instrument. Mais l'opération
était toujours à répéter, c’était ennuyeux. J’écrivis donc aux Médecins
de la Compagnie Médicale Moro, je reçus d’eux une foule de bons
conseils, je pris les Pilules Moro et, après deux mois de traitement,
j’étais guéri. Tous mes remerciements à ces bons médecins. »
Depuis
des mois je souffrais d’une maladie de vessie, de rétention d’urine,
qu’aucun remède n’avait pu soulager. Le seul succès qu’un médecin avait
pu obtenir, c’était en se servant d’un instrument. Mais l'opération
était toujours à répéter, c’était ennuyeux. J’écrivis donc aux Médecins
de la Compagnie Médicale Moro, je reçus d’eux une foule de bons
conseils, je pris les Pilules Moro et, après deux mois de traitement,
j’étais guéri. Tous mes remerciements à ces bons médecins. »
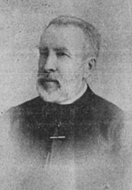 Après son ordination, l’abbé Béland
(photo* ci-contre) est vicaire à Carleton, puis curé de
Sainte-Julie-de-Laurierville. Il arrive dans cette paroisse dont il est
le premier curé en octobre 1854. L’église n’est pas encore terminée et
le presbytère sert de chapelle. Aussi, il est hébergé par un M. Roberge.
Après son ordination, l’abbé Béland
(photo* ci-contre) est vicaire à Carleton, puis curé de
Sainte-Julie-de-Laurierville. Il arrive dans cette paroisse dont il est
le premier curé en octobre 1854. L’église n’est pas encore terminée et
le presbytère sert de chapelle. Aussi, il est hébergé par un M. Roberge.


 Daniel
est demeuré au Québec pour être élevé par ses grands-parents maternels,
Ferdinand Dionne et Marie Gagnon. Ceux-ci ayant élevé une famille
nombreuse (8 enfants), ils ont donné à Daniel la possibilité de grandir
avec des oncles et des tantes, certains presque de son âge. Daniel a
grandi sur la ferme familiale et a vécu une enfance heureuse et aimante.
Le premier jour d'école où l'enseignante faisait l’appel des noms, elle
a dit « Daniel Girouard », personne n'a répondu. Elle a de nouveau
appelé le nom, a montré Daniel et a dit : « C'est toi ? » Daniel secoua
la tête, il dit : « Non, je m'appelle Daniel Dionne. » Quand il est
rentré chez lui, il a dit à sa grand-mère : « Cette maîtresse est folle,
elle a dit que je m'appelle Girouard ! »
Daniel
est demeuré au Québec pour être élevé par ses grands-parents maternels,
Ferdinand Dionne et Marie Gagnon. Ceux-ci ayant élevé une famille
nombreuse (8 enfants), ils ont donné à Daniel la possibilité de grandir
avec des oncles et des tantes, certains presque de son âge. Daniel a
grandi sur la ferme familiale et a vécu une enfance heureuse et aimante.
Le premier jour d'école où l'enseignante faisait l’appel des noms, elle
a dit « Daniel Girouard », personne n'a répondu. Elle a de nouveau
appelé le nom, a montré Daniel et a dit : « C'est toi ? » Daniel secoua
la tête, il dit : « Non, je m'appelle Daniel Dionne. » Quand il est
rentré chez lui, il a dit à sa grand-mère : « Cette maîtresse est folle,
elle a dit que je m'appelle Girouard ! »