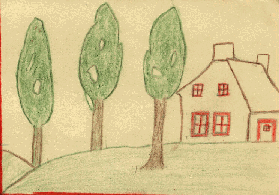|
(Dessin réalisé au primaire) Contactez-moi : cejean@charleries.net |
Les charleries Bienvenue sur mon blogue, Ce blogue contient des souvenirs, des anecdotes, des opinions, de la fiction, des bribes d’histoire, des récréations et des documents d’archives. Charles-É. Jean
|
|
Faits anciens |
|
|
# 6225
15 janvier 2022
Double
meurtre à Trois-Pistoles
Dans son édition du 29 juillet 1949, le Progrès du Golfe, un
hebdomadaire de Rimouski, rapporte que deux citoyens de
Trois-Pistoles ont été victimes de meurtre :
« Maurice Lebel, camionneur de 28 ans, de St-Guy, a été pendu à la
prison de Bordeaux, de bonne heure vendredi matin 22 juillet, pour
le double meurtre à coups de bouteille de bière de deux citoyens de
Trois-Pistoles, le 1er juillet 1948.
Le nœud coulant a été passé au cou de Lebel un peu après minuit, et
vers minuit et demi le Dr Roméo Plouffe, médecin de la prison,
constatait la mort.
Une atmosphère de secret a entouré la pendaison et les officiels de
la prison ont nettement refusé de donner des explications.
La nouvelle de la pendaison a transpiré seulement après que des
citoyens des environs de la prison eurent téléphoné à un journal de
Montréal pour demander pourquoi l’on avait sonné six coups au
beffroi de la prison.
La date de l’exécution avait été fixée d’abord au 6 juillet et
aucune explication n’a été donnée sur le sursis de 16 jours accordé
à Lebel.
Maurice Lebel a été trouvé coupable, en février dernier, de
l’assassinat du gérant de banque Louis-Philippe Breton et du
chauffeur de taxi Wilfrid Dumais, tous deux de Trois-Pistoles.
Les cadavres furent retrouvés sur la route de St-Modeste, au soir
de la fête de la Confédération, l’an dernier.
Les témoins au procès de Lebel ont déclaré que trois billets
promissoires au nom de Lebel étaient dus le 2 Juillet. Breton avait
apporté sur lui les billets, au total de 4900 $, de la Banque
Canadienne Nationale à Trois-Pistoles, dont iI était le gérant, le
jour où il fut tué. On a trouvé les billets sur le cadavre.
Une bouteille de bière qui avait servi au meurtre des deux hommes a été trouvée près des lieux du crime. » |
|
|
# 6195
27 décembre 2021
Écho d'une première communion
Dans son édition du 26 janvier
1923, le journal Le Peuple publié à Montmagny relate comment
la première communion d’une trentaine d’enfants s’est déroulée.
« Ici-bas, les jours se
suivent, mais ne se ressemblent pas ! Il y en a de joyeux, de
douloureux, mais le plus beau de tous, nous a-t-on toujours dit, est
celui de notre première Communion.
C’est donc en ce beau jour du
trente décembre (samedi) que notre Bon Pasteur admettait à la table
sainte une trentaine d'enfants bien préparés à l’avance par ses
sages conseils et ses pieuses exhortations.
Quel bonheur ! quels
ravissements ! pour ces jeunes enfants, de se voir réunis dans le
temple divin aux accords et aux chants harmonieux d’une messe
solennelle célébrée par M. le Curé qui leur fit encore une touchante
et pieuse allocution durant le saint sacrifice.
Enfin le moment sublime
arriva, tous de s'approcher fervents et recueillis à la table de
communion pour s'unir à Jésus qui a dit : « Laissez venir à moi les
petits enfants, car le royaume des Cieux est à eux ». Quelle idée
ineffable de posséder Jésus dans leur cœur pour la première fois ;
son amour, sa reconnaissance, de l’adorer comme les chérubins du
tabernacle qui n’ont jamais eu un aussi grand bonheur !
Colloque intime d'action de
grâce qui inonde de bénédictions ces jeunes âmes privilégiées. Tous
furent ensuite reçus du scapulaire, heureux de porter la livrée de
Marie Immaculée, Protectrice des âmes pures et virginales !
À l'issue de ces touchantes
cérémonies, M. le Curé invita ses chers petits communiants, à se
rendre à la sacristie, où une surprise les attendait. Quel ne fut
pas leur étonnement d’apercevoir un bel arbre de Noël chargé de
jouets et de friandises de toutes sortes ; et M. le Curé toujours
dévoué et compatissant de distribuer à ses chers petits enfants,
secondé par M. le Vicaire, les jouets, bonbons et friandises, qui
font tant plaisir aux petits.
Puis les bonnes Sœurs, de servir le café réconfortant et les biscuits succulents à ces chers petits enfants, la plupart venus de très loin par un froid excessif. Au contact de tant de bonté et de dévouement, ces jeunes enfants, retournèrent chez leurs parents, emportant dans leur cœur un éternel souvenir de cette journée mémorable. » |
|
|
# 6165
9 décembre 2021
Drame chez un ouvrier
Dans son édition du 26 janvier 1923, le journal Le Peuple
raconte un fait dramatique qui se passe chez un ouvrier irlandais :
« Dans toute l’histoire de la
guerre civile en Irlande, pas une tragédie n’a égalé l'incident qui
s’est produit à Galway, samedi dernier. Un ouvrier avait vendu au
marché de Portumna une portée de cochons qui lui avait rapporté
quarante louis sterling.
Le même soir, quatre bandits
masqués entrèrent dans sa demeure et lui ordonnèrent, au péril de sa
vie, de leur remettre le produit de sa vente. En tremblant, il leur
céda son argent et les hommes se retirèrent. Comme le dernier bandit
franchissait la porte, le plus jeune fils de l’ouvrier saisit une
hache et lui en asséna un violent coup qui l’étendit mort sur le
plancher. Ses compagnons s’enfuirent à la course.
L’un des membres de la famille s’approcha alors du cadavre et lui enleva son masque. Quelle ne fut pas sa surprise de reconnaître dans le bandit mis à mort le deuxième fils de l’ouvrier. » |
|
|
# 6135
21 novembre 2021
Un bateau échoue
Dans son édition du 15 juillet
1835, le journal
L’Ami du peuple, de l’ordre et des lois
publié à Montréal raconte un événement qui aurait pu mal tourner :
« Un tumulte considérable a eu
lieu sur le port de cette ville, dimanche matin. Il parait que
plusieurs centaines d'Irlandais s'étaient embarqués à Québec sur un
bateau à vapeur, connu sous le nom de
La
Félicité et
depuis longtemps célèbre par sa lenteur et son triste état.
Le capitaine avait reçu une
partie de l'argent par avance, promettant de conduire ses passagers
à Montréal en un temps donné. Faute de soins ou par accident, le
bâtiment échoua près des Trois-Rivières. Les passagers furent
obligés de s’embarquer à bord de l’Aigle et le capitaine refusa de
leur rendre leur argent.
Ces Irlandais, étant arrivés à
Montréal, rencontrèrent, dit-on, M. De Selles qu’on leur désigna
comme le propriétaire du bâtiment. Ils se saisirent de lui et
voulurent le forcer à regorger.
La société de St-Patrick est intervenue, leur a remboursé leurs fonds et s’est chargée de faire le recouvrement de l'argent. Cette conduite de la société de St-Patrick mérite de grands éloges. » |
|
|
# 6105
3 novembre 2021
Autres temps, autres mœurs
Dans son édition du 5 mai 1817, L’Aurore, un journal de
Montréal, relate un événement qui s’est produit en Italie. Le titre
de l’article est
Fanatisme religieux en Sicile.
« Nous avons tous été témoins d‘un événement qui aurait pu produire
des conséquences fatales. Le 10 février, le ciboire avec les hosties
fut enlevé de l‘église de St-Auforne. Toute la ville fut en
mouvement et le peuple fit fermer les portes. Ni cafés ni boutiques,
ni théâtres ne furent laissés ouverts.
Les processions remplirent les rues et toutes les cloches sonnèrent.
La populace obligea le vieil archevêque infirme d'accompagner les
processions ; mais il eut enfin le bonheur de
s‘échapper dans un couvent.
Le peuple était absolument furieux. Il parcourut les rues avec des
torches, menaçant de mettre le feu aux maisons des incrédules. Il
commit mille extravagances qui se seraient terminées d'une manière
qu'il n‘est pas possible de deviner, si quelques individus de la
municipalité n’avaient faire courir le bruit que le
ciboire avait été retrouvé.
Toute la population
s‘écria : NOSTRO SIGNORE HA E TROVATO (Notre Seigneur a été trouvé),
et chacun s‘en retourna chez lui. Le
lendemain quand la fausseté du rapport fut connue, le peuple
qui paraissait vouloir recommencer les scènes de la veille fut tenu
en respect par la présence des troupes de ligne et de la milice qui
avaient été assemblées à cet effet.
Cependant les processions se font tous les jours, et l'on n’ouvrit ni les tribunaux, ni les boutiques, ni travailler dans le port. Les soldats même ont couvert leurs armes de crêpes. Une lettre d’une date plus récente annonce que le ciboire a été réellement retrouvé, et que la tranquillité est parfaitement rétablie. » |
|
|
# 6075
15 octobre 2021
Une tentative de meurtre
Le Progrès du Golfe du
24 août 1917 raconte les démêlés en justice d’un citoyen de
Mont-Joli qui refuse de croupir en prison.
« Lydius Ross, ancien cocher
et commerçant domicilié à Rimouski, bien connu dans tout le
district, a été arrêté dimanche matin pour avoir tenté d'assassiner
son épouse, qui travaillait comme fille de table à l’hôtel Sirois de
Mont-Joli. Ross a essayé de perpétrer son odieux forfait en arrivant
de Montréal, dimanche matin. Nous passerons sous silence, par
respect pour la victime elle-même et pour la famille du coupable,
les détails révoltants et cyniques de cet affreux attentat sur une
pauvre femme inoffensive et sans défense par son mari brutal et
dévoyé.
Ross ne réussit pas dans la
réalisation de son monstrueux dessein. Les coups du révolver dont il
appuya la pointe sur le cœur de son épouse ne ratèrent pas, mais les
balles trop petites pour le calibre de l’arme, demeurèrent
presqu’inertes : elles n’effleurèrent que mollement la poitrine la
victime.
Ross fut bientôt appréhendé et
réduit à l’impuissance par un des fils de M. Sirois ; mis sous
arrêt, il fut conduit immédiatement sous bonne garde à la prison de
Rimouski où il fut écroué pour attendre son procès.
Deux jours après, de bonne
heure mardi matin, une nouvelle sensationnelle se répandait dans la
ville et les environs. Ross s’était évadé de la prison ! Comment y
avait-il réussi ? C’est ce que l’on ignorait et ce que le public
ignore encore. On s’accorde sur un point. Ross s’est sauvé par les
portes, et non par les fenêtres ou au travers des murs. La porte du
cachot était donc ouverte au moment de l’évasion, à moins que ce ne
soit Ross qui l’ait ouverte lui-même au moyen de ce qu’on a prétendu
être un fil de fer quelconque.
Et maintenant voici ce qui se
passa lorsque la nouvelle de cette désertion de Ross eut été
communiquée au shérif Charles D’Anjou.
Le shérif convoqua
immédiatement à son bureau le grand connétable R. Réhel, le chef de
police (de Rimouski), Michel Pineau et le chef détective J. C.
Gauvreau pour se concerter avec eux sur les moyens à prendre pour
rechercher efficacement et découvrir prestement le prisonnier évadé.
Chacun de ces policiers se chargea d'un territoire à fouiller et à
surveiller avec chacun une équipe de bons hommes pour organiser un
service de signalement et de perquisitions minutieuses.
Vers 6 heures du soir, M.
François Gagnon, de cette ville, entrepreneur de chantiers, qui
connaît bien les forêts et les sentiers qui les sillonnent le long
de la rivière Rimouski, et que le shérif avait spécialement chargé
de perquisitions dans cette direction, informait M. Charles D’Anjou
que le déserteur venait de lui être signalé au moulin de Joseph
Banville, ancienne propriété d’Adélard Pineau, dans St-Léon.
Sans retarder, le shérif
dépêcha sur-le-champ vers Ste-Blandine une Overland conduite
par le chauffeur G. A. Morin et chargée de quatre limiers armés
jusqu’aux dents afin d’aller prêter main-forte au détective Gauvreau
qui poursuivait ses perquisitions, en compagnie de M. Émile Gagnon,
dans les bois du Fond d’Ormes en arrière de St-Narcisse, que Ross
connaissait et où il devait être enclin à se réfugier pour la nuit.
En effet, c’est à quelque part
par-là que Ross devait tomber entre les mains de la justice. À la
nuit tombante, le déserteur arrivait à un « campe » situé à quelques
arpents de la demeure de François Lizotte, qu’il croyait inhabité et
qui par malheur, était en ce moment occupé par la famille de M.
Louis Pineau. Celui-ci était absent de sa maison.
Madame Pineau causa quelque
temps avec l'évadé et s'apprêta sur sa demande à lui préparer à
souper. Pendant ce temps, un garçonnet de Madame Pineau, qui avait
été mis au courant de l'affaire au cours de la journée, fïlait chez
François Lizotte, et lui rapportait que Ross était à la maison,
attendant pour souper. M. Lizotte, un rude colon qui n'a pas froid
aux yeux, s’empressa d’accourir, en compagnie d'un M. Canuel, au
"campe" où il trouva en effet Lydius Ross que, malgré ses
supplications et ses menaces, il mit dans l'impossibilité de
s’enfuir en le garrotant solidement, de manière à pouvoir attendre
désormais l’arrivée du détective Gauvreau et de son compagnon, qui,
de fait, arrivèrent bientôt après.
Le prévenu, que tout le monde,
dans les bois et campagnes des environs de Rimouski, redoutait comme
un fauve féroce prêt à tout faire pour se défendre et se sauver, fut
donc de nouveau, et sans beaucoup de résistance, livré à la justice
qui cette fois le tient sous bonne garde et ne s’en dessaisira que
pour l’expédier au bagne où il expiera sans doute le ou les crimes
dont il s’est rendu coupable et que l’enquête préliminaire devrait
révéler.
On se rappelle que Ross fut
impliqué l’automne dernier dans une sombre affaire d’incendiat au
cours de laquelle il fut accusé et arrêté ; cette affaire sera
probablement réveillée à la suite des événements qui viennent de se
passer et dont Ross a été le sinistre et principal artisan.
Nous nous réjouissons sincèrement de la capture de ce criminel déserteur et nous félicitons avec plaisir le shérif de Rimouski et tous ceux qui l'ont assisté dans l’organisation adroite qui a favorisé la reprise rapide de ce triste personnage dont le maintien en liberté était devenu un danger pour sa famille et la société. » (Fin du texte cité) |
|
|
# 6005 3 septembre 2021
Un complice
religieux
Le Courrier de Québec, dans son édition du 5 octobre 1808,
raconte l’histoire d’un voleur qui s’évade.
« Je me trouvai l’année passée à la campagne, avec un bon Religieux qui
a plus de quatre-vingts ans et voici ce qu’il me raconta.
Il fut demandé, il y a quarante ans, pour disposer à la mort un voleur
de grand chemin. On l’enferma avec le patient dans une petite chapelle.
Pendant qu’il faisait des efforts pour l'exciter au repentir de son
crime, il s’aperçut que cet homme était distrait et l'écoutait à peine.
Mon cher ami, lui dit-il, pensez-vous que dans quelques heures il faudra
paraître devant Dieu et qui peut vous distraire d’une affaire pour vous
de si grande importance ? Vous avez raison, mon père, lui dit le patient
; mais je ne puis m’ôter de l’esprit qu’il ne tiendrait qu’à vous de me
sauver la vie ; et une telle pensée est bien capable de me donner des
distractions.
Comment m’y prendrais-je pour vous sauver la vie, répondit le Religieux
? Et quand cela serait en mon pouvoir, pourrais-je hasarder de le faire
et vous donner par-là occasion d’accumuler vos crimes. S'il n’y a que
cela qui vous arrête, répondit le patient, vous pouvez compter sur ma
parole : j’ai vu le supplice de trop près pour m’y exposer de nouveau.
Le Religieux fit ce que nous eussions fait vous et moi, en pareille
occasion, il se laissa attendrir, et il ne fut plus question que de
savoir comment il faudrait s’y prendre. La chapelle où ils étaient
n’était éclairée que par une fenêtre qui était proche du toit, et élevée
de plus de quinze pieds. Vous n'avez, dit le criminel, qu’à mettre votre
chaise sur l’autel, que nous pouvons transporter au pied du mur ; vous
monterez sur la chaise, et moi sur vos épaules, d’où je pourrai gagner
le toit.
Le Religieux se prêta à cette manœuvre, et resta ensuite tranquillement
sur la chaise, après avoir remis à sa place l’autel qui était portatif.
Au bout de trois heures, le bourreau qui s’impatientait frappa à la
porte, et demanda au Religieux ce qu'était devenu le criminel. Il faut
que ce soit un ange, répondit froidement le Religieux, car foi de
Prêtre, il est sorti par cette fenêtre.
Le bourreau qui perdait à ce compte, après avoir demandé au Religieux
s’il se moquait de lui, courut avertir les juges : ils se transportèrent
à la chapelle, où notre homme assis, leur montrant la fenêtre, les
assura en conscience que le patient s’était envolé par-là, et que peu
s’en était fallu qu’il ne le recommandât à lui, le prenant pour un ange
; qu'au surplus si c’était un criminel, ce qu’il ne comprenait pas,
après ce qu’il lui avait vu faire, il n’était pas fait pour en être le
gardien. Les Magistrats ne purent conserver leur gravité vis-à-vis du
sang froid de ce bon homme : et ayant souhaité un bon voyage au patient,
se retirèrent.
Vingt ans après ce Religieux passant par les Ardennes, se trouva égaré
dans le temps que le jour finissait ; une façon de paysan l’avant
examiné fort attentivement, lui demanda où il voulait aller, et l’assura
que la route qu'il allait prendre était fort dangereuse ; il ajouta que
s’il voulait le suivre, il le mènerait dans une ferme qui n’était pas
fort éloignée, où il pourrait passer fort tranquillement la nuit. Le
Religieux se trouva fort embarrassé ; la curiosité avec laquelle cet
homme l’avait regardé lui donna des soupçons ; mais considérant que s’il
avait quelque mauvais dessein, il ne lui serait possible d’échapper de
ses mains, il le suivit en tremblant.
Sa peur ne fut pas de longue durée, il aperçut la ferme dont le paysan
lui avait parlé ; et cet homme qui en était le maitre, dit, en entrant,
à sa femme, de tuer un chapon avec les meilleurs poulets de la
basse-cour, et de bien régaler son hôte. Pendant qu’on préparait le
souper, le paysan rentra suivi de huit enfants, à qui il dit : Mes
enfants, remerciez ce bon Religieux ; sans lui vous ne seriez pas au
monde, ni moi non plus ; il m’a sauvé la vie.
Le Religieux se rappela alors tous les traits de cet homme, et reconnut
le voleur duquel il avait favorisé l’évasion. Il fut accablé des
caresses et des actions de grâces de la famille ; et lorsqu’il fut seul
avec cet homme, il lui demanda par quel hasard il se trouvait si ben
établi. Je vous ai tenu ma parole, lui dit le voleur, et déterminé à
vivre en honnête homme, je vins en demandant l’aumône jusqu'à ce lieu
qui est celui de ma naissance. J’entrai au service du maître de cette
ferme, et ayant gagné les bonnes grâces de mon maitre par ma fidélité et
mon attachement il me fit épouser sa fille qui était unique. Dieu a béni
les efforts que j’ai fait pour être homme de bien ; j'ai amassé quelque
chose, vous pouvez disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, et je
mourrai content à présent que je vous ai vu, et que je puis vous prouver
ma reconnaissance.
Le Religieux lui dit, qu’il était trop payé du service qu’il Iui avait
rendu, puisqu’il faisait un si bon usage de la vie qu’il lui avait
conservée : il ne voulut rien accepter de ce qu’on lui offrait, mais il
ne put jamais refuser au paysan de rester quelques jours chez lui où il
fut traité comme un prince. Ensuite ce bon homme le força de se servir
au moins d'un de ses chevaux pour achever sa route, et ne voulut point
le quitter qu’il ne fut sorti des chemins dangereux, qui sont en grand
nombre dans ces quartiers. » |
|
|
# 5985
9 juin 2021
Drame familial
Dans son édition du 21 octobre 1871, le journal La Minerve,
publie l’histoire d’un cultivateur de la paroisse Saint-Germain de
Rimouski qui a voulu empoisonner sa femme. Voici ce qu’on peut y lire :
« La Cour Criminelle siégeant à Rimouski sous la présidence du
juge Casault vient de juger une affaire d'empoisonnement qui s'est
terminée par la condamnation de l'accusé à la peine capitale.
Voici les faits : Dans le mois d'août, Hubert Banville.
cultivateur, demeurant à un mille de Rimouski, a empoisonné sa femme
(Marie Lepage) en mettant dans son thé de l'arsenic qu'il avait acheté
sous prétexte de tuer des rats. Comme il mettait chaque fois la dose
trop faible, la pauvre femme a été malade durant une dizaine de jours.
Sa nièce qui la soignait, ayant goûté au thé s'est trouvée
indisposée. Cela fut pour la femme un trait de lumière et elle s’écria :
« Ma pauvre enfant, nous sommes empoisonnées par mon mari. Pour moi, je
sens que tout espoir de me sauver est perdu ; mais pour toi, il est
encore temps, cours au village voir le médecin. » Elle avait raison,
elle a succombé un jour ou deux après, et la nièce en a été quitte pour
une indisposition.
Le but de Banville était d'épouser une jeune fille qu'il avait
déjà tenté d'enlever. L'exécution aura lieu le 9 décembre prochain. »
(Fin du texte cité)
Le journal se trompe en affirmant que la dame a succombé à
l’empoisonnement. Elle s’est rétablie.
Dans son mémoire de maîtrise, en avril 2016, Stéphanie
Courtemanche étudie ce cas. Elle indique que, malgré les faits reprochés
et prouvés, Marie Lepage croit que son mari ne méritait pas la peine de
mort. Elle écrit :
« Dans sa
requête qu’elle fait parvenir au gouverneur général du Canada, Marie
Lepage s’exprime dans ces termes : […] Qu’elle est l’épouse affligée de
l’infortuné Hubert Banville [...] Que son rétablissement a déjà été
compromis par la fatigue et l’affliction qu’elle a éprouvées pendant le
procès et surtout lors de la condamnation de son malheureux époux […]
Que depuis sa condamnation, son malheureux époux a montré les meilleurs
sentiments à son égard, donné des marques non équivoques de repentir,
s’est vivement inquiété du bien-être de sa famille et a cherché à y
pourvoir avec tout le soin possible. »
Elle continue
en disant : « Il est clairement démontré que l’épouse affligée subissait
la maltraitance de son mari, Hubert Bainville, qui s’enivrait facilement
: « Pars, pars si tu veux et ce sur un ton indifférent, il sacrait
contre elle et il disait qu’il voulait se débarrasser d’elle. […] En lui
parlant, il sacrait plus qu’il était de bonne humeur ». Malgré cela,
elle défend son mari. »
Finalement, la sentence d’exécution a été commuée en prison à perpétuité. |
|
|
# 5960
24 mai 2021
La justice au 19e siècle
Au
cours des années, la nature des crimes a grandement évolué. En même
temps, les condamnations ont été plus adaptées aux infractions. Par
exemple, au début du 19e siècle, le larcin qui
est un petit vol sans effraction et sans violence
était fortement réprimé. Si de plus le larcin se faisait à l’intérieur
d’une maison, sa gravité était augmentée.
Le présent texte contient le nom de personnes reconnues coupables d’un
crime et leur sanction. Cela se passait à Montréal en 1813 et 1815.
1. Terme criminel de 1813 : journal Le spectateur du 16
septembre 1813
-
Joseph et Étienne Dumas, convaincus de discours séditieux, condamnés à 2
ans de prison, à 10 louis d'amende, à donner caution eux-mêmes pour 50
louis, et à trouver des suretés pour pareille somme pendant l’espace de
7 ans.
-
Amable Legault dit Deslauriers, convaincu de parjure, et condamné à être
confiné un an en prison et à payer 50 livres sterlings d’amendes.
-
James Hetherson et James McDonald, convaincus d'avoir volé dans une
maison pour la valeur de 19 shelings (1 livre = 20 shelings), condamnés
à être renfermés un an dans la maison de correction.
-
Ann Firzgibbon, convaincue d’avoir volé pour la valeur de 5 livres, mais
non dans une maison, condamnée à être enfermée six mois dans la maison
de correction.
-
Paul Dufresne, convaincu d'avoir volé pour moins de 20 shelings,
condamné à recevoir 39 coups de fouet, le 17 du courant.
-
Étienne Vaudry, convaincu de grand larcin, ayant volé un bœuf, condamné
à être pendu le 15 octobre prochain.
-
Benjamin Clément, convaincu de grand larcin pour vol d'une vache,
condamné à être pendu le 15 octobre prochain.
-
Joseph Montreuil, convaincu de grand larcin pour vol d’un cheval,
condamné à être pendu le même jour.
-
Pierre Victoire Racicot, convaincu de viol, condamné à être pendu aussi
le 15 octobre prochain.
2. Terme criminel de 1815 : journal Le spectateur canadien du 11
septembre 1815
-
Jean Raymond convaincu de petit larcin à la valeur de dix-neuf chelins
(shelings) a été condamné à recevoir trente-neuf coups de fouet de la
main du bourreau, vendredi le 15 du courant, et être confiné dans la
maison de correction pour l'espace de six mois de calendrier.
-
André Latulippe, convaincu de petit larcin, condamné à la même peine et
de plus à douze mois de maison de correction.
-
Louis Fortin, convaincu de vol de cheval, a été condamné à être pendu le
6 octobre prochain.
-
Henry Léopard, convaincu de larcin de la valeur de dix chelins, a été
condamné à recevoir 39 coups de fouet de la main du bourreau, vendredi
le 15 du courant, et à passer douze mois dans la maison de correction,
employé aux travaux les plus durs.
-
John Syrie Wilson, convaincu d'avoir volé dans un magasin, condamné à
être pendu le 6 octobre prochain.
-
George Cross, convaincu d‘un vol de maison, condamné à être pendu le 6
octobre prochain.
-
Isidore Roy, convaincu du même crime, condamné à la même peine.
-
François Berteau, convaincu d’assaut, avec intention de meurtre,
condamné à payer une amende de 20 livres et à passer deux années dans la
maison de correction pour y être employé aux travaux les plus durs, et à
l‘expiration de ces deux années à donner caution pour sa bonne conduite,
l'espace de trois années, 100 livres pour lui-même et 50 livres pour
chaque caution.
-
John Quin, convaincu de petit larcin, condamné à recevoir vendredi
prochain 39 coups de fouet de la main du bourreau, et à passer douze
mois dans la maison de correction employé aux travaux les plus durs.
- Jean-Bte Robillard, convaincu de vol de cheval, condamné à être pendu le 6 octobre prochain. |
|
|
# 5930
6 mai 2021
Référendum à
Rimouski
En 1878, le gouvernement fédéral promulgue l'interdiction de l'alcool,
mais en réfère l'application aux municipalités qui doivent approuver
ladite loi par référendum. À Rimouski, en 1912, des propriétaires
d’hôtel veulent obtenir un permis de vente d’alcool. La municipalité se
voit alors obligé d’aller en référendum. Voici ce que rapporte le
Progrès du Golfe, dans son
édition du 25 octobre 1912 :
« Mercredi
dernier, les électeurs municipaux de notre ville étaient appelés à voter
un règlement de prohibition des buvettes dans les limites de cette
municipalité. La votation eut lieu à la salle du Conseil de ville sous
la présidence de M. le notaire L.-de-Gonzague Belzile, ancien maire, qui
fut choisi à l’unanimité de l’assemblée pour présider en l’absence du
maire.
À 9 h de
l’avant-midi, une messe solennelle était chantée à la cathédrale. Une
foule de pieux fidèles y assistaient. Cette grand-messe était chantée en
vue d’obtenir le succès final de la prohibition par l’adoption du
règlement. Après la messe, M. l’abbé Sauvageau, missionnaire diocésain
de Québec, qui avait prêché un triduum de tempérance dans les jours
précédents, avec beaucoup d’éloquence apostolique, fit une vigoureuse
harangue du haut de la chaire en faveur de la tempérance et de la
prohibition.
Et c’est
ensuite qu’une cinquantaine d’électeurs, ayant avec eux leur curé M.
l’abbé Pelletier, se rendirent à la salle du Conseil où ils
enregistrèrent les premiers leurs votes en faveur du règlement. Le
premier vote qui fut donné fut celui de Mgr Majorique Bolduc dont
l’exemple fut aussitôt imité par 51 des principaux citoyens de Rimouski.
Sur 159 votes
qui furent donnés pendant la journée, 22 seulement furent contre le
règlement, les 135 autres étant favorables à la prohibition. Douze
électrices vinrent voter. Toutes, elles se sont déclarées en faveur de
la prohibition et du règlement.
La prohibition
est donc établie en notre ville. Nous nous en réjouissons sincèrement. »
(Fin du texte cité)
On aura
remarqué comment le clergé intervient sans gêne dans les décisions
civiles. Par ailleurs, il semble bien que le vote se soit fait à main
levée. Cela a dû constituer une énorme pression sur la prise de décision
de certains citoyens. Toutefois, le prochain texte qui a paru dans le
même numéro du journal montre bien que la contrebande d’alcool est
présente dans la région. Voici ce texte :
« M. le
magistrat Garon a rendu cet après-midi plusieurs jugements dans les
causes intentées par le Département du Revenu contre des particuliers
poursuivis pour avoir vendu, en contravention avec la loi des licences,
des bières dites de tempérance.
Trois actions
(sur 8) ont été maintenues : celles intentées contre Michel Gagnon, de
Ste-Flavie, condamné (2e offense) à 100 $ d’amende ; contre
Ant. Castonguay, de Rimouski et Ernest Lavoie, de Pointe-au-Père,
condamnés l’un et l’autre à 50 $ d’amende.
M. le juge a considéré comme, étant prohibée par la loi la vente des bières de tempérance ayant plus de 2,5 % d’alcool en volume ; celles qui ont un moindre pourcentage d’alcool, ont été jugées comme ne contenant pas un principe enivrant au sens de la loi. » |
|
|
#
5900
18 avril 2021 Jamais deux sans trois
Dans son édition
du 14 novembre 1884, le journal Le Franco-canadien raconte les
malheurs d’un respectable cultivateur :
« Une nouvelle des
plus tristes nous arrive de St-Raymond, comté de Portneuf. Il y a trois
semaines, un pauvre mais respectable cultivateur nommé Elzéar Morasse,
voyait sa grange détruite par le feu ainsi que les récoltes qu'elle
contenait. Le malheureux, qui était chargé de famille, se livra presque
au désespoir, en face de son infortune.
Mais on sait
quelle conduite admirable les gens de la campagne tiennent d'ordinaire
en semblable circonstance. Ils organisent une corvée et aident à
remonter les bâtisses détruites. C'est ce que les habitants de
St-Raymond firent pour Morasse qui reprit confiance. Un malheur, hélas
n'arrive jamais seul, et cette famille, se composant du père et de la
mère, de trois enfants et de l’aïeule, devait être bien autrement
éprouvée quelques jours plus tard.
Il y a eu samedi
dernier huit jours, Morasse est parti en voiture au faubourg pour
acheter du bardeau pour couvrir sa nouvelle grange. Près de l'église de
St-Raymond, le cheval a pris ombrage de quelques quarts rangés à la
porte d'une épicerie et il est devenu incontrôlable. Le pauvre
cultivateur fit tous ses efforts pour maintenir l'animal affolé, mais il
n'y put réussir.
Il se passa alors
une chose terrible. Morasse perdit l'équilibre et tomba entre le cheval
et la voiture. Il ne lâcha cependant pas les rênes, espérant que
l’animal finirait par s'arrêter. Il fut trainé ainsi une certaine
distance sur le sol et reçut plusieurs ruades terribles dans la
poitrine. Il perdit alors connaissance et le cheval, débarrassé de toute
entrave, continua sa course.
L'accident avait
eu des témoins, et l'on s'empressa de secourir la victime qui fut
transportée chez M. Louis Déry, près de l'église. Un médecin fut appelé
qui donna des soins assidus au pauvre Morasse. Celui-ci ne devait pas en
réchapper. Au bout d’une couple de jours, il a été atteint par le
tétanos, cette terrible affection qui est semblable à la rage, et il
fallut plusieurs hommes pour le maintenir sur un lit jusqu'à sa mort qui
arriva le jeudi.
Les funérailles de ce malheureux, qui était âgé de 48 ans, ont eu lieu samedi dernier, au milieu d'un concours considérable. Une collecte a été faite dans la paroisse pour la famille du défunt, et le curé a donné gratuitement le service funèbre. » |
|
|
#
5865
27 mars 2021
Attaque
nocturne
Dans son
édition du
20 novembre 1865, le journal le Courrier du Canada
raconte un drame survenu chez un cultivateur des Cantons de l’Est.
« La Cour Criminelle de
Bedford, s'est terminée le 21 octobre. La plus importante (sentence) est
celle prononcée contre le nommé Darius Froste, qui, aidé de trois frères
et d’un certain Dégrenier, ont commis sur la famille Auclair, de
Stukely, une attaque nocturne dont les détails ont été mis devant le
public.
Un « bec » (dispute) avait
lieu le 14 octobre chez Didace Auclair. On y avait élevé une étable
pendant la journée et les femmes s’étaient occupées de filage. Le soir,
l’on s’amusait. Vers 8 h, le nommé Darius Froste, son frère Wallace et
Dégrenier avaient été admis à des conditions bien expliquées et bien
comprises.
Pourtant, un instant après
s’être mêlé à la troupe joyeuse, Darius Froste, soldat licencié de
l’armée américaine, dit à son frère « take out your revolver » et
frappait en même temps un frère de son hôte, Simon Auclair. Ce dernier
est un homme fort et courageux, et après une lutte assez courte, les
agresseurs étaient mis à l’ordre et une réconciliation paraissait
s’être opérée.
En laissant la maison
pourtant, Darius Froste disait avec assurance « qu'avant le jour Simon
Auclair aurait cessé de vivre. »
À onze heures, les trois
expulsés revinrent renforcés de deux autres Froste, hommes vigoureux et
redoutés dans la localité. Ils font irruption dans la maison d’Auclair.
Ils demandent qu’on leur livre la personne de Simon Auclair et ils se
répandent même dans la maison à sa recherche.
Auclair se présente et la
lutte s’engage. Les « Iron Muckles », les pierres, les haches furent
employées libéralement. Enfin les assaillants furent mis de nouveau à la
porte, et l’un d’eux alla tomber à quelques pas de la maison couvert de
blessures.
Craignant une attaque contre
la maison, trois des frères Auclair étaient sortis et se tenaient à
quelque distance de la porte, lorsque le nommé Darius Froste s’approche
tranquillement, à la faveur des ténèbres, de Simon Auclair et le frappe
avec un couteau poignard vers la région du cœur. Le coup porta dans le
milieu du bras gauche et y fit une grave blessure. Ainsi avait fini
cette lutte.
Le lendemain 15 octobre, les assaillants étaient arrêtés, et le 24, étaient jugés. Darius Froste, le chef de la bande, fut condamné à deux ans de détention au pénitencier. Ses compagnons à un mois de travaux forcés dans la prison commune. » |
|
|
# 5835
9 mars 2021
L’angoisse
d’une fille
Dans son
édition du 25 mars 1839, le journal
Le Canadien raconte l’histoire d’une fille tourmentée. Voici ce texte :
« Une jeune fille, âgée de 26 ans, était sur le point de se marier. Les
fiançailles célébrées, elle se disposa à aller se confesser. La veille
du jour qu’elle avait choisi pour l’accomplissement de ce devoir
religieux, on remarqua qu’elle était troublée, agitée, elle
ordinairement d’une humeur égale et tranquille. Qui pouvait la
tourmenter ainsi ? On le sut bientôt.
Elle déclara à son confesseur qu’il y a 16 ans, elle en avait alors 10,
elle était domestique chez un métayer des environs, qu’un soir qu’elle
était couchée et qu’on la croyait endormie, son maître rentra tout
bouleversé et dans une agitation extrême, s’approcha du lit de sa femme
et lui dit qu’il venait de commettre un assassinat et de voler sa
victime. Il déposa en même temps sous le lit quelque chose de lourd et
se coucha.
Depuis qu’elle avait eu connaissance de cet horrible secret, jamais elle
n’avait eu le courage de le divulguer ; elle craignait la vengeance de
son maître ; mais au moment de se marier, elle croyait ne pouvoir le
garder dans la crainte que le ciel ne bénit pas son union.
En
effet, à l’époque qu’elle rappelait, un assassinat avait été commis et
un homme, accusé du crime, avait bientôt après été condamné aux travaux
forcés à perpétuité. Ce malheureux y est encore.
Le
curé possesseur du secret et poursuivi par l’idée de réparer une
injustice, en écrivit à son évêque qui l’autorisa à rompre, sur ce
point, le secret de la confession et à instruire la justice. Aujourd’hui
le procureur du roi informe, le maître de la jeune fille est arrêté et
bientôt les débats vont s’ouvrir. »
Note. À la fin de l’article, on écrit que des membres du clergé doutent de la véracité de ce récit, notamment du fait que l’évêque aurait libéré le curé du secret de la confession, arguant qu’il n’en avait pas le droit. |
|
| Accueil | |
|
#
5805
18 février
2021
Escapade d’un père de famille
Dans son édition du 29 octobre 1841, le journal Le Canadien,
sous le titre Effet des romans, raconte l’histoire d’un homme
respectable qui aurait été fortement influencé par ses lectures. Voici
ce texte :
« Il y a déjà longtemps que nous prêchons contre la lecture de ces
livres plus propres à égarer qu’à instruire une belle âme ; aujourd’hui
une funeste expérience de ces sortes de lectures vient de jeter toute
une maison dans la consternation et la misère.
Un brave et intelligent huissier de cette ville, père d’une respectable
famille dont il faisait l’unique soutien, vient tout-à-coup de se
décider à abandonner sa femme et à délaisser ses enfants, sans qu’on
puisse imaginer d’autre motif que ceux d’une imagination fortement
allumée par la lecture de quelques romans extravagants pour lesquels il
se montrait passionné.
La chose est d’autant plus extraordinaire pour les voisins et amis du
pauvre malheureux que la douceur de ses mœurs avait contribué à le
placer dans le sein du plus heureux des ménages. On commença à
s’apercevoir de ses préoccupations dès jeudi dernier. Il entra à
plusieurs reprises dans l’office d’un avocat de la rue Saint-Vincent où
il écrivit en se donnant tous les soins du monde pour ne laisser rien
découvrir de son projet. Le résultat fut une lettre des plus touchantes,
adressée à sa femme, dans laquelle il lui déclare son projet de la
quitter pour jamais, en lui donnant, entr’autres conseils, ceux d’élever
chrétiennement leurs enfants, en lui assurant que tout ce qu’il pourra
gagner sera pour le soutien de sa famille.
Jeudi, dans la nuit, sa femme le vit se lever et se remettre à écrire le
papier qu’eIle trouva le lendemain accidentellement en faisant d’autres
perquisitions ; c’était la lettre à laquelle il venait d’ajouter encore.
De bonne heure, le matin du vendredi, il embrassa sa femme et ses
enfants, et les serra tendrement sur son cœur, puis vêtu de ses plus
vieux habits, il les quitta tous en leur promettant d’être de retour le
lendemain midi auquel temps il n’est point reparu.
Il recommandait aussi dans sa lettre de remettre à une personne, dont il
les avait achetés, des vêtements et chaussures dont il n’avait pu
acquitter Ie prix. On ne sait trop à quoi attribuer cet accès subit de
folie dont les conséquences sont si sérieuses pour la famille éplorée
qui en est la victime. Cet homme irréprochable jusque-là laisse quatre
enfants et une femme respectable dans la misère, à l’entrée d’un hiver
rigoureux, et sans autres ressources que celles par trop idéales de la
lettre romanesque.
Comme nous comptons sur les sympathies des bonnes âmes et que la
connaissance de cette famille peut d’ailleurs intéresser le public à lui
ramener son chef partout où on le trouvera, ce motif nous fera donner le
nom du pauvre fugitif, avec un signalement assez exact. Son nom est
Emilian McKay, huissier de profession ; sa taille est moyenne et son
apparence respectable, et même au-dessus de son état. Il a les cheveux
et les favoris blonds, les yeux bleus, le teint blanc et assez animé.
Comme le manteau dont il est affublé est très usé, et que le râpé de ses habits pourrait le déguiser un peu, nous prions au nom d’une famille désespérée, toutes les personnes bienveillantes et sensibles à une pareille infortune qui le reconnaîtraient, de prendre des mesures pour le ramener à Montréal. Vu qu'il est connu par tout le district, nous espérons qu’on s’empressera d’accomplir ce devoir d’humanité. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5775
30 janvier 2021
Trois bœufs en
photo
Dans son édition du 14 juin 1888, l’Électeur, journal de
Québec, raconte l’histoire de trois bœufs qui voulaient se faire
photographier.
« Hier après-midi, il s’est produit sur la rue St-Joseph, un incident
comique qui a été le sujet d’une grande hilarité. Un cultivateur,
conduisant trois gros bœufs, passait sur la rue St-Joseph pour se rendre
au Palais. Armé d’un énorme gourdin, il gesticulait et criait,
conduisant de son mieux les trois animaux.
En
face de l’atelier de photographie de M. Coulombe et frère, il y avait un
embarras de voitures, et les trois bœufs, voyant qu’ils ne pouvaient
passer et peut-être aussi craignant le bâton de leur maître, ne crurent
rien de mieux à faire que de franchir le seuil de l’atelier.
Un
escalier se présente. Deux d’entre eux, effrayés par les cris du
cultivateur, l’escaladent en quelques enjambées, et les voilà
tout-à-coup au second étage, dans l’atelier de photographie. On peut
juger de l'ahurissement des artistes, tout surpris de voir en leur
présence des sujets d’un nouveau genre.
Le premier moment de surprise passé, on rit de la farce et l’on fit descendre les pauvres animaux qui n’étaient pas les moins surpris : ce qui ne fut pas très facile, attendu la mauvaise volonté des deux bœufs qui, paraît-il, ne voulaient pas déguerpir sans se faire photographier. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5740
9 janvier 2021
Deux vols au 19e siècle
Dans son édition du 15 mai 1822, le journal
Le Canadien raconte le déroulement de deux vols :
Un premier vol
« Un vol curieux a été commis la
semaine dernière au Cap-Rouge. Des voleurs sont entrés dans un hangar
appartenant à M. Paradis, cultivateur de l’endroit, et en ont pris plus
de 200 livres de lard ; puis ils ont été à l’écurie, ont attelé le
cheval à la carriole, ont mis le lard dedans et l’ont emmené.
M. Paradis ayant trouvé le matin que
son cheval et son lard manquaient, prit la route de la ville pour tâcher
d’en obtenir des nouvelles. Il ne fut pas allé bien loin qu’il rencontra
le cheval qui revenait d’un pas lent avec la carriole, mais point de
lard. »
Un deuxième vol
« Un pauvre homme qui était venu de la
Malbaie avec du hareng pour le vendre, ayant mis le produit de ses
ventes, qui montait à 60 piastres dans un coffre à bord de sa chaloupe
au débarquement, on lui a volé son argent et tout ce qu’il y avait dans
le coffre.
Le voleur a été assez imprudent pour échanger son vieux bonnet contre un chapeau neuf, et on espère le découvrir par ce moyen. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5710
21 décembre 2020 Voyage de John Lambert en Canada
Dans son édition du
3 janvier 1818, le journal
L’Aurore publie des extraits d’un texte du Britannique John Lambert.
Ce dernier évoque ses perceptions du canadien-français.
« Les hommes ont naturellement beaucoup
d’esprit et de bon sens ; mais ils ne cultivent presque jamais ni l‘un
ni l‘autre, les écoles étant très rares en Canada. Les femmes sont
généralement plus éclairées ou du moins plus instruites, le clergé ayant
plus fait pour leur instruction que pour celle des hommes.
On se plaint depuis longtemps dans les
papiers publics de ce défaut presque général d’éducation parmi la masse
du peuple. Mais il y a tout lieu de douter que la diffusion des
connaissances et de l'instruction parmi eux, améliorât leur état, ou
rendit le pays plus florissant !
Ils ne peuvent parvenir à s’instruire
que difficilement ; mais cette difficulté vient en grande partie de leur
extrême économie, car s‘ils voulaient mettre à part une somme suffisante
pour faire instruire leurs enfants, il se présenterait des maîtres, et
il s‘ouvrirait des écoles autant qu‘il serait nécessaire.
Les paysans anglais et américains dans
les townships apprennent à leurs enfants les premiers éléments de
l‘éducation ; mais les Canadiens, n‘ayant aucune sorte d'instruction,
sont incapables de faire l‘office de maîtres dans leurs familles et ils
propagent ainsi d‘âge en âge l’ignorance de leurs ancêtres.
Les Français du Canada sont très civils
les uns à l'égard des autres, et se saluent l‘un l‘autre, lorsqu’ils se
rencontrent dans la rue. En voyant deux charretiers ou deux paysans le
chapeau à la main, inclinant l‘un vers l‘autre, je me peignais à
l‘imagination l‘effet curieux qu‘une pareille scène entre deux hommes du
même état aurait dans les rues de Londres. J'ai vu quelquefois les
hommes se baiser sur la joue : mais cet usage n‘est pas général. Ils
sont extrêmement civils et polis envers les étrangers, et ôtent leur
chapeau à tous ceux qu’ils rencontrent dans le chemin. Ils se querellent
rarement, à moins qu‘ils ne soient ivres ; autrement ils sont de belle
humeur, paisibles et officieux. On aperçoit dit-on peu de rusticité dans
les manières des habitants (paysans). (…)
Avant la conquête du pays par les
Anglais, on y parlait, dit-on, la langue française aussi correctement
qu’en France même : depuis cette époque, ils ont introduit dans leur
langage plusieurs anglicismes, et ils se servent de plusieurs tournures
de phrases qu’ils tiennent probablement de leurs liaisons avec les
nouveaux colons. Pour froid, ils prononcent fret ; pour ici, ils
prononcent icitte ; au lieu de dire prêt, ils disent paré ; ils se
servent en outre de plusieurs mots surannés que je n’ai pas présents à
la mémoire. Ils corrompent encore la langue en prononçant la consonne
finale dans bien des mots, contre la coutume des Français d'Europe. (…)
Les Français ont une grande majorité
dans la Chambre d'Assemblée ; leur nombre étant de 86, tandis que celui
des Anglais n’est que de 14. Les discours par conséquent se font presque
tous en Français ; car tous les membres anglais entendent cette langue ;
tandis que la plupart des membres français n‘ont pas la moindre
connaissance de la langue anglaise. (…)
Un de mes amis m‘a conté qu‘ayant demandé un jour un ordre à un membre français de l‘assemblée, (j‘ai oublié pourquoi il en avait besoin) celui-ci lui répondit qu‘il ne savait pas écrire. Eh bien, lui dit mon ami, je l‘écrirai et vous ferez votre marque. Ah ! mon Dieu, répliqua le législateur, cela ne suffira pas. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5690
9 décembre 2020
Un accident de voiture à cheval
Dans son
édition
du 3 janvier 1818,
le journal
L’Aurore publie une lettre d’un témoin d’accident de
voiture.
« M. L‘Éditeur,
Je crois pouvoir user la voie d‘un
papier public pour réclamer contre un abus public. Il y a des règlements
de police qui défendent de courir à cheval ou en voiture dans les rues
de la ville et des faubourgs ; cependant on voit tous les jours des
têtes chaudes qui croient que la possession ou le louage d‘une calèche
ou d’une carriole leur donne le droit d‘estropier et même de tuer qui
bon leur semble.
J‘ai moi-même pensé être la victime de
l'étourderie d‘un de ces écervelés. Malheureusement je n‘avais dans le
moment ni fouet ni canne pour châtier le lourdaud aussi exemplairement
qu'il le méritait. Puisque j‘en suis sur ce sujet, il faut que je dise
un mot d‘un fait dont il me semble qu‘aucune de nos gazettes n‘a parlé,
quoiqu’il valût la peine qu‘on en fit mention.
Ce silence m'aurait fait douter de la
réalité de l‘accident, si je ne l‘avais entendu raconter à plusieurs
personnes dignes de foi.
Il y a quinze jours ou trois semaines,
une femme a été tuée raide par le choc d‘une voiture dans le faubourg de
Québec. On ajoute que cette femme était enceinte. Cependant je n‘ai pas
entendu dire qu‘on ait fait la moindre perquisition ni la moindre
démarche pour découvrir l‘'homicide.
Cette indifférence me parait
impardonnable. Pourquoi n‘a-t-on pas cherché à découvrir le coupable
pour l‘arrêter ? Serait-ce parce que la personne qui a été tuée était
trop pauvre pour mériter qu‘on troublât l‘auteur de sa mort. Assurément
ce ne peut être la raison pourquoi on ne l‘inquiète point. La véritable
raison me semble être l‘apathie pour tout ce qui ne nous touche pas
immédiatement, vice qui est peut-être plus commun dans ce pays que dans
tout autre.
La femme dont il est question n‘a en
apparence aucun parent qui puisse faire les démarches nécessaires pour
que sa mort soit vengée, et par conséquent il faut qu’elle reste
impunie. (Signé) Un citoyen. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5665
24 novembre 2020
Délation payante ?
Dans son édition du
30 avril
1808, le journal
Le Canadien raconte l’histoire de trois frères qui ont voulu faciliter la vie de leur
mère.
« Une femme était restée veuve avec
trois garçons et ne subsistait que de leur travail. Ces jeunes gens
n’ayant pas été élevés pour ce genre de vie gagnaient à peine l’absolu
nécessaire et gémissaient surtout de ne pouvoir procurer à leur mère un
état plus heureux.
On avait depuis peu publié que
quiconque saisirait un voleur et l’amènerait au magistrat toucherait une
somme fort considérable. Les trois frères, que la pauvreté de leur mère
affectait mille fois plus que leur propre indigence, prirent unanimement
une résolution aussi étrange qu’héroïque.
Ils conviennent qu’un des trois passera pour voleur et que
les deux autres le dénonceront au juge. Ils tirent au sort pour savoir
qui sera la victime de l’amour filial et le sort tombe sur le plus jeune
qui se laisse lier et conduire comme un criminel. Il subit
l’interrogatoire et déclare qu’il a volé.
Alors, on l’envoie en prison et ses frères touchent la
somme promise ; mais avant de retourner chez eux, ils trouvèrent un
moyen d’entrer dans la prison, voulant du moins dire un dernier adieu à
leur malheureux frère. Là, croyant n’être vus de personne, ils se
jetèrent dans les bras du prisonnier et, par leurs larmes et leurs
sanglots et les plus tendres embrassements, lui témoignèrent l’excès
d’affection et de douleur dont ils étaient pénétrés.
Le magistrat qui par hasard était dans un lieu duquel il
pouvait les apercevoir fut extrêmement surpris de voir un criminel
recevoir des preuves d’amitié si vives de la part même de ceux qui
l’avaient livré à la justice. Il donna ordre à un de ses gens de suivre
les deux délateurs et de les épier avec soin.
Le domestique obéit et rapporta à son maître qu’ayant
suivi les deux frères, il était entré après eux dans leur maison et
s’était arrêté à la porte de la chambre de leur mère, d’où il avait pu
facilement les entendre. Qu’en entrant, le premier soin des deux jeunes
gens avait été de donner à leur mère l’argent qu’ils avaient reçu pour
prix de leur délation ; que cette femme étonnée avait témoigné beaucoup
plus d’inquiétude que de joie à la vue d’une somme si considérable ;
qu’elle les avait vivement questionnés sur la manière dont ils l’avaient
acquise et sur l’absence de leur troisième frère ; que les infortunés
n’avaient pu d’abord lui répondre que par des pleurs ; mais qu’enfin
menacés de la malédiction d’une mère si chère, ils avaient tout avoué ;
qu’à cet affreux récit, la malheureuse femme pénétrée de reconnaissance,
de terreur et d’admiration, s’était abandonnée aux plus violents
transports du désespoir le mieux fondé ; qu’elle s’était élancée pour
sortir, avec l’intention de venir tout déclarer au magistrat, mais que
retenue par ses cruels et généreux enfants, tous deux précipités à ses
genoux, les accablant de reproches, et les baignant de larmes,
ressentant à la fois tout ce que la colère, la douleur et la tendresse
peuvent faire éprouver de plus impétueux et de plus passionné, elle
n’avait pu résister à de si terribles agitations, et qu’elle était
tombée sans connaissance entre leur bras.
Après ce récit, le juge se rendit à la prison du troisième
frère et l’interrogea de nouveau ; mais le jeune homme persista et rien
ne put l’engager à se rétracter. Alors le magistrat lui dit qu’il
n’avait voulu que connaître à quel excès d’héroïsme la piété filiale
pouvait élever un cœur vertueux et lui déclara qu’il était instruit de
tous les détails de son histoire.
Le juge alla ensuite faire rapport de cette aventure au cubo-sama, ou souverain ; et ce prince, frappé d’une action si héroïque, voulut voir les trois frères et l’heureuse mère de ses vertueux enfants. Il les combla d’éloges et de marques de distinction, assigna au plus jeune 1500 écus de rente et 500 à chacun des deux frères. » (Histoire du Japon, par le P. de Charlevoix) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5635
6 novembre 2020
Tragédie évitée à
Trois-Pistoles
Dans son édition
du 5
janvier 1842,
le journal
Le Canadien publie une lettre d’un témoin qui raconte un événement
mémorable qui s’est passé à Trois-Pistoles quelques jours auparavant :
« M.
l’Éditeur,
Si
vous trouvez à propos de mettre devant le Public la communication
suivante, vous voudrez bien l’insérer dans une de vos feuilles.
La
paroisse des Trois-Pistoles se rappellera longtemps le 23 de décembre
1841 où une catastrophe bien triste faillit plonger dans le deuil un
grand nombre de familles. Quelques jours auparavant, il était tombé,
pour me servir de l’expression canadienne, une forte bordée de neige qui
suivie d’un grand froid avait formé plusieurs banquises de glace que le
vent et le courant faisaient mouvoir çà et là sur le fleuve.
La
nuit du 21, la densité du froid et le vent nord forcèrent les banquises
à s’arrêter sur le rivage sud du fleuve jusqu’à une étendue en
profondeur de pas moins 5 à 6 milles, c.-à-d. jusqu’en plein canal.
Plusieurs de vos lecteurs savent probablement que l’espèce de poisson
appelé loup-marin aiment aussi eux à faire une promenade sur la surface
des eaux, l’hiver leur en fournit l’occasion. Aussitôt que la glace est
assez forte, on les voit se promener par groupes au gré du courant et du
vent. Il arrive souvent dans ces circonstances qu’imprudents nautoniers
ils perdent les moyens sûrs de débarquement et tombent ainsi entre les
mains d’ennemis qui aiment leurs dépouilles et en tirent un assez bon
parti.
C’est
dans une de ces circonstances que 50 personnes faillirent perdre la vie.
La veille de ce jour de frayeur il avait été tué et sauvé environ 150
loups-marins; le lendemain 23, de nouvelles banquises amenées par le
vent du nord offrirent de nouvelles proies ; chacun s’empressa d’en
avoir sa part. Plus de 100 personnes se dispersèrent sur la glace
assommant à coups de bâton les loups-marins qui y étaient par centaines.
Les banquises du large paraissant bien jointes avec celles de la terre,
et la glace étant assez forte pour les piétons, on crut qu’il n’y avait
pas de danger à courir, et dans cette idée chacun ne pensait qu’à tuer à
qui mieux mieux ; mais sur les 10 heures du matin le vent souffla du sud
; dans un instant, la glace se sépara en plusieurs banquises, les
personnes près de la séparation s’en aperçurent assez à temps pour
sauter sur la banquise de terre, quelques-uns ne le firent que par le
moyen d ’une traine qui leur servit de pont flottant.
Mais
il en restait encore 50 qui ne s’aperçurent du danger que lorsqu’il n’y
avait plus de moyen de franchir l’espace entre les différentes
banquises. II n’est pas nécessaire, M. l’Éditeur, de vous peindre les
angoisses, les inquiétudes, que ces pauvres malheureux sentirent à la
vue du danger qu’ils couraient. Nous qui étions à terre et qui au moyen
de longues-vues pouvions considérer un spectacle si effrayant, pouvions
nous figurer la terreur qui régnait parmi eux.
Inutile de dire que nous ne demeurions pas spectateurs oisifs d’un tel
désastre, chacun de chercher les moyens de porter secours à ces pauvres
gens, mais comment ? Les plus capables de partir en pareil cas étaient
du nombre des malheureux. Point d’autres embarcations que des chaloupes
de pilotes, et la glace était trop faible pour en supporter le poids, et
d’ailleurs il fallait franchir un espace de pas moins de deux milles
pour arriver à l’eau. Le vent augmentait et la nuit approchait ; vous
pouvez imaginer, M. l’Éditeur, vous et vos lecteurs, quel martyr durent
souffrir ces malheureux lorsque voyant la brune approcher, aucune
embarcation n’allait à leur secours ; nous les voyions courir çà et là,
se rassembler par groupe vis-à-vis l’église, se mettre à genoux, élever
les mains au Ciel pour demander assistance.
Ce ne
fut que vers les 4 heures de l’après-midi que nous pûmes nous procurer
une légère embarcation qui pouvait porter tout au plus 7 à 8 personnes,
elle est promptement trainée sur la glace, mise à l’eau, elle vole
conduite par deux jeunes gens actifs vers le lieu du désastre. Arrivée
au groupe rassemblé c’est à qui s’y jettera ; peu s’en fallut que par
imprudence, (bien pardonnable en pareil cas) ces malheureux ne
perdissent tout moyen de salut ; heureusement que quelques personnes de
sang-froid modérèrent l’empressement des autres, sans quoi c’était fini
de tous. Le calme rétabli parmi ces malheureux, il faut prendre charge,
mais qui embarqueront les premiers ?
C’est
alors, M. l’Éditeur, qu’il se fit un trait de générosité digne de
louange et qui fait honneur aux jeunes gens qui en conçurent l’idée ;
que les gens mariés, dirent-ils, embarquent les premiers. Ils ont des
familles à soutenir, nous, nous courrons notre chance. Ce trait est
d’autant plus généreux que la mer baissait et que la banquise sur
laquelle ils étaient descendait en gagnant le large avec, suivant leur
expression, la vitesse d’un cheval au trot.
Cette
première charge est donc mise en voie de salut, mais pour cela il
fallait traverser à l’aviron un espace de pas moins 20 arpents, ce qui
formait 40 arpents au moins pour aller et venir. Pendant le trajet la
banquise descendait, et la noirceur augmentait, si bien que les
conducteurs de l’embarcation ayant dirigé leur route à peu près vers
l’endroit où ils avaient pris la première charge ne virent plus de glace
; quelle route prendre ? Ils font force de rame, tournent en tout sens,
enfin le sort veut ou plutôt la Providence, qu’ils se dirigent du bon
côté, il était temps, car la banquise allait dédoubler un petit rocher
appelé Rassade et c’en était fait de 40 et quelques personnes. La
providence voulut donc qu’aucun ne périt, ils furent tous mis en sûreté
sur la Rassade, d’où ils purent gagner la terre vers les 10 heures du
soir.
Tous ceux qui comme moi ont été témoins de
cette scène ne peuvent s’empêcher d’attribuer le salut de tant de
personnes qu’à un miracle. Le danger paraissait si imminent que M. le
Curé de la paroisse après s’être consulté avec Messieurs les Curés
voisins qui se trouvaient chez lui, crut devoir exercer une des
fonctions les plus sacrées de son ministère, tant il était difficile de
croire que tous pussent échapper à la mort. (On peut penser au sacrement
d’extrême-onction qui pouvait être donné, dans ce cas, sans la présence
de la personne.)
Avant
de terminer cette communication, il n’est pas hors de propos de
mentionner le courage déployé par un jeune homme de 20 ans du nom de
Louis Sirois. Ce jeune homme avait failli se noyer la matinée du jour
fatal, la glace ayant défoncé sous ses pieds. Cet accident l’avait
obligé de retourner à la maison paternelle à pas moins de trois milles
du lieu de la triste catastrophe.
Eh !
bien ce jeune homme après avoir changé de vêtements, voyant le danger
que couraient plusieurs de ses coparoissiens, se rendit en grande hâte
au lieu du désastre, et ce fut lui qui avec un autre jeune homme du nom
de Louis Rioux, conduisit la petite embarcation qui sauva la vie à ses
frères. Ce fut lui encore qui tout épuisé qu’il devait être, nous
apporta la première nouvelle que tous étaient sauvés. Honneur et louange
à ces deux jeunes gens et gloire à notre Canada qui peut se glorifier de
plusieurs traits semblables de dévouement et de courage.
Vous
voyez, M. l’Éditeur, que j’ai raison de dire que le 23 de décembre sera
un jour mémorable pour la paroisse des Trois-Pistoles. Aussi en mémoire
de l’événement arrivé ce jour, quelques citoyens se proposent d’ériger
l’été prochain sur la petite Rassade située à environ 3 milles de la
terre ferme, une croix qui en rappellera le souvenir. Nos neveux et les
marins apprendront que ce petit îlot qui n’est qu’un rocher pelé et qui
semble inutile, a sauvé la vie à plus de 40 personnes à la fois. Ils
apprendront à bénir le créateur dans tous les ouvrages de ses mains.
(Signé) Un témoin oculaire.
P. S. Si ce n’eut été de l’accident plus haut mentionné, plus de 400 loups-marins d’une grosseur énorme auraient été amenés à terre ce jour-là qui sont demeurés morts sur les banquises où ils avaient été assommés. Au dire des connaisseurs, cette tuerie avec celle de la veille dont j’ai parlé, aurait procuré à notre paroisse un profit net de pas moins de mille louis. L’occasion se présente ici de dire que des personnes entreprenantes pourraient avec un peu d’industrie faire aux environs de notre Isle aux Basques, en été, une pêche copieuse de ces loups marins. Je ne craindrais pas de dire qu’ils compenseraient leurs frais en peu de temps. Les personnes étrangères qui visitent les Trois-Pistoles en été, peuvent témoigner de la vérité de ce fait. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5610
21 octobre 2020
Au presbytère
Le Canadien,
un journal de Québec, dans son édition du 25 mars 1839, rapporte un
événement tragique.
« On nous transmet de Cervionne (Corse) le fait suivant que nous
offrons à la curiosité de nos lecteurs :
Pendant une des nuits du mois de janvier, un individu frappe à
coups redoublés à la porte du presbytère ; le curé refuse d’ouvrir,
craignant une trahison ; mais il se laisse enfin persuader par les
supplications d’un homme qui le presse de venir porter les derniers
secours de la religion à un agonisant dont la demeure est peu éloignée.
À peine le curé a-t-il ouvert sa porte, qu'il est saisi vigoureusement par un brigand masqué et armé d'un pistolet, qui l’oblige à le conduire dans l'église. Là, le brigand se fait remettre tous les vases sacrés et autres ornements. Pour les emporter plus facilement, il veut les réunir en un seul paquet ; il pose son pistolet et se hâte de saisir les objets ; mais le curé, profitant de cette circonstance, s’empare du pistolet, brûle la cervelle du brigand et court appeler du secours ; on vient, on arrache le masque du voleur et l’on reconnaît le maire du village. » |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5595
12 octobre 2020
Lettre d’un suicidé
Le Courrier de Québec, dans
son édition du 30 novembre 1808, raconte
l’histoire d’un Irlandais d’origine :
Un pauvre homme, natif d'Irlande, ayant eu quelques différends avec sa
femme, se jeta ces jours passés dans une rivière où il se laissa noyer.
Ce qui suit est une relation curieuse et circonstanciée de sa mort,
écrite par lui-même et trouvée dans sa chambre.
« Comme je sais que le peuple qui trouvera ma carcasse, désirera avoir
quelques connaissances de la cause de ma mort, je vais lui donner,
là-dessus, toute la satisfaction possible.
Connaissant entièrement le sujet depuis le commencement jusqu’à la fin
et plus encore, le malheur que j'ai eu d’épouser une méchante femme, qui
n’eut jamais de plus grand plaisir que celui de me quereller et de me
forcer par là à laisser la vie. Il se pourrait faire qu’on rapportât (le
monde est si porté au mensonge) que je suis mort par accident : mais
c’est une erreur, car je me suis moi-même jeté à l’eau et m'y suis ainsi
laissé mourir.
D'ailleurs, comme ce qui me reste est fort peu de chose, j’espère qu’il
ne sera point le sujet des querelles et des contestations. Je donne ce
qu’on trouvera dans ma bourse à Betsey Mckenzie. Ma femme dit que j'ai
eu un commerce illicite avec elle, mais c’est un vrai mensonge de sa
fabrique, et si je vivais, je lui dirais nettement et à sa face.
Quant à ma femme, elle ne s’est que trop bien servi de mon bien. Ainsi
mon intention est qu’on ne lui donne plus rien ; c'était une assez forte
charge pour moi que de l’entretenir pendant ma vie, sans qu'il faille
songer à elle après ma mort.
Je pardonne à tout le monde, ma femme exceptée. Je ne puis savoir
positivement où j’irai, mais je suis assez tranquille là-dessus, ayant
adroitement extorqué une absolution, aujourd'hui, sans que le prêtre qui
me l’a donnée sût alors ce qui m'était entré dans la tête.
L'indifférence et la bonté ont été les deux guides de mes actions.
J'aurais cependant (et je ne m’en cache pas) heurté l’homme le plus
nerveux qui eût osé dire autre chose ; mais actuellement, je suis mort,
et il est libre à ceux qui vivent de parler de moi comme bon leur
semblera. Le Diable pourtant les récompensera de leurs peines.
Je meurs ami des hommes. Je souhaite du bien à tous ceux qui ont eu
quelques égards pour moi, et l’endroit où je serai inhumé ne m'importe
pas plus qu'une pipe de tabac. J'étais partagé entre le dessein de me
pendre et celui de me noyer. J'ai pris enfin ce dernier parti. Observant
qu’il n’est pas si usité que l’autre ; car on pend les voleurs, les
hérétiques, les meurtriers, mais on les noie jamais.
Je meurs ainsi, âgé de 38 ans, sans désespoir, murmure, ni plainte,
enfin comme un homme, et de mon propre et libre choix et détermination,
avec pleine assurance d’aller au Ciel où je me dispose à rire, à gorge
déployée, et de ma femme et du Diable. »
Quelle singularité ? quel sang froid ! quel mélange de grandeur et de petitesse, de force et de faiblesse, de perception et de démence. (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5570
27 septembre 2020
Le choléra à Québec en 1832
Dans
Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes, Pierre-Joseph-Olivier
Chauveau indique que le choléra a gagné la ville de Québec le 9 juin
1832. Il décrit les ravages que ce fléau y a produits. En annexe, il
indique que le nombre de décès imputé à cette épidémie fut de 3300 alors
que la population de la ville était d’environ 30 000 habitants, ce qui
correspond à environ 11 % de la population.
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau est né à Charlesbourg (Québec) le 30 mai
1820. À neuf ans, il entre au Petit Séminaire de Québec où il fait ses
études classiques. Il devient avocat. Il est le 1er premier
ministre du Québec en 1867.
En
annexe de son livre, Chauveau écrit : « Ceux qui n'ont vu à Québec que
les dernières invasions du choléra auront peut-être quelque peine à
croire à la description que nous avons faite de ses ravages en 1832. »
Voici
ce que Chauveau écrit dans son livre concernant ce qui se passe cette année-là :
« Le
choléra sévissait à Québec avec une rage inouïe. Bien loin d'avoir été
préservée, comme on l'espérait, cette ville souffrait de l'épidémie dans
des proportions bien plus grandes que toutes les autres villes de
l'Amérique. (…) De cent à cent cinquante victimes succombaient chaque
jour. Prêtres et médecins ne pouvaient suffire à remplir leur ministère.
Les émigrés et les pauvres gens tombaient frappés dans les rues et on
les conduisait aux hôpitaux entassés dans des charrettes où ils se
débattaient dans des convulsions effrayantes. Les corbillards ne
suffisaient plus pour conduire les morts à leur dernière demeure.
De
longues files de charrettes chargées chacune d'elles de plusieurs
cercueils se croisaient dans toutes les directions. Les décès des gens
riches et considérables étaient devenus si fréquents, que les glas
funèbres tintaient continuellement à toutes les églises. L'autorité
défendit de sonner les cloches, et leur silence, plus éloquent que leurs
sons lugubres, augmenta la terreur au lieu de la diminuer.
Toutes
les affaires étaient interrompues, les rues et les places publiques
étaient vides de tout ce qui avait coutume de les animer, presque toutes
les boutiques étaient fermées : la mort seule semblait avoir droit de
bourgeoisie dans la cité maudite ; on ne rencontrait partout que des
gens portant la livrée de cet horrible tyran. L'autorité épuisait dans
son impuissance tous les caprices de son imagination. Un jour, vous
sentiez partout l'odeur âcre et nauséabonde du chlorure de chaux, le
lendemain on faisait brûler du goudron dans toutes les rues. De petites
casseroles posées de distances en distances sur des réchauds, le long
des trottoirs, laissaient échapper une flamme rouge et une fumée
épaisse.
Le
soir, tous ces petits feux avaient une apparence sinistre et presque
infernale. Quelques officiers qui avaient été dans l'Inde, s'avisèrent
de raconter qu'après une grande bataille le fléau avait cessé et que
l'on attribuait sa disparition aux commotions que les décharges
d'artillerie avaient fait éprouver à l'atmosphère. De suite on traîna
dans les rues des canons, et toute la journée on entendit retentir les
lourdes volées d'artillerie, comme s'il se fut agi de dompter une
insurrection.
Et
avec toutes ces précautions, le mal redoublait d'intensité et emportait
dans la tombe des familles entières ; il y eut même des rues où il resta
à peine un seul être vivant. Les médecins, comme l'autorité, avaient
épuisé toutes leurs ressources et fait manger au monstre toute leur
pharmacie, qui n’avait fait qu'aiguiser sa faim dévorante. Toutes les
théories et tous les systèmes recevaient chaque jour de l'expérience un
cruel démenti : le remède qui triomphait un jour était sûr d'éprouver le
lendemain une éclatante défaite ; les seules cures qui s'opéraient ne
pouvaient guère s'attribuer qu'à la nature, ou à l'intervention directe
de la providence ; elles avaient lieu le plus souvent, lorsque le malade
rendu à la dernière extrémité était abandonné des médecins.
On
avait érigé des hôpitaux temporaires, et l'on avait élevé au centre du
faubourg St. Jean, sur un terrain vacant, une immense baraque en bois
que l'on baptisa du nom d'Hôpital des Émigrés. C'était là que le fléau
tenait sa cour plénière et régnait en maître absolu. Ce n'était pas des
malades, c'était plutôt des mourants qui allaient se faire enregistrer
dans cet hôpital avant de prendre le chemin du cimetière.
Tous
les lits étaient pleins et une foule de patients étaient étendus par
terre, faute de place : rien de plus hideusement saisissant que cette
salle où il fallait souvent déplacer un cadavre pour parvenir à un
malade. On avait été obligé d'établir tout près de là une boutique de
cercueils et le bruit de ce sinistre travail parvenait distinctement à
l'oreille des mourants. (…)
Les
enterrements des cholériques se faisaient régulièrement chaque soir à
sept heures pour toute la journée. Les morts de la nuit avaient le
privilège de rester vingt-quatre heures ou à-peu-près à leur domicile.
Ceux de l'après-midi n'avaient que quelques heures de grâce. On les
portait au cimetière à la hâte pour l’enterrement du soir. Tant pis pour
eux, s'ils se réveillaient trop tard ! À toutes les heures du jour, les
chars funèbres se dirigeaient vers la nécropole ; mais le soir c'était
une procession tumultueuse ; une véritable course aux tombeaux,
semblable aux danses macabres peintes ou sculptées sur les monuments du
moyen âge.
Des
corbillards de toutes formes, de grossières charrettes, contenant
chacune de quatre à six cercueils symétriquement arrangés, se pressaient
et s'entreheurtaient confusément dans la grande allée, ou chemin St.
Louis. Les Irlandais étaient à-peu-près les seuls à former des convois à
la suite des dépouilles de leurs parents ou de leurs amis. Ce peuple est
si malheureux, qu'il a toujours festoyé la mort comme une amie, et que
nul danger ne peut l'éloigner d'une cérémonie funèbre.
C'étaient de longues files de calèches pleines d'hommes, de femmes, et
d'enfants entassés les uns sur les autres, comme les morts dans leurs
charrettes ; tandis que les cercueils des canadiens se rendaient seuls
ou presque seuls à leur dernière demeure. Au reste, la plupart de ceux
qui avaient parcouru ce chemin la veille en spectateurs faisaient
eux-mêmes le lendemain les frais d'un semblable spectacle. »
Notons que, selon Chauveau, à Québec, une seconde vague de choléra a débuté le 7 juillet 1834 et a fait 2500 morts ; une troisième vague le 2 juillet 1849 avec 1180 morts ; une quatrième vague le 28 août 1851 avec 280 morts ; une cinquième vague le 26 septembre 1852 avec 145 morts. |
|
| Retour | Accueil |
|
# 5545
12 septembre 2020
Disparition mystérieuse
Dans son édition du 14 juin 1888,
L’Électeur, un journal de
Québec, raconte
ce qui est arrivé à un citoyen de Beaumont. Voici le texte :
« Depuis quelques jours, la population du village de Beaumont est dans
une grande excitation, vu la disparition plus que mystérieuse d'un des
citoyens du l’endroit.
Voici les faits : En octobre dernier, une assemblée de paroisse eut lieu
à Beaumont, un dimanche, et devint très tumultueuse, à tel point que
l’on en vint à des voies de fait, et durant la bagarre un homme fut
violemment frappé à la base du crâne.
Cet homme, qui a nom Narcisse Turgeon, est celui dont on déplore
aujourd'hui la disparition. La bagarre dont nous venons de parler a eu
pour cause première le fait que M. Turgeon aurait exprimé des opinions
qui n’étaient pas partagées par la majorité des paroissiens présents à
l’assemblée qui eut lieu à l’issue de la messe.
Rendu chez lui, M. Turgeon se plaignit de violentes douleurs à la tête,
douleurs qui allèrent toujours en augmentant et il devint gravement
malade. Étant quoique peu rétabli, M. Turgeon intenta une action en
dommage et obtint jugement pour 100 $ et les frais.
Le blessé ne prenant pas de mieux, les docteurs Morin et Ladrière furent
mandés et conseillèrent au malade de subir une opération chirurgicale,
mais Turgeon refusa de suivre leur avis et continua d’aller de mal en
pis, manifestant parfois des symptômes d'aliénation mentale.
Dimanche dernier, Turgeon est parti de chez lui, laissant une lettre par
laquelle il informait sa famille qu'il allait se noyer. On n’a eu aucune
nouvelle de lui depuis et l'on suppose qu’il s’est jeté dans le
St-Laurent.
M. Turgeon qui est un cultivateur à l’aise est âgé de 45 ans et était considéré comme étant un des meilleurs citoyens de la paroisse. » (Fin du texte cité) |
|
| Retour | Accueil |